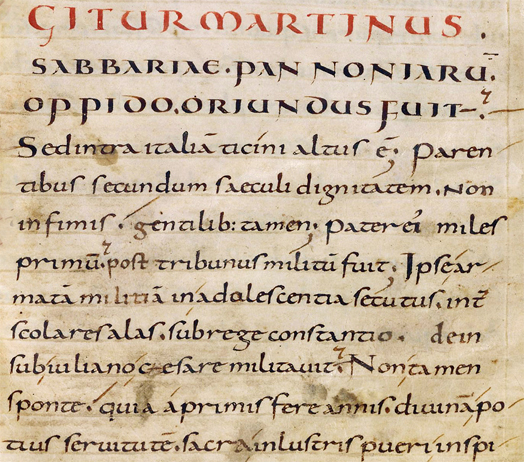Saint Sulpice Sévère, prêtre
Saint Sulpice Sévère
Disciple de saint Martin (+ 410)
Né d'une famille distinguée d'Aquitaine, Sulpice Sévère abandonne sa carrière d'avocat après le décès de sa femme (399) et mène la vie monastique à Primuliacum (dans l'actuel département de l'Aude ?) jusqu'à sa mort. Attiré par la renommée de saint Martin, il avait fait le pèlerinage de Tours. Auteur d'une Chronique universelle, intéressante surtout pour ce qu'il dit de son époque, il est connu pour sa Vie de saint Martin, écrite avant la mort de l'évêque de Tours (397), complétée par trois Lettres et deux livres de Dialogues. Il veut montrer que Martin a dépassé par sa sainteté et ses miracles les ascètes égyptiens eux-mêmes. L'influence de la Vie d'Antoine par saint Athanase y est visible. E. C. Babut (1912) avait refusé toute valeur historique à la Vie ; les travaux de J. Fontaine (1961-1967) ont montré, derrière l'intention édifiante, derrière l'idéalisation et la stylisation de la personne de Martin, l'authenticité d'un noyau historique considérable. La forme littéraire de l'œuvre, toute nourrie des classiques (notamment Salluste et Tacite), atteint une perfection raffinée. L'influence de la Vie sur la diffusion du culte de saint Martin et sur la spiritualité monastique fut considérable.
Pierre Thomas CAMELOT, « SULPICE SÉVÈRE (360 env.-env. 420) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 29 janvier 2017. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/sulpice-severe/
texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER
Sulpice Sévère, issu d’une famille illustre, naquit vers l’an 350, dans la province d’Aquitaine. Son éducation répondit à la richesse et aux vues ambitieuses de ses parents. À l’exemple de plusieurs de ses contemporains devenus célèbres, Sulpice Sévère débuta de bonne heure au barreau. C’était alors, comme jadis à Rome, le chemin le plus court pour arriver aux dignités. L’habitude de la parole et le maniement des affaires révélaient promptement, chez les hommes instruits et sérieux, l’aptitude aux fonctions élevées de l’empire. Sulpice s’y distingua par son éloquence, la souplesse de son esprit, son habileté à déjouer les artifices de la chicane, la rectitude de son jugement, et la solidité de son argumentation. Sa réputation se répandit au loin. Comblé des dons de la fortune et du génie, il pouvait aspirer sans témérité aux premières charges de l’État. Entièrement absorbé par les préoccupations mondaines, dans un âge où toutes les espérances sourient à l’imagination, il s’engagea dans le mariage en épousant une femme de famille consulaire, également remarquable par ses richesses et ses alliances. Sa belle-mère se nommait Bassula. Il était impossible à un jeune homme d’entrer dans la carrière des honneurs sous de plus heureux auspices. Hélas ! tous ces beaux rêves d’avenir ne tardèrent pas à s’évanouir. La Providence lui réservait une destinée plus glorieuse. La mort lui ravit son épouse, et le plongea dans une tristesse profonde. Heureusement son âme, au milieu de tant d’illusions, était restée chrétienne. Au lieu de se laisser abattre par le désespoir, il se redressa énergiquement, et chercha des consolations dans la piété. Dieu récompensa magnifiquement sa foi entre mille autres grâces, il lui ménagea celle de devenir l’ami de saint Martin, évêque de Tours.
Sulpice Sévère fat affermi dans sa résolution de quitter le monde par un compagnon d’enfance et d’études, saint Paulin, qui renonça lui-même aux grandeurs du siècle après avoir été revêtu de la dignité de consul, et fut plus tard la gloire de l’Église de Nole, en Campanie. Sulpice était encore dans la première fleur de l’âge. Son sacrifice en fut plus méritoire. Il n’hésita pas un moment, et, en se consacrant au service de Dieu, il se dépouilla sur-le-champ de la propriété, de ses biens, qui étaient considérables. Cependant, à l’imitation de saint Ambroise, il ne vendit pas ses héritages pour en distribuer le prix aux pauvres ; il se contenta de les céder à l’Église, en s’en réservant l’usufruit. Ce genre d’abandon plaisait davantage à ces grands personnages, accoutumés à exercer directement une influence active sur les hommes. Saint Paulin exalte en termes pompeux cet acte de désintéressement, qu’il regarde comme l’accomplissement. du précepte de saint Paul recommandant aux chrétiens de posséder comme s’ils ne possédaient pas.
Personne ne l’ignore, les généreuses résolutions, comme les grandes œuvres, sont ordinairement soumises aux épreuves. En cette occasion, Dieu n’en dispensa pas son serviteur. Sulpice rencontra des contradictions et des obstacles de tous côtés. Son changement de vie irrita son père, et excita la risée de ses anciens amis. À ces chagrins, dont l’amertume le désolait, vint se joindre la maladie. À deux reprises différentes, il tomba grièvement malade ; mais sa force d’âme, aidée de la grâce divine, triompha de toutes les tentations.
Peu de temps après sa conversion, Sulpice Sévère vint à Tours visiter saint Martin. L’histoire ne nous a pas fait connaître la cause de ce voyage. Nous pouvons l’attribuer à cet attrait invincible qui poussait vers l’illustre évêque de Tours les cœurs héroïques, saintement passionnés pour Dieu et pour son Église ; amoureux des rigueurs salutaires de la mortification de la croix, animés de l’amour du prochain. On croit communément que cette première entrevue eut lieu vers l’an 393. Sulpice fut accueilli avec les témoignages les plus touchants de bonté et d’affection, de la part de saint Martin. L’humble évêque le remercia d’abord de ce qu’il avait entrepris en sa considération un si long et si pénible voyage. Il le fit asseoir à sa table : faveur qu’il accordait rarement, surtout aux grands du monde. « Quelque misérable que je sois, dit Sulpice Sévère, je n’ose presque le reconnaître ; ce grand saint m’a fait l’honneur de me recevoir à sa table ? de me verser de l’eau sur les mains, de me laver les pieds. Il n’y eût pas moyen de m’en dispenser, ni de m’y opposer. Je fus tellement accablé du poids de son autorité, que j’aurais cru faire un crime de ne m’y pas soumettre. »
Ainsi saint Martin remplissait envers un étranger les devoirs de l’hospitalité chrétienne ; ainsi commença pour Sulpice Sévère cette douce familiarité avec notre saint évêque, qui fit l’honneur et la consolation de sa vie. Durant son séjour à Tours, Sulpice étudiait la vie et les vertus de saint Martin, comme le meilleur modèle à suivre ; déjà même il avait conçu le dessein de mettre par écrit tout ce qu’il avait appris des actions de notre illustre évêque. Jamais projet littéraire ne porta plus bonheur à un écrivain : la postérité connaît surtout Sulpice Sévère comme l’historien de saint Martin. Quoique notre saint prélat eût l’habitude de ne jamais parler de lui-même, et de cacher les grâces particulières que Dieu lui accordait, Sulpice cependant affirme qu’il apprit de sa propre bouche une partie des faits racontés dans son histoire. D’autres traits, avec quantité de circonstances intéressantes, lui furent révélés par les clercs de l’Église de Tours ou par les moines de Marmoutier. Peu d’auteurs ont eu la même bonne fortune. Aussi son récit peut-il être considéré comme entièrement digne de foi, puisqu’il s’appuie constamment sur le rapport de témoins oculaires, quand il ne reproduit pas les paroles, mêmes de saint Martin.
À l’école d’un maître si habile, Sulpice fit de rapides progrès. Non content de venir de temps en temps passer quelques jours de retraite à Marmoutier, il transforma sa propre maison en communauté. Là, au milieu de ses anciens serviteurs et esclaves, devenus ses frères en Jésus-Christ, il mettait en pratique les plus austères exercices de la mortification, et passait ses jours dans les plus douces occupations de la piété. Il eut des disciples, parmi lesquels on compte Victor, qui avait reçu les premières leçons de la vie monastique à Tours. Au sein de cette agréable solitude, Sulpice Sévère, adonné à la méditation des choses célestes et à l’étude des saintes lettres, conservait une entière liberté d’esprit, et même cette aimable gaieté qui fut souvent le partage des serviteurs de. Dieu. On trouve une preuve charmante de cet enjouement, innocent dans une lettre qu’il écrivit à saint. Paulin. Celui-ci l’avait prié de lui envoyer un cuisinier. Sulpice l’informe qu’il est assez heureux pour pouvoir satisfaire à sa demande, et qu’il lui enverra bientôt. un serviteur plein de bonnes qualités. « Je ne veux pas toutefois, ajoute-t-il en riant, trop vanter ses talents ; car il a été élevé dans ma cuisine, où l’on ne fait cuire que des fèves et d’autres légumes, où les mets les plus recherchés sont une espèce de bouillie et des herbes hachées, dont tout l’assaisonnement, n’est que du vinaigre et des feuilles de plantes aromatiques. » Saint Paulin et Sulpice Sévère vécurent toujours dans une étroite union. Outre le trait que nous venons de citer, nous apporterons encore, comme preuve de leur intimité, les petits présents qu’ils étaient dans l’habitude d’échanger entre eux. Un jour, Sulpice envoya à l’évêque de Nole un manteau de poils de chameau, grossier produit des fabriques du midi des Gaules. Il reçut en retour la tunique de laine que Paulin avait reçue de sainte Mélanie.
Charmante simplicité ! touchants commerces de l’amitié chrétienne ! Les sainte ont souvent inventé de ces procédés, qui enchantent les âmes candides. La religion épanouit ainsi les cœurs, et donne naissance à des fleurs suaves de sentiment et de délicatesse.
Nous ne dirons, rien ici de l’ouvrage de Sulpice Sévère sar l’Histoire sacrée, quoique ce livre, justement estimé, lui ait mérité le surnom de Salluste chrétien. Nous préférons nous arrêter quelques instants à l’examen de la Vie de saint Martin, des Lettres et des Dialogues qui en forment le complément. Il entreprit de rédiger la Vie sur la demande de Didier, le même, comme on le croit, à qui, saint Jérôme et saint Paulin ont écrit. Le but qu’il se propose est de contribuer au salut des hommes, en leur mettant sous les yeux un admirable modèle de toutes les vertus. Il dédaigne la vaine estime des gens du monde, plus occupés des artifices du langage que des réflexions sérieuses suggérées par la lecture de la vie des saints. La modestie lui fait dire qu’il est inhabile à écrire, et qu’il ne rougit pas même de faire des solécismes. Les amis de la littérature latine le regardent néanmoins comme un des meilleurs auteurs de son siècle. À peine eut-il achevé son travail, qu’il en remit une copie à saint Paulin. Celui-ci la porta à Rome, où chacun se pressa de la lire. Les copies se multiplièrent rapidement, et la Vie de saint Martin se lisait jusque dans les déserts de la Thébaïde, du vivant même de l’auteur. Jamais livre n’obtint un succès plus rapide et plus général. Le pieux évêque de Nole félicite son ami de ce que Dieu l’a jugé digne de publier les louanges d’un si grand évêque, et il lui promet une récompense éternelle. « Ce discours, dit-il, est comme un manteau dont vous avez revêtu et paré le Seigneur Jésus, que vous avez, pour ainsi dire, couronné des fleurs de votre éloquence. »
L’ouvrage avait d’abord paru sans nom d’auteur. Plus tard, Sulpice ne fit aucune difficulté de le reconnaître, et il s’en expliqua nettement dans les Lettres et les Dialogues. Ce n’est cependant, selon l’aveu même de Sulpice, qu’un abrégé de la vie de saint Martin ; beaucoup de faits merveilleux ont été passés sous silence. Nous n’acceptons pas l’excuse qu’il en donne ; si ses contemporains avaient eu peine à les croire, la postérité les aurait accueillis avec édification. Nous regrettons donc vivement cette fausse réserve de notre auteur. De son temps on s’en plaignit hautement, et ces plaintes arrivèrent à son oreille. Afin de réparer ces omissions, Sulpice écrivit ses Lettres et ses Dialogues. On y trouve, en effet, la narration de plusieurs traits omis dans la Vie. Rien n’est plus édifiant que la longue lettre adressée à Bassula, sa belle-mère, où il raconte la mort de saint Martin en termes si touchants. L’Église en a tiré la plus grande partie de l’office du saint évêque de Tours.
On a pensé avec raison que les écrits de Sulpice Sévère relatifs à saint Martin, écrits dont la lecture fit les délices de ses contemporains, et fait encore le charme de tous les dévots serviteurs du patron des Gaules ; seraient lus avec plaisir et profit, par ceux qui ignorent la langue latine, dans une traduction élégante et fidèle, où l’on s’est appliqué à conserver, autant que possible, le caractère du texte original. Beaucoup de personnes aimeront à parcourir les pages mêmes de Sulpice Sévère, au lieu de s’arrêter, aux commentaires plus ou moins ingénieux des historiens modernes. Les eaux sont toujours plus vives et plus pures à la source, que dans des ruisseaux éloignés, quand même les rives en seraient émaillées de fleurs. Les goûts, d’ailleurs, sont variés, et les fidèles seront heureux, nous n’en doutons pas, de pouvoir se procurer la traduction d’un ouvrage aussi solide qu’attrapant. Qu’il nous soit permis ici de féliciter sincèrement l’auteur de cette traduction, M. Richard Viot, qui a fait preuve à la fois de bon goût et de zèle pour le culte de l’illustre évêque de Tours.
Nous formons tous des vœux ardents pour que la dévotion envers saint Martin se propage de plus en plus. La puissance de ce grand pontife auprès de Dieu n’est pas diminuée c’est toujours le thaumaturge et le patron des Gaules. Tous ceux qui l’invoquent avec confiance éprouvent. les effets de son intercession miséricordieuse.
A Tours, le 11 mai 1861, fête de la Subvention de saint Martin.
J.-J. BOURASSÉ, chanoine.
texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER
Sévère, à son cher frère Didier, salut :
Redoutant les jugements des hommes, et retenu par une timidité naturelle, j’avais l’intention de garder en manuscrit et de ne pas laisser sortir de chez moi le petit livre. que j’ai écrit sur la vie de saint Martin. Je craignais que mon style peu élégant ne déplut aux lecteurs, et ne me fît encourir le blâme universel ; car je m’emparais d’un sujet réservé à de savants écrivains, mais je n’ai pu résister à tes instances. Que ne sacrifierai je, en effet, à ton amitié, même en m’exposant à la honte ! J’ai cependant écrit ce livre, me fiant à la promesse que tu m’as faite, de ne le livrer à personne. Je crains cependant que tu ne lui ouvres la porte, et qu’une fois lancé, il ne puisse plus être rappelé. S’il en était ainsi, et si quelques personnes le lisaient, supplie-les d’attacher plus d’importance aux faits qu’aux mots, et de supporter patiemment les défauts de style qui pourraient les choquer, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans l’éloquence, mais dans la foi ; qu’ils se souviennent aussi que la doctrine du salut n’a pas été annoncée au monde par des orateurs, mais par des pécheurs ; bien que si cela eût été utile, le Seigneur eût pu le faire ainsi.
Lorsque pour la première fois je me décidai à écrire, dans la pensée. qu’il n’était pas permis de tenir cachées Ies vertus d’un si. grand homme, je pris le parti de ne pas rougir des solécismes qui pourraient m’échapper : car je ne suis pas très savant en ces sortes de choses, et j’ai oublié, pour ne pas m’y être exercé depuis fort longtemps, le peu que j’en savais autrefois. Enfin, pour ne pas prolonger ces excuses importunes, si tu le juges convenable, publie ce livre sans y joindre mon nom ; pour, cela, efface-le du titre, afin qu’il annonce le sujet sans indiquer l’auteur, ce qui sera suffisant.
VIE DE SAINT MARTIN
I. — La plupart de ceux qui ont écrit la vie des hommes illustres, exclusivement occupés de la poursuite d’une gloire toute mondaine, ont espéré par là s’immortaliser. Sans avoir complètement réussi, ils ont atteint leur but en partie ; car, tout en acquérant une vaine renommée, les beaux exemples qu’ils racontaient de ces hommes remarquables excitaient une grande émulation parmi leurs lecteurs. Mais ce soin qu’ils prenaient de la gloire de leurs héros, n’avait point pour butta bienheureuse et éternelle vie. Car, à quoi leur a servi cette gloire qui doit périr avec leurs écrits, et quel avantagea retiré la postérité de la lecture des combats d’Hector ou des disputes philosophiques de Socrate, puisque c’est une folie de les imiter, et même de ne pas les combattre avec énergie ? Ne considérant dans la vie que le présent, ils se sont nourris de mensonges, et ont enfermé leurs âmes dans la nuit du tombeau. Ils ont pensé seulement à s’immortaliser dans la mémoire des hommes, tandis que tout homme doit plutôt travailler à acquérir la vie éternelle qu’à perpétuer sa mémoire sur cette terre, non par des écrits, des luttes ou des disputes philosophiques, mais en menant une vie pieuse et sainte. Cette erreur, transmise d’âge en âge par les écrits des littérateurs, a tellement prévalu, qu’il s’est rencontré beaucoup de partisans de cette philosophie insensée et de ce vain mérite. Je crois donc avoir fait quelque chose d’utile en écrivant la vie de ce saint homme ; elle servira d’exemple à mes lecteurs, et les excitera à acquérir la véritable sagesse, à combattre pour le ciel, et à mériter la force d’en haut. En cela, je trouve aussi mon intérêt, espérant obtenir de Dieu une récompense et non des hommes un vain souvenir ; car, si je n’ai pas vécu de manière à être proposé aux autres comme un modèle, je me suis du moins appliqué à faire connaître celui qui mérite cet honneur. Je vais donc commencer à écrire la vie de saint Martin, et à dire comment il s’est conduit, soit avant, soit pendant son épiscopat, bien que je ne sois pas parvenu à connaître toutes les particularités de sa vie et les faits dont il là le seul témoin, puisque, ne cherchant pas la gloire qui vient des hommes, il s’efforça toujours de tenir ses vertus cachées. J’ai même omis quelques-uns des faits que je connaissais, persuadé qu’il était suffisant de parler des plus remarquables, et que pour mes lecteurs trop de matières causerait peut-être de l’ennui. Je supplie ceux qui me liront d’ajouter foi à mes récits, et d’être convaincus que je n’ai écrit que des faits certains et avérés ; d’ailleurs, mieux vaut se taire que de mentir.
II. — Martin naquit à Sabarie[i][i], en Pannonie, de parents assez distingués, mais païens ; il fut élevé à Ticinum[ii][ii], ville d’Italie. Son père fut d’abord soldat, puis devint tribun militaire. Martin embrassa encore jeune la carrière des armes, et servit dans la cavalerie d’abord sous Constance, puis sous Julien César ; non par goût cependant, car, dès ses premières années, cet illustre enfant ne respirait que le service de Dieu. N’ayant encore que dix ans, il se rendit à l’église, malgré ses parents, et demanda à être mis au nombre des catéchumènes. Bientôt après il se donna tout entier au service de Dieu ; et, quoiqu’il n’eut encore que douze ans il désirait passer sa vie dans la retraite. Il aurait même exécuté ce projet, si la faiblesse de son âge ne s’y fait opposée ; mais son âme, toujours occupée de solitudes et d’églises, lui faisait déjà projeter, dès l’âge le plus tendre, ce qu’il exécuta plus tard avec tant d’ardeur. Lorsque les empereurs eurent ordonné que les fils des vétérans entrassent dans l’armée, son père lui-même, qui ne voyait pas d’un œil favorable ces heureux commencements, le présenta pour le service militaire ; ainsi, n’ayant encore que quinze ans, il fut enrôlé et prêta le serment. À l’armée, Martin se contenta d’un seul valet, que bien souvent, intervertissant les rôles, il servait lui-même : il allait jusqu’à lui ôter ses chaussures et à les nettoyer ; ils prenaient leur repas ensemble, et le plus souvent c’était le maître qui servait. Il passa environ trois ans à l’armée avant de recevoir le baptême, et il se préserva des vices si communs parmi les gens de guerre. Sa bienveillance et sa charité envers ses compagnons d’armes. étaient admirables, sa patience et son humilité surhumaines. Il est inutile de louer sa sobriété : il pratiqua cette vertu à un tel degré, que déjà à cette époque on le prenait plutôt pour un moine que pour un soldat ; aussi s’était-il tellement attaché ses compagnons, qu’ils avaient pour lui le plus affectueux respect. Martin, quoique n’étant pas encore régénéré en Jésus-Christ, montrait déjà par ses bonnes œuvres qu’il aspirait au baptême ; car il consolait les malheureux, secourait les pauvres, nourrissait les nécessiteux, donnait des vêtements à ceux qui en manquaient, et ne gardait de sa solde que ce qu’il lui fallait pour sa nourriture de chaque jour : déjà strict observateur des paroles de l’Évangile, il ne songeait pas au lendemain.
III. — Un jour, au milieu d’un hiver dont les rigueurs extraordinaires avaient fait périr beaucoup de personnes, Martin, n’ayant que ses armes et son manteau de soldat, rencontra à la porte d’Amiens un pauvre presque nu. L’homme de Dieu, voyant ce malheureux implorer vainement la charité des passants qui s’éloignaient sans pitié, comprit que c’était à lui que Dieu l’avait réservé. Mais que faire ? il ne possédait que le manteau dont il était revêtu, car il avait donné tout le reste ; il tire son épée, le coupe en deux, en donne la moitié au pauvre et se revêt du reste. Quelques spectateurs se mirent à rire en voyant ce vêtement informe et mutilé ; d’autres, plus sensés, gémirent profondément de n’avoir rien fait de semblable, lorsqu’ils auraient pu faire davantage, et revêtir ce pauvre sans se dépouiller eux-mêmes. La nuit suivante, Martin s’étant endormi vit Jésus-Christ[iii][iii] revêtu de la moitié du manteau dont il avait couvert la nudité du pauvre ; et il entendit une voix qui lui ordonnait de considérer attentivement le Seigneur et de reconnaître le vêtement qu’il lui avait donné. Puis Jésus se tournant vers les anges qui l’entouraient leur dit d’une voix haute : « Martin n’étant encore que catéchumène m’a revêtu de ce manteau. » Lorsque le Seigneur déclara qu’en revêtant le pauvre, Martin l’avait vêtu lui-même, et que, pour confirmer le témoignage qu’il rendait à une si bonne action, il daigna se montrer revêtu de l’habit donné au pauvre, il se souvenait de ce qu’il avait dit autrefois : « Tout ce que vous avez fait au moindre des pauvres vous me l’avez fait à moi-même. » Cette vision ne donna point d’orgueil au bienheureux ; mais, reconnaissant avec quelle bonté Dieu le récompensait de cette action, il se hâta de recevoir le baptême, étant âgé de dix-huit ans. Cependant il ne quitta pas aussitôt le service ; il céda aux prières de son tribun, avec qui il vivait dans la plus intime familiarité, et qui lui promettait de renoncer au monde aussitôt que le temps de son tribunat serait écoulé. Martin, se voyant ainsi retardé dans l’exécution de ses projets, resta sous les drapeaux et demeura soldat, seulement de nom, il est vrai, pendant les deux années qui suivirent son baptême.
IV. — Cependant, les barbares ayant fait irruption dans les Gaules, le César Julien rassembla toute son armée près de Worms, et distribua des largesses aux soldats, qui, selon la coutume, étaient appelés les uns après les autres. Vint le tour de Martin, qui crut le moment favorable pour demander son congé ; car il lui semblait qu’il ne serait pas juste, n’ayant plus l’intention de servir, de recevoir les largesses de l’empereur. « Jusqu’ici, dit-il, je vous ai servi, César ; permettez que je serve Dieu maintenant : que ceux qui doivent combattre acceptent vos dons ; moi, je suis soldat du Christ, il ne m’est plus permis de combattre. » À ces paroles, le tyran frémit de colère, et lui dit que c’était la crainte de la bataille qui allait se livrer le lendemain, et non la religion qui le portait à refuser de servir. Mais l’intrépide Martin, que le soupçon de lâcheté rendait plus ferme encore, répondit : « Si l’on attribue ma résolution à la peur et non à ma foi, demain je me présenterai sans armes devant l’armée ennemie, et au nom du Seigneur Jésus, armé du signe de la croix, et non du casque et du bouclier, je m’élancerai sans crainte, au milieu des bataillons ennemis. » Julien le fit aussitôt conduire en prison, et ordonna de l’exposer le lendemain sans armes devant l’ennemi, selon ses désirs. Le jour suivant, les ennemis envoyèrent des ambassadeurs pour traiter de la paix, se rendirent, et livrèrent tout ce qu’ils possédaient.
Qui doutera que cette victoire, ne soit due au saint homme, que le Seigneur ne voulait point envoyer sans armes au combat ? Et quoique ce bon maître eût bien la puissance de protéger son soldat, même contre les épées et les traits ennemis ; cependant, pour que ses yeux ne fussent pas même souillés de la vue du sang, il empêcha le combat. En effet, si le Christ devait accorder la victoire en faveur de son soldat, ce ne pouvait être qu’en empêchant toute effusion de sang par la soumission volontaire de l’ennemi, sans qu’il en coûtât la vie à personne.
V. — Dans la suite, ayant quitté le service, Martin se rendit auprès de saint Hilaire, évêque de Poitiers ; homme dont la foi vive était connue et admirée de tout le monde ; il y resta quelque temps. Hilaire voulut le faire diacre pour se l’attacher plus étroitement et le consacrer au service des autels ; mais Martin avait souvent refusé, disant hautement qu’il en était indigne. Hilaire, dans sa sagesse, vit bien qu’il ne se l’attacherait qu’en lui conférant un emploi ; dans lequel il semblerait ne pas lui rendre justice ; il voulut donc qu’il fût exorciste. Martin ne refusa point cet ordre, de peur de paraître le mépriser, à cause de son infériorité. Quelque temps après, Dieu lui ayant ordonné en songe d’aller dans sa patrie visiter ses parents encore païens, pour s’occuper de leur conversion avec une pieuse sollicitude, saint Hilaire lui accorda la permission de s’éloigner ; mais, à force de prières et de larmes, il obtint de lui la promesse de revenir. Il était plein de tristesse, dit-on, quand il entreprit ce voyage, et il assura à ses frères qu’il y aurait beaucoup à souffrir : ce qui arriva effectivement. S’étant d’abord égaré dans les Alpes, il rencontra des voleurs ; l’un d’eux le menaça d’une hache qu’il brandissait au-dessus de sa tête, un autre détourna le coup ; on lui lia ensuite les mains derrière le dos, et il fut livré à l’un de ces brigands pour être gardé et dépouillé. Ce voleur le conduisit dans un endroit plus retiré encore, et lui demanda qui il était. « Je suis chrétien, » répondit Martin ; il lui demanda ensuite s’il avait peur ; Martin répondit alors avec courage qu’il n’avait jamais été plus tranquille, parce qu’il savait que la miséricorde du Seigneur ne lui ferait jamais défaut, surtout dans les épreuves, et que c’était plutôt lui qu’il plaignait, puisque le brigandage auquel il se livrait le rendait indigne de la miséricorde de Dieu. Puis, commençant à développer la doctrine de l’Évangile ; il prêcha au voleur la parole de Dieu. Qu’ajouter à cela ? Le voleur crut en Jésus-Christ, accompagna Martin qu’il remit dans son chemin, en se recommandant à ses prières. Dès lors il mena, dit-on, une vie sainte, et l’on croit même que c’est de sa bouche que l’on a recueilli les détails précédents.
VI. — Martin, poursuivant sa route, avait dépassé Milan, lorsque le démon, sous une forme humaine, se présenta devant lui et lui demanda où il allait. « Je vais où le Seigneur m’appelle, » répliqua Martin. Satan lui dit alors : « Partout où tu iras, dans toutes tes entreprises, le diable s’opposera à tes desseins. » Martin lui répondit avec ces paroles du Prophète : « Le Seigneur est mon appui, je n’ai rien à craindre des hommes. » Son ennemi disparut aussitôt. Selon son espérance, il retira sa mère des ténèbres du paganisme, mais son père persévéra dans l’erreur ; ses bons exemples convertirent partout plusieurs personnes. L’hérésie d’Arius s’était répandue dans tout l’univers, et surtout en Illyrie ; Martin, qui presque seul combattait vaillamment la perfidie des prêtres hérétiques, souffrit beaucoup d’outrages (car il fut publiquement battu de verges, et enfin chassé de la ville). Il retourna en Italie ; mais ayant alors appris que l’Église était également agitée dans les Gaules, à cause du départ de saint Hilaire, que les hérétiques avaient contraint de s’exiler, il alla à Milan, où il se fit une solitude. Là aussi Auxence, fauteur et chef du parti arien, le persécuta à outrance, l’accabla d’outrages et le chassa de la ville. Martin, pensant qu’il fallait céder aux circonstances, se retira avec un prêtre très vertueux dans l’île Gallinaria[iv][iv] ; il y vécut pendant quelque temps de racines, et, selon la tradition, ce fut là qu’il mangea de l’ellébore, plante vénéneuse. Sentant le poison s’insinuer dans ses veines et la mort s’approcher, il conjura par la prière ce péril imminent, et la douleur cessa aussitôt. Peu de temps après, ayant appris que l’empereur, regrettant, ce qu’il avait fait, accordait à saint Hilaire la permission de revenir, il se rendit à Rome, dans l’espérance de l’y rencontrer.
VII. — Mais saint Hilaire avait déjà quitté cette ville ; Martin le suivit, et, en ayant été revu avec la plus grande bonté, il se fit une solitude près de Poitiers[v][v]. Sur ces entrefaites, un catéchumène, désirant être instruit- par un si saint homme, se joignit à lui ; mais peu de jours après il fut pris de la fièvre. Martin était alors absent par hasard. Cette absence se prolongea trois jours encore, et à son retour il le trouva mort. L’événement avait été si soudain, qu’il avait quitté la terre n’ayant pas encore recru le baptême. Le corps était placé au milieu de la chambre, où les frères se succédaient sans cesse pour lui rendre leurs devoirs, lorsque Martin accourut, pleurant et se lamentant. Implorant alors avec ardeur la grâce de l’Esprit Saint, il fait sortir tout le monde, et s’étend sur le cadavre du frère. Après avoir prié avec ferveur pendant quelque temps, averti par l’Esprit du Seigneur que le miracle va s’opérer, il se soulève un peu, et, regardant fixement le visage du défunt, il attend avec confiance l’effet de sa prière et de la miséricorde divine. À peine deux heures s’étaient-elles écoulées, qu’il vit tous les membres du défunt s’agiter faiblement ; et les yeux s’entrouvrir. Alors Martin rend grâces à Dieu à haute voix, et fait retentir la cellule des accents de sa joie. À ce bruit, ceux qui se tenaient au dehors rentrent précipitamment, et (ô spectacle admirable !) ils trouvent plein de vie celui qu’ils avaient laissé inanimé. Ce catéchumène, revenu à la vie, fut aussitôt baptisé, et vécut encore plusieurs années. Le premier parmi nous il donna à Martin l’occasion d’exercer sa puissance, et resta en quelque sorte la preuve vivante de ce miracle. Il nous racontait souvent qu’après avoir quitté son corps, son âme avait comparu devant le tribunal du Juge, et qu’il y avait entendu la triste sentence qui le condamnait à habiter des lieux obscurs avec une foule d’autres âmes ; mais alors deux anges firent connaître au Juge qu’il était celui pour lequel Martin priait : ils reçurent aussitôt l’ordre de le ramener et de le rendre à la vie et à Martin. Ce miracle rendit le nom de Martin très célèbre, et ceux qui déjà le considéraient comme un saint, le regardèrent alors comme un homme puissant et vraiment apostolique.
VIII. — Peu de temps après, Martin, traversant les terres d’un certain Lupicin, homme honorable selon le monde, entendit les pleurs et les lamentations d’un grand nombre de personnes. Inquiet, il s’arrête ; il demande la cause de ces gémissements ; il apprend qu’un des esclaves vient de se pendre. Il entre aussitôt dans la chambre où était le corps, fait sortir tout le monde s’étend sur le cadavre, et prie pendant quelque temps. Bientôt le visage de l’esclave s’anime, il élève vers Martin des yeux languissants, et, ayant fait de lents et inutiles efforts pour se soulever, il saisit la main du Saint, se dresse sur ses pieds, puis s’avance avec lui dans le vestibule de la maison, à la vue de tout le peuple.
IX. — C’est à peu près à cette époque que la ville de Tours demanda saint Martin pour évêque ; mais comme il n’était pas facile de le faire sortir de sa solitude, un des citoyens de la ville, nommé Ruricius, se jeta à ses pieds, et, prétextant la maladie de sa femme, le détermina à sortir. Un grand nombre d’habitants sont échelonnés sur la route ; ils se saisissent de Martin, et, le conduisent à Tours, sous bonne garde. Là, une multitude immense, venue non seulement de Tours mais des villes voisines, s’était réunie afin de donner son suffrage pour l’élection. L’unanimité des désirs, des sentiments et des votes, déclara Martin le plus digne de l’épiscopat, et l’Église de Tours heureuse de posséder un tel pasteur. Un petit nombre cependant, et même quelques évêques convoqués pour élire le nouveau prélat, s’y opposaient, disant qu’un homme d’un extérieur si négligé, de si mauvaise mine, la tête rasée et si mal vêtu, était indigne de l’épiscopat. Mais le peuple, ayant des sentiments plus sages, tourna en ridicule la folie de ceux qui, en voulant nuire à cet homme illustre, ne faisaient qu’exalter ses vertus. Les évêques furent donc obligés de se rendre au désir du peuple, dont Dieu se servait pour faire exécuter ses desseins. Parmi ceux qui s’opposaient à l’élection, il y avait un certain Défensor : on verra qu’il fut pour cette raison sévèrement blâmé par les paroles du Prophète ; car celui qui devait faire la lecture ce jour-là, n’ayant pu pénétrer à cause de la foule, les prêtres se troublèrent, et l’un d’eux, ne voyant point venir le lecteur, prit le Psautier, et lut le premier verset qui lui tomba sous les yeux ; c’était celui-ci : « Vous avez tiré une louange parfaite de la bouche des enfants ; et de ceux qui sont encore à la mamelle, pour confondre vos adversaires, et pour perdre votre ennemi et son défenseur. » À ces paroles, le peuple pousse un cri ; les ennemis de Martin sont confondus. On resta convaincu que Dieu avait permis qu’on lut ce psaume, afin que Défensor y vit la condamnation de sa faute ; car c’est de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle que Dieu, en Martin, a tiré la louange la plus parfaite, et l’ennemi à été détruit aussitôt qu’il s’est montré.
X. — Nous n’avons point assez de talent pour raconter ce que fut Martin devenu évêque ; il demeura toujours ce qu’il avait été auparavant ; aussi humble de cœur, aussi simple dans sa manière de s’habiller. Il remplissait ses fonctions d’évêque d’une manière pleine d’autorité et de bonté, sans cesser pour cela de vivre comme un moine, et d’en pratiquer les vertus. Pendant quelque temps il habita une petite cellule près de l’église ; mais, importuné du grand nombre de visites qu’il y recevait ; il se fit une solitude[vi][vi] à peu près à deux milles de la ville. Cet endroit était si caché et si retiré, qu’il ressemblait à un désert. Il était ; renfermé d’un côté par un rocher haut et escarpé, de l’autre par une sinuosité du cours de la Loire, qui y formait ainsi une petite vallée ; on ne pouvait y aborder que par un sentier fort étroit. Saint Martin habitait une cabane de bois ; quelques frères en avaient de semblables, d’autres s’étaient creusé des cellules dans le roc. Il y avait là quatre-vingts disciples, qui s’y formaient sur les exemples de leur bienheureux maître. Aucun d’eux n’y possédait rien en propre, tout était en commun ; ils ne pouvaient ni vendre ni acheter, comme le font, ordinairement la plupart des moines. On ne s’occupait d’aucun art, si ce n’est de celui de copier des livres : encore cet emploi était-il réservé aux plus jeunes, les plus âgés vaquaient à l’oraison ; ils sortaient rarement de leur cellule, excepté lorsqu’ils se réunissaient pour la prière ; ils prenaient leurs repas ensemble quand l’heure de rompre un jeûne était arrivée, et ils ne buvaient point de vin ; à moins qu’ils ne fussent malades. La plupart portaient des habits de poils de chameau, c’était un crime de se vêtir plus délicatement. Ce qui rend cela plus admirable, c’est que plusieurs d’entre eux étaient des hommes de qualité, qui, élevés d’une manière bien différente, s’étaient astreints à cette vie d’humilité et de souffrance. Dans la suite, nous en avons vu plusieurs devenus évêques ; et quelle ville, ou quelle Église, ne se réjouirait pas d’avoir, un évêque sorti du monastère de saint Martin ?
XI. — Je vais maintenant raconter les miracles qu’il fit pendant son épiscopat. À peu de distance de la ville et non loin du monastère, se trouvait un endroit que l’on regardait à tort comme le lieu de la sépulture de plusieurs martyrs, qui y recevaient un culte, car l’érection de l’autel était attribuée aux évêques précédents. Mais Martin, n’ajoutant point foi légèrement à des traditions incertaines, demanda aux plus anciens des prêtres et des clercs de lui dire le nom du prétendue saint et l’époque de son martyre. Il était fort inquiet à ce sujet puisque la tradition ne rapportait rien de bien avéré. Pendant quelque temps il s’abstint d’aller à cet endroit, ne voulant pas porter atteinte à ce culte tant qu’il serait dans l’incertitude, ni l’autoriser de peur de favoriser une superstition. Prenant un jour avec lui quelques-uns des frères, il s’y rendit, et, se tenant sur le sépulcre. Il pria le Seigneur de lui faire connaître quel homme avait été enterré dans ce lieu, et quels pouvaient être ses mérites. Alors il voit se dresser à sa gauche un spectre affreux et terrible. Martin lui ordonne de déclarer qui il est et quels sont ses mérites devant le Seigneur : le spectre se nomme, avoue ses crimes, dit qu’il est un voleur, mis à mort pour ses forfaits et honoré par une erreur populaire ; qu’il n’a rien de commun avec les martyrs, qui sont dans la gloire, tandis qu’il est dans les tourments. Ceux qui étaient présents entendirent cette voix étrange sans voir personne. Martin leur dit alors, ce qu’il a vu, ordonne qu’on enlève l’autel, et délivre ainsi le peuple de cette erreur et de cette superstition.
XII. — Quelque temps après, Martin, dans un de ses voyages, rencontra le convoi funèbre d’un païen qu’on portait en terre, avec des cérémonies superstitieuses. Voyant de loin cette foule qui s’avançait, et ne sachant ce que c’était, il s’arrêta un instant ; car, se trouvant à peu près à cinq cents pas de distance, il lui était difficile de rien distinguer. Cependant, comme il voyait une troupe de paysans, et que le vent faisait voltiger les linges blancs qui recouvraient, le corps, il crut qu’on accomplissait quelque rite profane et superstitieux : car les paysans, dans leur aveuglement insensé, ont l’habitude de porter autour de leurs champs les images des démons recouvertes d’étoffes blanches. Élevant donc la main, il fait le signe de la croix, commande à la foule de s’arrêter et de déposer le fardeau. À l’instant même ils demeurent immobiles comme des pierres ; puis, faisant un violent effort pour continuer leur marche, ils se mettent à tourner ridiculement sur eux-mêmes, jusqu’à ce que épuisés par le poids qu’ils portent, ils déposent le corps. Étonnés, ils se regardent les uns les autres en silence, et se demandent à eux-mêmes quelle peut être la cause de l’accident qui leur arrive. Mais le bienheureux, ayant reconnu que cette foule n’était point réunie pour un sacrifice, mais pour des funérailles, éleva de nouveau la main, et leur permit de s’éloigner et d’emporter le corps du défunt. C’est ainsi que Martin, suivant sa volonté, ou les força de s’arrêter, ou leur permit de reprendre leur marche.
XIII — Dans un bourg se trouvait un temple fort ancien, que Martin avait détruit, et il se disposait à abattre un pin qui en était proche, lorsque le prêtre de cet endroit et toute la foule des païens s’y opposèrent ; et ces mêmes hommes, qui, par la permission de Dieu, avaient laissé, sans y mettre obstacle, démolir leur temple, ne pouvaient souffrir qu’on abattît l’arbre. Martin faisait tous ses efforts pour leur faire comprendre que ce tronc d’arbre n’avait rien de sacré, qu’ils devaient plutôt adorer le Dieu qu’il servait lui-même, que cet arbre consacré au démon devait être abattu. Alors l’un deux, plus audacieux que les autres, lui dit : «. Si tu as quelque confiance dans le Dieu que tu sers, nous abattrons, nous-mêmes cet arbre ; consens à le laisser tomber sur toi, et si, comme tu le dis, tu es protégé par ton Dieu, tu : n’éprouveras aucun mal. »
Martin n’est nullement effrayé de cette proposition, et se confiant dans le Seigneur ; il promet de faire ce gnon demande ; toute : la foule des païens consent à cette condition, et se résigne à la perte de l’arbre, si sa chute doit écraser l’ennemi de leurs dieux. Le pin penchait tellement d’un côté, que personne ne doutait du lieu où il devait tomber. Martin fut attaché dans cet endroit, suivant la volonté des paysans : ceux -ci, transportés de joie, se mirent aussitôt à l’œuvre. La foule stupéfaite se tient à une grande distance. Déjà le pin vacille, et son ébranlement annonce sa chute. De loin les moines pâlissent de crainte, et, consternés du péril imminent, ils ont déjà perdu tout espoir et toute confiance, et n’attendent plus que la mort de Martin. Mais celui-ci, se confiant dans le Seigneur, demeure ferme et exempt de toute crainte. Tout à coup le pin éclate avec fracas, tombe, et se précipite sur Martin, qui, élevant la main, lui oppose le signe du salut. Aussitôt, comme s’il eût été repoussé par un tourbillon impétueux, l’arbre se retourne et va tomber de l’autre côte, où il manque de renverser les paysans qui s’y croyaient fort en sûreté. Les païens, frappés de ce miracle, poussent de grands cris ; les moines pleurent de joie ; les louanges du Christ sont dans toutes les bouches. Ce jour-là fut assurément un jour de salut pour ce pays : car il n’y eut personne, dans cette immense multitude de païens, qui ne demandât aussitôt l’imposition des mains, et qui, abjurant les erreurs du paganisme, ne crût en Jésus-Christ. En effet, avant l’arrivée de Martin, presque personne ne connaissait le nom de Jésus-Christ dans ce pays. Mais ses vertus et ses exemples y ont été si puissants, que cette contrée est maintenant couverte d’églises et de monastères. À peine un temple païen est-il détruit, que sur son emplacement s’élève une église ou un couvent.
XIV. — À peu près vers la même époque, Martin opéra un miracle semblable. Dans un bourg se trouvait un temple fort ancien, auquel il avait mis le feu ; les flammes, poussées par le vent atteignirent une maison voisine, qui y était même attenante. Dès qu’il s’en aperçut, Martin monta rapidement sur le toit, et se présenta aux flammes comme un obstacle pour les arrêter. Alors vous auriez pu voir, par un miracle étonnant, les flammes repoussées contre la direction du vent, et ces deux éléments lutter en quelque sorte l’un contre l’autre. Ainsi, par la puissance de Martin, le feu n’agit que, dans l’endroit où il le lui permit. Martin voulant encore renverser un temple païen que la superstition avait rendu prodigieusement riche, et qui était situé dans un bourg nommé Leprosum[vii][vii], un grand nombre de païens s’opposèrent à son dessein, et le repoussèrent en l’accablant d’injures. C’est pourquoi il se retira dans un endroit voisin, et là, pendant trois jours, revêtu d’un cilice et couvert de cendres, jeûnant et priant, il suppliait le Seigneur de détruire ce temple par sa toute-puissance, puisque la main de l’homme n’avait pu le renverser. Tout à coup deux anges, armés de lances et de boucliers, comme les soldats de la milice céleste, se présentèrent à lui, et lui dirent qu’ils étaient envoyés par le Seigneur pour mettre en fuite cette troupe de paysans ; et le protéger, si on voulait lui résister pendant la destruction du temple ; qu’il y retournât donc pour accomplir avec ardeur l’œuvre qu’il avait commencée. Il revint donc au bourg, et à la vue de la foule des païens, sans qu’aucun d’eux s’y opposât, il détruisit le temple jusque dans ses fondements, et réduisit en poudre tous les autels et les idoles. À cette vue, les paysans, comprenant que c’était pour favoriser le dessein de l’évêque que la puissance divine les avait frappés d’effroi et de stupeur, crurent presque tous en Jésus-Christ, et confessèrent publiquement et à haute voix qu’il fallait adorer le Dieu de Martin, et rejeter les idoles qui ne pouvaient leur être d’aucun secours.
XV — Je vais raconter maintenant ce qu’il fit dans un bourg des Éduens[viii][viii]. Pendant qu’il y renversait encore un temple de la même manière, une multitude de païens furieux se précipita sur lui, l’épée à la main. Martin, rejetant son manteau présenta son cou nu à l’assassin. Le païen n’hésite pas ; mais, au moment où il élève le bras, il tombe à la renverse, et, saisi d’une frayeur miraculeuse, il demande pardon. Voici encore un fait du même genre : Martin était occupé à renverser des idoles, un païen voulut lui donner un coup de couteau ; au moment où il allait le frapper, le fer s’échappa de ses mains et disparut. La plupart du temps, lorsque les paysans s’opposaient à la destruction de leurs temples, il touchait tellement leurs cœurs en leur annonçant la parole de Dieu, qu’éclairés de la lumière de la vérité, ils les renversaient de leurs propres mains.
XVI. — Martin était si puissant pour la guérison des malades, que presque tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. L’exemple suivant en est la preuve. Il se trouvait à Trèves une jeune fille atteinte d’une paralysie si complète, que tous ses membres, depuis longtemps, lui refusaient leur service ; ils étaient déjà comme morts, et elle ne tenait plus à la vie que par un souffle. Ses parents accablés de tristesse, étaient là n’attendant plus que sa mort, lorsqu’on apprit que Martin venait d’arriver dans la ville. Aussitôt, que le père de la jeune fille en est instruit, il y court tout tremblant, et implore Martin pour sa fille mourante. Par hasard le saint évêque était déjà entré dans l’église ; là, en présence du peuple et de beaucoup d’autres évêques, le vieillard, poussant des cris de douleur, embrasse ses genoux, et lui dit : « Ma fille se meurt d’une maladie terrible, et ce qu’il y a de plus affreux, c’est que ses membres, bien qu’ils vivent encore, sont comme morts et privés de tout mouvement. Je vous supplie de venir la bénir, car j’ai la ferme confiance, que vous lui rendrez la santé. » Martin, étonné de ces paroles qui le couvrent de confusion, s’excuse, en disant qu’il n’a pas ce pouvoir, que le vieillard se trompe, et qu’il n’est pas digne que le Seigneur se serve de lui pour faire un miracle. Le père, tout en larmes, insiste plus vivement encore, et le supplie de visiter sa fille mourante. Martin se rend enfin aux prières des évêques présents, et vient à la maison de la jeune fille. Une grande foule se tient à la porte, attendant ce que le serviteur de Dieu va faire. Et d’abord, ayant recours à ses armes ordinaires, il se prosterne à terre et prie ; ensuite, regardant la malade, il demande de l’huile ; après l’avoir bénite, il en verse une certaine quantité dans la bouche de la jeune fille, et la voix lui revient aussitôt ; puis, peu à peu, par le contact de la main de Martin, ses membres, les uns après les autres, commencent à reprendre la vie ; enfin, ses forces reviennent, et elle peut se tenir debout devant le peuple.
XVII. — À la même époque, Tétradius, personnage consulaire, avait un esclave possédé du démon, et qui allait faire une fin déplorable. On pria Martin de lui imposer les mains, et il se le fit amener. Mais on ne put faire sortir le possédé de la cellule, car il mordait cruellement ceux qui s’en approchaient. Alors Tétradius, se jetant aux pieds de Martin, le supplia de venir lui-même dans la maison où se trouvait le démoniaque ; mais il refusa, disant qu’il ne pouvait entrer dans la demeure d’un profane, et d’un païen. Tétradius était encore plongé dans les erreurs du paganisme ; mais il promit de se faire chrétien, si son serviteur était délivré du démon. C’est pourquoi Martin imposa les mains à l’esclave, et en chassa l’esprit immonde. À cette vue, Tétradius crut en Jésus-Christ. Il fut aussitôt fait catéchumène, baptisé peu de temps après, et depuis lors il eut toujours un respect affectueux pour Martin, l’auteur de son salut. Vers la même époque et dans la même ville, Martin, étant entré dans la maison d’un père de famille, s’arrêta sur le seuil, disant qu’il voyait un affreux démon dans le vestibule. Au moment où Martin lui commandait de sortir, il s’empara d’un esclave qui se trouvait dans l’intérieur de la maison ; ce malheureux se mit aussitôt à mordre et à déchirer tous ceux qui se présentaient à lui. Toute la maison est dans le trouble et l’effroi ; le peuple prend la fuite. Martin s’avance vers le furieux, et lui commande d’abord de s’arrêter ; mais il grinçait des dents, et, ouvrant la bouche, menaçait de le mordre ; Martin y met ses doigts : « Dévore-les, si tu en as le pouvoir, » lui dit-il. Alors le possédé, comme si on lui eut plongé un fer rouge dans la gorge, recula pour éviter de toucher les doigts du Saint. Enfin le diable, forcé par les souffrances et les tourments qu’il endurait de quitter le corps de l’esclave, et ne pouvant sortir par sa bouche, s’échappa par les voies inférieures, en laissant des traces dégoûtantes de son passage.
XVIII. — Cependant le bruit d’une attaque des barbares ayant inquiété les habitants de la ville, Martin se fit amener un démoniaque, et lui commanda de dire si cette nouvelle était vraie. Celui-ci, avoua qu’ils étaient dix démons qui faisaient courir ce bruit parmi le peuple, afin, du moins, que la crainte fit sortir Martin de la ville ; les barbares n’avaient aucunement l’intention de faire une irruption. L’esprit immonde, ayant fait cet aveu au milieu de l’église, délivra la cité de la crainte et du trouble qui l’agitaient. Un jour qu’il entrait à Paris, comme il passait par une des portes de cette cité, avec une grande foule de peuple, il bénit et baisa un lépreux dont la figure affreuse faisait horreur à tous ; celui-ci fut aussi tôt guéri et vint le lendemain à l’église, avec un visage, sain et vermeil rendre grâces à Dieu pour la santé qu’il avait recouvrée. Mais ce que nous ne pouvons nous dispenser de dire c’est que les fils des vêtements ou du cilice de Martin opérèrent de fréquentés guérisons ; appliqués aux doigts ou au cou des malades, ils les délivraient de leurs infirmités.
XIX — Arborius, ancien préfet, homme plein de foi et de piété, dont la fille était affectée d’une fièvre quarte très violente, lui mit sur la poitrine une lettre de Martin, qui lui était tombée par hasard entre les mains, et aussitôt la fièvre cessa. Cette guérison toucha tellement Arborius, qu’il consacra sur-le-champ sa fille, à Dieu, et la voua à une virginité perpétuelle. Il partit ensuite pour aller trouver Martin, lui présenta sa fille qu’il avait guérie, quoique étant absent, comme une preuve vivante de ce miracle, et ne souffrit pas qu’un autre que Martin lui donnât le voile. Paulin, qui devait donner plus tard d’illustres exemples, fut attaqué d’un mal d’yeux qui le faisait beaucoup souffrir ; déjà la pupille de son œil se couvrait d’une taie. très épaisse. Martin lui toucha l’œil avec un pinceau ; aussitôt la douleur cessa, et il fut guéri. Un jour, Martin tomba lui-même d’un étage supérieur, en roulant sur les marches raboteuses de l’escalier ; et se fit plusieurs blessures. Étendu presque sans vie dans sa cellule, il éprouvait de cruelles souffrances, lorsque, pendant la nuit un ange lui apparut, lava ses blessures et oignit ses membres contusionnés d’un onguent salutaire, si bien que le lendemain, rendu à la santé, il ne paraissait avoir éprouvé aucun accident. Mais comme il serait trop long de raconter en détail tous les miracles de Martin, je me contenterai de rappeler les plus remarquables, pour épargner l’ennui que je pourrais causer au lecteur, si j’en rapportais un trop grand nombre.
XX. — Après des faits si grands, si merveilleux, en voici quelques autres qui sembleraient peu importants, si l’on ne devait pas placer au premier rang, surtout à notre époque où tout est dépravé et corrompu, la fermeté d’un évêque refusant de s’humilier jusqu’à aduler le pouvoir impérial. Quelques évêques étaient, venus de différentes contrées à la cour de l’empereur, Maxime, homme fier, et que ses victoires dans les guerres civiles avaient encore enflé, et ils s’abaissaient jusqu’à placer leur caractère sacré sous le patronage de l’empereur ; Martin, seul, conservait la dignité de l’apôtre. En effet, obligé d’intercéder auprès de l’empereur pour quelques personnes, il commanda plutôt qu’il ne pria. Souvent invité par Maxime à s’asseoir à sa table, il refusa, disant qu’il ne pouvait manger avec un homme qui avait détrôné un empereur et, en avait fait mourir un autre. Maxime lui assura que c’était contre son gré qu’il était monté sur le trône ; qu’il y avait été forcé ; qu’il n’avait employé les armes que pour soutenir la souveraineté que les soldats, sans doute par la volonté de Dieu, lui avaient imposée ; que la victoire si étonnante qu’il avait remportée prouvait bien que Dieu combattait pour lui, et que tous ceux de ses ennemis qui étaient morts n’avaient péri que sur le champ de bataille. Martin se rendit à la fin soit aux raisons de l’empereur, soit à ses prières, et vint à ce repas ; à la grande joie du prince qui avait obtenu ce qu’il désirait si ardemment. Les convives, réunis comme pour un jour de fête, étaient des personnages grands et illustres ; il y avait Évodius, en même temps préfet et consul, le plus juste des hommes, et deux comtes très puissants, l’un frère et l’autre oncle de l’empereur. Le prêtre qui avait accompagné Martin était placé entre ces deux derniers ; quant à celui-ci, il occupait un petit siége près de l’empereur. À peu près vers le milieu du repas, l’échanson, selon l’usage, présenta une coupe à l’empereur, qui ordonna de la porter au saint évêque ; car il espérait et désirait vivement la recevoir ensuite de sa main. Mais Martin, après avoir bu, passa la coupe à son prêtre, ne trouvant personne plus digne de boire le premier après lui, et croyant manquer à son devoir en préférât au prêtre soit l’empereur, soit le plus élevé en dignité après lui. L’empereur et tous les assistants admirèrent tellement cette action, que le mépris qu’il avait montré pour eux fût précisément ce qui leur plut davantage. Le bruit se répandit dans tout le palais que Martin avait fait à la table de l’empereur ce qu’aucun évêque n’aurait osé faire à la table des juges les moins puissants. Il prédit aussi à Maxime, longtemps avant l’événement, que s’il allait en Italie, comme il en avait l’intention, pour combattre l’empereur Valentinien, il serait d’abord victorieux, mais qu’il périrait peu de temps après. Nous avons vu que cette prophétie se vérifia ; car, dès que Maxime se présenta, Valentinien prit la fuite ; mais un an après, ayant réparé ses pertes, il tua Maxime, qu’il avait fait prisonnier dans Aquilée.
XXI. — C’est un fait constant que Martin vit souvent des anges s’entretenir, ensemble devant lui. Il voyait aussi le démon si clairement, qu’il le distinguait toujours par quelque signe sensible, soit qu’il voulut se renfermer dans sa propre substance, soit qu’il prît les formes diverses que revêt l’esprit de malice. Aussi, le diable, ne pouvant dissimuler sa présence, ni le tromper, l’accablait-il souvent d’outrages. Un jour, tenant une corne de bœuf ensanglantée, il entra précipitamment dans sa cellule avec de grands cris, lui montrant sa main dégouttante de sang ; et, faisant éclater la joie que lui causait le crime qu’il venait de commettre, il dit : « Martin, qu’est devenue ta puissance ? je viens de tuer l’un des tiens. » Aussitôt Martin, rassemblant les frères, leur raconte ce que vient de lui apprendre le démon, et leur ordonne d’aller examiner soigneusement dans chaque cellule quel est celui que ce malheur vient de frapper. Ils reviennent, et lui disent qu’aucun des moines ne manque, mais qu’un paysan, qu’on a loué pour transporter du bois sur un chariot, est parti pour la forêt. Il ordonne donc à quelques frères d’aller à sa rencontre. Étant partis, ils le trouvent, presque inanimé, non, loin du monastère. Sur le point d’expirer, il leur découvre la cause de sa mort et de ses blessures. « Pendant que, près de mes bœufs, je renouais le joug, dont les liens s’étaient relâchés, l’un d’eux, dégageant sa, tète, m’a donné un coup de corne dans l’aine. » Peu de temps après il expira ; il aura su sans doute par quel secret jugement le Seigneur, avait donné au démon une telle puissance : Ce qu’il y avait de merveilleux en Martin, c’est qu’il prédit aux frères non seulement l’événement que nous venons de rapporter, mais encore beaucoup d’autres du même genre.
XXII. — Le démon, usant de mille artifices pour tromper le saint homme, se présentait fréquemment à lui sous les formes les plus variées, quelquefois sous celle de Jupiter, la plupart du temps sous celle de Mercure, et même souvent de Vénus ou de Minerve. Martin luttait intrépidement contre lui, soutenu par le signe de la croix et la prière. On entendait très souvent dans sa cellule une troupe de démons l’insulter grossièrement ; mais, sachant que tout cela n’était qu’illusion et mensonge, il ne s’en inquiétait nullement. Quelques-uns des frères attestent qu’ils ont entendu le démon reprocher à Martin, d’une manière injurieuse, d’avoir introduit dans le monastère des frères qui avaient perdu la grâce du baptême en tombant dans diverses erreurs, de les avoir reçus après leur conversion ; et en même temps le malin esprit énumérait leurs crimes. Martin, lui résistant toujours, répondait que les anciennes fautes sont effacées par une vie meilleure, et que, comptant sur la miséricorde du Seigneur, l’Église doit absoudre ceux qui renoncent à leurs péchés. Le démon osa le contredire, prétendit que les pécheurs ne peuvent obtenir leur pardon, et que le Seigneur n’a aucune indulgence, pour ceux qui une fois sont tombés. Alors Martin s’écria : « Si toi-même, misérable que tu es, tu cessais de tenter les hommes et si tu faisais pénitence de tes crimes, même en ce moment que le jour du jugement est proche, me confiant dans le Seigneur Jésus, je te promettrais miséricorde. » Oh ! quelle sainte présomption de la miséricorde du Seigneur ! Si ces paroles de Martin ne peuvent faire autorité en cela ; elles montrent du moins la bonté de son cœur. Puisque j’ai commencé à parler du diable et de ses artifices, quoique je semble m’éloigner ici de mon sujet, il ne sera cependant pas hors de propos de raconter le fait suivant, parce qu’il nous aidera à mieux connaître la puissance de Martin, et qu’il est bon de conserver la mémoire d’un fait si digne d’admiration, qui nous fera tenir sur nos gardes, si jamais quelque chose de pareil nous arrivait.
XXIII. — Un jeune homme de qualité, nommé Clair, avait été ordonné prêtre encore jeune (il est heureux maintenant par la sainte mort qu’il a faite). Ayant tout abandonné, il vint trouver Martin et brilla bientôt par sa foi et ses vertus. Il s’était établi à peu de distance du monastère épiscopal, et un grand nombre de frères demeuraient avec lui. Un jeune homme nommé Anatole, simulant une profonde humilité et une grande pureté de mœurs sous les dehors de la vie monastique, vint se joindre à eux, et vécut quelque temps avec les frères, suivante en tout leur genre de, vie. Peu de temps après, il leur dit que des anges conversaient souvent en sa présence. Comme aucun des frères n’ajoutait foi à ses paroles, au moyen de prestiges merveilleux il en détermina un grand nombre à le suivre. À la fin, il en vint jusqu’à prétendre que les anges allaient et venaient de lui à Dieu, et il voulait qu’on le regardât comme un prophète. Cependant il ne pouvait jamais convaincre Clair ; aussi le menaçait-il de la colère de Dieu et de châtiments immédiats, pour n’avoir pas cru à la parole d’un saint ; enfin, il s’écria : « Cette nuit le Seigneur me donnera une robe blanche ; revêtu de cette robe, je paraîtrai au milieu de vous, et ce vêtement descendu du ciel sera une preuve que je suis la vertu de Dieu. » Tous attendaient l’événement avec une grande impatience. Vers minuit, la terre retentit comme d’un piétinement ; le monastère tout entier parut ébranlé ; on vit briller mille éclairs dans la cellule d’Anatole ; un bruit de pas et des voix nombreuses s’y firent entendre. À cette agitation succéda un grand silence. Alors Anatole appelle à lui l’un des frères, nommé Sabatius, et lui montre la robe dont il est revêtu. Surpris, celui-ci appelle les autres frères, Clair accourt lui-même. On apporte de la lumière, et tous examinent la robe : avec soin ; elle était d’une grande délicatesse, d’une blancheur merveilleuse, ornée de pourpre ; on ne pouvait cependant en découvrir la nature ni la matière ; et on eut beau la regarder et la toucher avec soin ; on ne put reconnaître qu’une chose : c’était une robe. Clair avertit ses frères de prier le Seigneur avec ardeur, pour qu’il leur montrât plus clairement ce que c’était ; pendant le reste de la nuit, ils chantèrent des hymnes et des psaumes. Au point du jour, il prit Anatole par la main pour le conduire à Martin, étant sûr que le diable ne pourrait tromper le bienheureux. Alors ce misérable s’y refusa, s’écriant qu’il lui avait été défendu de paraître devant Martin ; comme les frères l’y entraînaient malgré lui, la robe disparut entre leurs mains. Aussi qui pourrait douter que la puissance de Martin n’ait empêché le diable de dissimuler plus longtemps son artifice, au moment où il allait paraître en sa présence ?
XXIV. — On remarqua à cette époque, en Espagne, un jeune homme qui, après avoir acquis quelque influence par un grand nombre de prestiges, en vint jusqu’à se faire passer pour le prophète Élie. Beaucoup de personnes ayant eu la témérité de le croire, il alla jusqu’à se donner pour le Christ ; et il fit tant par ses artifices, qu’un certain évêque, nommé Rufus, lui rendit un culte, ce qui, dans la suite, le fit chasser de son siége. La plupart des frères nous ont rapporté aussi qu’il y avait alors en Orient un certain homme qui prétendait être saint Jean. De l’existence de ces faux prophètes, nous conjecturons que l’arrivée de l’Antéchrist est proche, puisqu’il opère déjà en eux son mystère d’iniquité. Je ne dois point, ce me semble, passer sous silence tous les artifices que le diable employa contre Martin à la même époque. Un jour le démon se présente dans sa cellule, pendant qu’il priait, précédé et environné d’une lumière éclatante (afin de mieux le tromper par cet éclat emprunté), portant un manteau royal, ceint d’une couronne d’or et de pierres précieuses, avec des chaussures dorées, le visage gai, la physionomie sereine, pour ne pas être reconnu. À cette vue, Martin est d’abord stupéfait ; ils gardent tous deux le silence pendant quelque temps ; enfin le diable prend la parole le premier : « Reconnais donc, Martin, celui qui se présente à toi ; je suis le Christ devant descendre sur la terre, c’est à toi le premier que j’ai voulu me montrer. » Martin ne répond pas à ces paroles ; et garde un profond silence. Alors le diable ose renouveler son audacieux mensonge. « Martin, pourquoi hésites-tu à croire, puisque tu me vois ? Je suis le Christ. » Mais à ce moment le Saint-Esprit fit connaître à Martin que ce n’était pas Dieu, mais le démon. « Jésus Notre-Seigneur, lui répondit-il, n’a point annoncé qu’il viendrait vêtu de pourpre et couronné d’un diadème ; je ne croirai à sa présente que lorsque, je le verrai tel qu’il était lorsqu’il souffrit pour nous, portant marques de son supplice. » À ces mots, Satan disparut comme une fumée, laissant dans la cellule une odeur infecte, signe indubitable de sa présence. Pour que personne ne puisse révoquer en doute le fait que je viens de raconter, j’ajouterai que c’est de la bouche de Martin lui-même que je l’ai appris.
XXVI. — Mais il est temps de terminer ce livre, non qu’il n’y ait plus rien à dire de Martin, mais parce que, semblable à ces poètes peu féconds, qui se relâchent à la fin d’un long poème, nous succombons sous le poids de notre intarissable sujet. Car, s’il a été possible, jusqu’à un certain point, de raconter les actions de notre bienheureux, jamais, je le déclare en toute vérité, jamais on ne pourra décrire sa vie intérieure, sa manière d’employer chaque journée, son cœur incessamment appliqué à Dieu, la continuité de ses abstinences et de ses jeûnes, et le sage tempérament qu’il savait y apporter, la puissante efficacité de ses prières et de ses oraisons, les nuits qu’il employait comme les journées ; tout son temps, en un mot, dont pas un instant n’était donné au repos ni aux affaires de ce monde, était entièrement consacré, à l’œuvre de Dieu, même pendant son repos et son sommeil, auxquels il n’accordait que ce que la nature exigeait absolument. Non, il faut l’avouer, si Homère lui-même revenait de l’autre monde, le génie de ce grand poète serait incapable de raconter toutes ces merveilles : tout est si grand dans Martin, que la parole est impuissante à l’exprimer. Jamais il ne laissait passer une heure, un seul moment sans vaquer à la prière ou à la lecture, et même, pendant qu’il lisait ou qu’il se livrait à toute autre occupation, son cœur priait toujours. Comme les forgerons qui frappent sur l’enclume pour se soulager pendant leur travail, Martin priait sans cesse, quoiqu’il parât occupé d’autre chose. Heureux Martin ! il ne se trouvait en lui aucune malice ; il ne jugeait ni ne condamnait personne, et ne rendait jamais le mal pour le mal. Il supportait les injures avec tant de patience, que, bien qu’il fût évêque, les moindres clercs l’outrageaient impunément, et sans qu’il les privât pour cela de leur emploi, ou les chassât de son cœur.
XXVII. — Jamais on ne le vit irrité ou ému, jamais dans la tristesse ou la gaieté ; il était toujours lui-même, une joie toute céleste était en quelque sorte empreinte sur son visage, et il semblait élevé au-dessus de la nature. Il avait toujours le nom du Christ sur les lèvres ; dans son cœur, la piété, la paix et la miséricorde. Il pleurait souvent sur les fautes de ses détracteurs, qui allaient le chercher jusqu’au fond de sa retraite, au milieu du calme qu’il y goûtait, pour l’attaquer avec leurs langues de vipères ; nous en avons été nous-même le témoin. Jaloux de ses vertus et de sa sainte vie, ils détestaient en lui ce qu’ils ne trouvaient point en eux-mêmes et qu’ils n’avaient pas le courage d’imiter ; il est inutile de les nommer, quoique la plupart d’entre eux hurlent autour de nous. Si l’un d’eux vient à lire ces lignes, il suffit qu’il reconnaisse sa faute et en rougisse ; car s’il s’en irrite, c’est qu’il s’applique à lui-même ce que nous avons peut-être pensé d’un autre ; du reste, je ne refuse point de partager avec Martin la haine qu’ils lui portent. J’ose espérer que ce petit ouvrage plaira à tous les hommes religieux. Si quelqu’un ne veut pas ajouter foi à mes paroles, la faute retombera sur lui. La certitude des faits que j’ai racontés, et l’amour de Jésus-Christ, m’ont seuls porté à écrire ce livre, j’en ai la conscience ; car je n’ai avancé que des choses vraies et incontestables, et Dieu, je l’espère, prépare une récompense, non pour celui qui lira, mais pour celui qui croira.
[ix][i] Sabarie ancienne colonie romaine, aujourd’hui Sarwar.
[x][ii] Ville de la Gaule cisalpine, aujourd’hui Pavie.
[xi][iii] La piété de nos rois n’a pas peu contribué à immortaliser l’action de saint Martin. Le roi Louis XI l’a honorée par une fondation perpétuelle qu’il a faite dans l’église de Saint-Martin de Tours, pour l’entretien d’un pauvre qui porte une robe de deux couleurs. (D. Gervaise.)
[xii][iv] On croit que c’est l’île Gorgona, située à trente-deux kilomètres de Livourne.
[xiii][v] Ce lieu s’appelle Ligugé. Les disciples de saint Martin n’étaient pas moines de profession, et leur engagement n’était pas perpétuel... Ce qui n’ôte cependant pas à saint Martin la gloire d’avoir, le premier, introduit la profession monastique en France. (D. Gervaise.)
[xiv][vi] Ce fut plus tard la célèbre abbaye de Marmoutier.
[xv][vii] Maintenant Loroux, dans le département de la Loire-Inférieure ; ou plutôt Levroux, dans le Berri.
[xvi][viii] Le pays des Éduens répondait à une partie du Nivernais et de la Bourgogne ; leur capitale était Autun.
texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER
I — AU PRÊTRE EUSÈBE - CONTRE CEUX QUI SONT JALOUX DES VERTUS DE SAINT MARTIN.
Hier, beaucoup de moines vinrent me trouver, et, au milieu de nos récits et de nos longs entretiens, on parla de mon petit livre sur la vie de saint Martin ; j’appris avec plaisir que beaucoup le lisaient avec empressement. On m’annonça aussi qu’une personne, inspirée par le malin esprit, avait demandé pourquoi Martin, qui avait ressuscité des morts et arrêté des incendies, s’était trouvé exposé lui-même à périr tristement dans les flammes. Ô le misérable ! (quel qu’il soit), dans ses paroles je reconnais la perfidie des juifs, qui, faisant des reproches au Seigneur sur la croix, disaient : « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. » Vraiment, si ce malheureux eût vécu à cette époque-là, il eût adressé les mêmes outrages au Seigneur, puisqu’il profère de semblables blasphèmes contre l’un de ses saints. Quoi ! Martin ne serait pas puissant, Martin ne serait pas saint, parce qu’il a manqué de périr dans un incendie ! Ô bienheureux Martin ! semblable en tout aux apôtres, même dans les injures qu’il reçoit. En effet, les Gentils voyant Paul mordu par une vipère dirent aussi de lui : « Cet homme doit être un homicide ; il a échappé aux périls de la mer, les destins ne lui permettent pas de vivre. » Mais Paul, secouant la vipère dans le feu, n’en ressent aucun mal. Ces païens croyaient qu’il allait périr sur-le-champ ; mais voyant qu’il n’en était rien, ils changèrent de sentiments et le prirent pour un dieu. Ô le plus misérable des mortels, ces exemples n’auraient-ils pas dû confondre ta perfidie ! et si tu avais été d’abord scandalisé en voyant Martin recevoir les atteintes du feu, tu aurais dû ensuite attribuer à ses mérites et à la puissance de sa foi quel ait conservé au milieu des flammes ! Reconnais ton ignorance, malheureux ; apprends que c’est dans les dangers que la vertu des saints brille avec le plus d’éclat. Je vois Pierre, avec sa foi puissante, marcher sur la mer, malgré la loi de la nature, et se tenir ferme sur les flots mobiles. Mais cet Apôtre des nations, qui fut englouti dans les eaux, d’où il sortit sain et sauf après trois jours et trois nuits, ne me semble pas moins grand ; et je ne sais s’il est plus remarquable d’avoir vécu au fond de la mer, ou d’avoir marché à sa surface. Mais, insensé, tu n’avais donc ni lu ni entendu lire ces faits ? car ce n’est pas sans l’inspiration divine que l’évangéliste a rapporté, cet exemple dans les saintes Écritures ; c’était pour apprendre aux hommes que les naufrages, les morsures de serpents (comme le dit l’Apôtre, qui se glorifie d’avoir souffert la nudité, la faim et les dangers de la part des voleurs), qu’en un mot, tous ces accidents sont communs aux saints, aussi bien qu’aux autres hommes ; mais c’est en les supportant et en en triomphant que la vertu des justes a brillé du plus vif éclat. Car, patients dans les épreuves et toujours invincibles, la victoire qu’ils ont remportée a été d’autant plus éclatante, que leurs souffrances ont été plus violentes. Aussi le fait que l’on cite pour amoindrir la vertu de Martin le couvre-t-il d’honneur et de gloire, puisqu’il est sorti vainqueur d’un accident rempli de péril. D’ailleurs en ne doit pas s’étonner si j’ai omis ce fait dans la vie que j’ai écrite, puisque dans ce livre même j’ai déclaré que je ne raconterais pas toutes ses actions. En effet, si j’eusse entrepris de le faire, j’aurais rempli un immense volume ; ses actions ne sont pas si peu importantes qu’on puisse facilement les raconter toutes. Je ne passerai pourtant pas sous silence le fait dont il est question ici, et je le raconterai dans tous ses détails, tel qu’il s’est passé, afin de ne pas paraître omettre à dessein ce qui peut fournir des objections contre la vertu de nôtre bienheureux.
Un jour d’hiver, Martin visitant une paroisse (suivant l’habitude des évêques), les clercs lui préparèrent un logement dans la sacristie, allumèrent un grand feu dans une sorte de fourneau très mince et construit en pierres brutes, puis lui dressèrent un lit, en entassant une grande quantité de paille. Martin s’étant couché eut horreur de la délicatesse de ce lit, à laquelle il n’était pas habitué, car il avait coutume de coucher sur un cilice, étendu sur la terre nue. Mécontent de ce qu’il regardait comme une injure, il repoussa la paille, qui s’accumula par hasard sur le fourneau ; puis, fatigué du voyage, il s’endormit, étendu par terre, suivant son usage. Vers le milieu de la nuit, le feu, étant très ardent, se communiqua à la paille à travers les fentes du fourneau. Martin, réveillé en sursaut, surpris par ce danger subit et imminent, et surtout, comme il le raconta lui-même, par l’instigation du démon, eut recours trop tard à la prière ; car, voulant se précipiter au dehors, et ayant fait de longs efforts pour enlever la barre qui fermait la porte, un feu si violent l’environna, que le vêtement qu’il portait fut consumé. Enfin, rentrant en lui-même, et comprenant que ce n’était pas dans la fuite, mais dans le Seigneur qu’il trouverait du secours, il s’arma du bouclier de la foi et de la prière, et, se remettant tout entier entre les mains de Dieu, il se précipita au milieu des flammes. Alors le feu s’étant éloigné miraculeusement de Martin, celui-ci se mit en prière au milieu d’un cercle de flammes dont il ne ressentait nullement les atteintes. Les moines qui étaient au dehors, entendant le bruit et les pétillements de la flamme, enfoncent les portes, écartent les flammes, et en retirent Martin, qu’ils croyaient déjà entièrement consumé. Du reste, Dieu m’en est témoin, Martin lui-même me racontait et avouait en gémissant, que c’était par un artifice diabolique, qu’à l’instant de son réveil il n’avait pas eu la pensée de repousser le danger par la foi et la prière ; qu’enfin il avait senti l’ardeur des flammes jusqu’au moment où, rempli de frayeur, il s’était précipité vers la porte ; mais qu’aussitôt qu’il avait eu recours au signe de la croix et aux armes puissantes de la prière, les flammes s’étaient retirées, et qu’après lui avoir fait sentir leurs cruelles atteintes, elles s’étaient ensuite transformées en une douce rosée. Que celui qui lira ces lignes comprenne que si ce danger a été pour Martin une tentation, il a été aussi une épreuve de Dieu.
II — AU DIACRE AURÉLIUS - DE LA MORT ET DE L’APPARITION DU BIENHEUREUX MARTIN
Sulpice Sévère, au diacre Aurélius, salut. — Ce matin, après votre départ, j’étais seul dans ma cellule, méditant, à mon ordinaire, sur les espérances de la vie future, le dégoût des choses de ce monde, la crainte du jugement et des peines, et ces pensées avaient naturellement fait naître en moi le souvenir de mes fautes, ce qui me remplissait de tristesse et d’accablement. Ensuite, le cœur fatigué de ces angoisses, je me jetai sur mon lit, et bientôt le sommeil s’empara de moi, effet ordinaire de la tristesse (c’était ce demi-sommeil du matin, si inquiet et si léger, qu’on veille presque en se sentant dormir, ce qu’on n’éprouve pas dans le sommeil ordinaire), lorsque tout à coup il me sembla voir le saint évêque Martin, revêtu d’une robe blanche, le visage enflammé, les yeux et les cheveux resplendissants de lumière. Il me semblait retrouver en lui les mêmes formes, les mêmes traits qu’il avait autrefois, et, chose inexprimable ! je ne pouvais fixer mes yeux sur lui, et cependant je le reconnaissais. Il me regardait en souriant, et tenait à la main le livre que j’ai écrit sur sa vie ; quant à moi, j’embrassais ses genoux sacrés, et, selon ma coutume, je lui demandais sa bénédiction. Je sentais sur ma tête le doux contact de sa main, tandis que, dans la formule ordinaire de la bénédiction, il répétait souvent le nom de la croix, qui lui était si familier. Bientôt, comme je le considérais attentivement, sans pouvoir me rassasier de sa vue, il s’éleva subitement, et je le suivis des yeux, traversant sur une nuée l’immensité des airs, jusqu’à ce qu’il disparût dans le ciel entr’ouvert. Peu de temps après, je vis le saint. prêtre Clair, son disciple, mort peu auparavant, suivre le même chemin que son maître. Dans ma téméraire audace, je voulus les suivre ; mais les efforts que je fis pour m’élever en l’air me réveillèrent. Je me réjouissais de cette vision, lorsqu’un de mes plus intimes serviteurs entra avec un visage plus triste qu’à l’ordinaire, et qui laissait voir toute la douleur qui l’accablait : « Qu’as-tu ? lui dis-je ; d’où vient cette tristesse ? — Deux moines arrivent de Tours, dit -il ; ils annoncent la mort du seigneur Martin. » Je l’avoue, cette nouvelle me consterna, et un torrent de larmes échappa de mes yeux. Elles coulent encore, cher frère, au moment où je vous écris ces lignes ; rien ne peut consoler mon amère douleur. Lorsque cette nouvelle me fut annoncée, je voulus vous faire partager mon affliction, vous qui partagiez aussi mon amour pour Martin.
III — À BASSULA, SA BELLE-MÈRE - COMMENT LE BIENHEUREUX MARTIN QUITTA CETTE VIE POUR L’ÉTERNITÉ.
....Martin connut l’heure de sa mort longtemps d’avance, et annonça à ses frères que la dissolution de son corps était proche. Il eut à cette époque un motif pour aller visiter la paroisse de Cande[xvii][i] ; car, désirant rétablir la concorde parmi les clercs de cette église qui étaient divisés, quoiqu’il sût que sa fin approchait, il ne balança pas à entreprendre ce voyage. Il pensait qu’il couronnerait dignement ses travaux s’il rétablissait la paix dans cette église avant de mourir. Étant donc parti, accompagné, suivant son usage, d’une troupe nombreuse de pieux disciples, il vit sur le fleuve des plongeons poursuivre des poissons, et exciter sans cesse leur gloutonnerie par de nouvelles captures : « Voici, dit-il, une image des démons, qui dressent des embûches aux imprudents, les surprennent et les dévorent, sans pouvoir se rassasier. » Alors Martin, avec toute la puissance de sa parole, commanda aux oiseaux de s’éloigner du fleuve et de se retirer dans des régions arides et désertes, employant contre eux le même pouvoir dont il usait souvent contre les démons. À l’instant tous ces oiseaux se rassemblent, et, quittant le fleuve, se dirigent vers les montagnes et les forêts, à la grande admiration de tous les spectateurs, qui voyaient Martin exercer son pouvoir, même sur les oiseaux. Étant arrivé à l’église de Cande, il y demeura quelque temps, et, après avoir rétabli la concorde parmi les clercs, il songeait déjà à retourner dans sa solitude, lorsque ses forces l’abandonnèrent ; il réunit alors ses disciples et leur annonça que sa mort était proche. Une profonde douleur s’empare aussitôt de tous les cœurs ; tous s’écrient en gémissant : « Ô tendre père ! pourquoi nous abandonner et nous laisser dans la désolation ? des loups avides de carnage se jetteront sur votre troupeau ; si le pasteur est frappé, qui pourra le défendre ? Nous savons bien que vous souhaitez ardemment de posséder Jésus-Christ ; mais votre récompense est assurée, et elle ne sera pas moins grande pour être retardée ; ayez pitié de nous que vous allez laisser seuls. » Martin, touché de leurs larmes, et brûlant de cette tendre charité qu’il puisait dans les entrailles de son divin Maître, se mit aussi à pleurer. Puis, s’adressant au Seigneur : « Seigneur, s’écria-t-il, si je suis encore nécessaire à votre peuple, je ne refuse pas le travail : que votre volonté soit faite. » Hésitant entre l’espérance du ciel et l’amour de ses frères, il ne savait ce qu’il devait préférer ; car, s’il désirait ne pas abandonner ses chers disciples, il ne voulait pourtant pas vivre plus longtemps séparé de Jésus-Christ ; sacrifiant néanmoins sa propre volonté et ses plus ardents désirs, il s’abandonnait tout entier entre les mains de Dieu. Ne semblait-il pas lui dire : Seigneur, j’ai livré de rudes combats sur la terre n’est-il donc pas temps que je jouisse du repos ? Si pourtant vous me commandez de combattre encore devant le camp d’Israël pour la défense de votre peuple ; je ne vous refuserai pas ; non, mon grand âge ne m’arrêtera pas, je remplirai mon devoir avec zèle ; je combattrai sous vos drapeaux aussi longtemps que vous me l’ordonnerez. Le vétéran qui a blanchi sous les armes soupire pourtant avec impatienté après ce congé qui doit être la récompense de ses longs travaux. N’importe, mon courage me fera triompher du poids des années. Et pourtant, Seigneur, quel bonheur pour moi, si vous daigniez avoir compassion de ma vieillesse ! Mais que votre volonté s’accomplisse. Si je vais à vous, ne prendrez-vous pas soin vous-même de ces chers enfants, pour qui je redoute tant de dangers ? Ô homme admirable, que ni le travail ni la mort même ne peuvent, vaincre ! qui demeure indifférent, qui ne craint, ni la mort ni la vie ! Ainsi, malgré l’ardeur de la fièvre qui le consumait depuis plusieurs jours, il poursuivait l’œuvre de Dieu avec un zèle infatigable. Il veillait toutes les nuits, et les passait en prière. Étendu sur sa noble couche, la cendre et le cilice, il se faisait obéir de ses membres épuisés par l’âge et la maladie. Ses disciples l’ayant prié de souffrir qu’on mît un peu de paille sur sa couche : « Non, mes enfants, répondit-il, il ne convient pas qu’un chrétien meure autrement que sur la cendre et le cilice ; je serais moi-même coupable de vous laisser un autre exemple. » Il tenait ses regards et ses mains continuellement élevés vers le ciel, et ne se lassait point de prier. Un grand nombre de prêtres qui s’étaient réunis près de lui, le priaient de leur permettre de se soulager un peu en le changeant de position : « Laissez-moi, mes frères, répondit-il ; laissez-moi regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon âme prenne plus facilement son essor vers Dieu. » À peine eut-il achevé ces mots, qu’il aperçut le démon à ses côtés. « Que fais-tu ici, bête cruelle ! tu ne trouveras rien en moi qui t’appartienne : je serai reçu dans le sein d’Abraham. » Après ces paroles, il expira. Des témoins de sa mort nous ont attesté qu’en ce moment son visage parut celui d’un ange, et que ses membres devinrent blancs comme la neige. Aussi s’écrièrent-ils : « Pourrait- on jamais croire qu’il soit revêtu d’un cilice et couvert de cendres ? » Car, dans l’état où ils virent alors son corps, il semblait qu’il jouît déjà de la transformation, glorieuse des corps ressuscités.
Il est impossible de s’imaginer l’innombrable multitude de ceux qui vinent. lui rendre les derniers devoirs. Presque toute la ville de Tours accourut au-devant du saint corps ; tous les habitants des campagnes et des bourgs voisins, et même un grand nombre de personnes des autres villes s’y trouvèrent. Oh ! quelle affliction dans tous les cœurs ! Quels douloureux gémissements faisaient entendre, surtout les moines ! On dit qu’il en vint environ deux mille : c’était la gloire de Martin, les fruits vivants et innombrables de ses saints exemples. Ainsi, le pasteur conduisait-il ses ouailles devant lui, de saintes multitudes pâles de douleur, des troupes nombreuses de moines revêtus de manteaux, des vieillards épuisés par de longs travaux, de jeunes novices de la solitude et du sanctuaire. Apparaissait ensuite le chœur des vierges, que la retenue empêchait de pleurer, et qui dissimulaient par une joie toute sainte la profonde affliction de leurs cœurs : et si la confiance qu’elles avaient dans la sainteté de Martin ne leur permettait pas de paraître tristes, l’amour qu’elles lui portaient leur arrachait cependant quelques gémissements. Car la gloire dont Martin jouissait déjà causait autant de joie, que sa mort qui le ravissait à ses enfants leur causait de douleur. Il fallait pardonner les larmes des uns et partager l’allégresse des autres ; car chacun, en pleurant pour soi-même, devait en même temps se réjouir pour lui.
Cette foule immense accompagna donc le corps du bienheureux jusqu’au lieu de sa sépulture en chantant de saints cantiques. Qu’on se représente, si l’on veut, une pompe de la terre ; je ne dirai pas une cérémonie funèbre ; mais la pompe fastueuse d’un triomphe. Où trouverez-vous rien de comparable aux funérailles de Martin ? Que des héros vainqueurs s’avancent montés sur des chars de triomphe, précédés d’hommes enchaînés et suivis de leurs prisonniers : le corps de Martin est suivi de tous ceux qui, sous sa conduite, ont vaincu le monde. Pour les premiers, les peuples en démence font entendre des applaudissements et des cris confus : en l’honneur de Martin, les airs retentissent du chant des psaumes et des cantiques sacrés. Ceux-là, après leurs triomphes, sont précipités dans les gouffres de l’enfer ; Martin, rayonnant d’une joie céleste, est reçu dans le sein d’Abraham. Martin, si pauvre en ce monde, menant une vie si simple, entre riche dans le ciel, d’où, je l’espère, il veille sur nous, sur moi qui écris ces lignes, sur vous qui les lisez.
[xviii][i] Cande, ville du département d’Indre-et-Loire, située au confluent de la Vienne et de la Loire.
SOURCE : http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Stmartin/lettres.htm
DIALOGUES DE SULPICE SÉVÈRE
texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER
DIALOGUE PREMIER
Postumien, ami de Sulpice Sévère, revient d’Orient, où il a passé trois années. Il fait un long récit des merveilles qu’il a admirées et surtout des vertus des moines de la Thébaïde. Le traducteur a retranché ces détails ; il reprends l’endroit où Postumien établit un parallèle entre les miracles des moines d’Orient et ceux de saint Martin.
XXIII. — ..... « Comment, dis-je, tu ne possèdes, donc pas le livre que j’ai écrit sur la vie et les miracles de saint Martin ? — Je l’ai ; en effet, répondit Postumianus ; jamais il ne m’a quitté (il me fit voir le livre caché sous ses vêtements) ; si tu le reconnais, le voici. Ce volume m’a accompagné sur terre et sur mer, il a été mon compagnon et mon consolateur pendant tous mes voyages. Je te dirai toutes les contrées où ce livre a pénétré ; car il n’y a pas un endroit dans l’univers où le récit d’une si admirable histoire ne soit connu. Paulin, qui t’est si attaché, est le premier qui l’ait porté à Rome : comme toute la ville se le disputait, j’ai entendu les libraires enchantés déclarer que rien n’était plus lucratif, rien ne se vendait plus facilement et plus cher que ce livre. Il a beaucoup devancé mon voyage par mer ; lorsque j’arrivai en Afrique, on le lisait déjà dans toute la ville de Carthage. Seul, le prêtre de Cyrène ne l’avait pas, je le lui donnai pour le copier. Que te dirais-je donc d’Alexandrie, où on le connaît peut-être mieux que tu ne le connais toi-même ? Il a pénétré en Égypte, en Nitrie, en Thébaïde, et dans tout le royaume de Memphis. J’ai vu un vieillard le lire dans le désert. Lorsqu’il apprit que j’étais ton ami, il me chargea, ainsi que beaucoup d’autres moines, si jamais je te retrouvais sain et sauf en ce pays, de t’exhorter à compléter ce que tu reconnais avoir omis dans ton livre sur les vertus de saint Martin. Enfin, je joins mes prières à celles de beaucoup d’autres pour te supplier de nous raconter, non ce que tu as écrit, mais ce, que tu as autrefois passé sous silence, pour éviter, je crois, de fatiguer les lecteurs. »
XXIV. — « En vérité, dis -je à Postumianus, pendant que j’écoutais depuis longtemps avec attention le récit des miracles des saints moines d’Orient, je songeais silencieusement à Martin, et je voyais avec raison que tout ce que chacun de ces moines a fait en particulier a été accompli par Martin. Car, quoique leurs miracles soient fort remarquables (qu’il me soit permis de le dire sans les offenser), il n’en est pas un qui ne soit inférieur aux siens. Mais, si je déclare que la vertu de Martin ne peut être comparée à celle des autres hommes, il faut aussi remarquer que l’on ne peut établir de juste comparaison entre Martin et les ermites et les anachorètes. Ceux-ci sans entraves opèrent de très grands miracles, et n’ont que le Ciel et les anges pour témoins : Martin, au contraire, vivant au milieu du monde, avec lequel il est toujours en rapport, parmi des clercs en discorde et des évêques sévères, affligé souvent par des scandales presque quotidiens, reste inébranlable par sa vertu, et opère de plus grands miracles que n’en firent dans le désert les moines dont tu nous parles. Quand ils en auraient fait de semblables, quel juge serait assez injuste pour ne pas reconnaître que Martin l’emporte sur eux ? Songe donc, que Martin était un soldat combattant dans un poste désavantageux, et qui cependant a remporté la victoire : je compare également les autres à des soldats, mais à des soldats qui combattent dans un endroit favorable et avantageux. Et d’ailleurs, quoique tous aient été vainqueurs, la gloire des combattants ne saurait être égale ; puis, en nous racontant ces merveilles, tu ne nous as pas dit qu’aucun de ces moines ait ressuscité un mort, et cela seul te force à avouer que Martin ne peut être comparé à personne. »
XXV. — « S’il est merveilleux que le feu ait respecté l’Égyptien, Martin aussi commanda souvent aux flammes. Si les anachorètes ont. dompté. la férocité des animaux, Martin souvent encore contint la rage des bêtes féroces, et arrêta le venin des serpents. Situ veux comparer à Martin celui qui, par la puissance de sa parole ou la vertu des fils de ses vêtements, guérissait ceux qui étaient possédés de l’esprit immonde, notre Saint n’a encore rien à lui envier en cela, et nous en avons beaucoup d’exemples. Si tu cites celui qui, n’ayant qu’un vêtement de poils, était, dit-on, visité par les anges, Martin conversait tous les jours avec eux. Son âme était tellement supérieure à la vanité et à l’orgueil, que personne ne détesta ces vices plus que lui, bien que, même absent, il ait délivré les possédés du démon, et commandé non seulement aux comtes, et aux préfets, mais aux empereurs eux-mêmes. Il est vrai que ce sont là les moindres de ses mérites, mais je veux te persuader que personne ne résista plus courageusement que lui non seulement à la vanité, mais aux causes et aux occasions de la vanité. Je vais maintenant raconter des choses peu importantes, mais que je ne puis passer sous silence ; car nous devons louer celui qui, revêtu d’une grande autorité, montra tant de respect envers le saint homme. Je me souviens que le préfet Vincent, homme éminent et le plus vertueux des Gaules, demanda souvent à Martin, lorsqu’il passait en Touraine, de le recevoir à la table du monastère (et il citait à cette occasion l’exemple du saint évêque Ambroise, qui, dit-on, recevait de temps en temps à cette époque les consuls et les préfets). Mais Martin refusa toujours, craignant, dans sa haute sagesse, qu’il n’en tirât de la vanité ou de l’orgueil. Il faut, donc que tu avoues, Postumianus, que l’on trouvé en Martin tous les mérites de ces moines, qui, tous réunis, n’en ont pas autant que lui. »
XXVI — « Pourquoi en agir ainsi avec moi ? dit Postumianus, ne suis-je donc pas de ton avis, et n’en ai-je pas été toujours ? Tant que je vivrai et que j’aurai ma raison, je vanterai les moines d’Égypte, je louerai les anachorètes, et j’admirerai les ermites ; toujours je ferai une exception pour Martin, jamais je n’oserai lui comparer les moines ou d’autres évêques. C’est ce qu’avoue l’Égypte ; ce que croient la Syrie, l’Éthiopie, les Indes, la Parthie, la Perse ; ce que n’ignorent pas l’Arménie, le Bosphore, les îles Fortunées, si elles sont habitées, et l’Océan glacial, s’il est sillonné par les vaisseaux. Que notre pays, si proche de ce grand homme, est malheureux de n’avoir pas été digne de le connaître ! Ce n’est pas sur le peuple que retombe cette faute, mais sur les prêtres, sur les évêques. Les envieux avaient bien leurs raisons pour refuser de le connaître ; car admettre ses vertus, c’était avouer leurs vices. C’est, avec horreur que je répète ce que j’ai récemment entendu un malheureux (je ne sais qui c’est) a dit que ton livre était plein de faussetés. Ce propos n’est pas d’un homme, mais du diable ; et ce n’est pas Martin qu’il contredit en cela, c’est l’Évangile qu’il dément. Car le Seigneur lui-même n’a-t-il pas attesté que tous les fidèles pouvaient opérer les mêmes miracles que Martin ? Or celui qui ne croit pas aux miracles de Martin ne croit pas aux paroles du Christ. Mais ces malheureux, ces misérables, ces lâches, rougissant de ce qu’ils ne sont pas aussi puissants que Martin, aiment mieux nier ses mérites que confesser leur impuissance. Passons à d’autres choses, et oublions-les ; raconte-nous plutôt les autres miracles de Martin, il y a longtemps que je désire les connaître. — Quant à moi, dis-je, il me semble qu’il serait plus juste de demander cela à Gallus, il en sait plus que nous (un disciple peut-il ignorer les actions de son maître ?), et il doit d’abord à Martin, puis à nous, de traiter ce sujet à son tour ; car, pour moi, j’ai écrit un livre ; et toi, Postumianus, tu nous as jusqu’à présent entretenu des miracles des moines d’Orient. Gallus nous doit donc ce récit, et, comme je viens de le dire, c’est à son tour de parler, et, pour l’amour de Martin, il le fera, je crois, avec plaisir.
— Certainement, répondit Gallus, quoique je sois bien faible pour un si grand fardeau ; cependant, excité, par les exemples d’obéissance que vient de rapporter Postumianus, je ne refuserai point la charge que vous m’imposez. Mais, lorsque je pense que moi, Gaulois, je vais parler devant des Aquitains, je crains d’offenser vos oreilles délicates par, mon langage peu soigné. Écoutez-moi donc comme un homme grossier, simple et sans fard dans son langage. Car si vous m’accordez d’être disciple de Martin, permettez-moi, à son exemple, de mépriser un style vainement orné et fleuri.
— Parlez celtique ou gaulois si vous l’aimez mieux, dit Postumianus, mais du moins entretenez-nous de Martin ; quant à moi, je prétends que, même si vous étiez muet, pour nous parler de Martin d’éloquentes paroles ne vous feraient pas défaut : la langue de Zacharie ne s’est-elle pas déliée pour prononcer le nom de Jean ? D’ailleurs vous êtes un homme lettré, vous usez d’artifice, et vous vous excusez sur votre inhabileté parce que vous êtes plein d’éloquence : un moine ne peut être si adroit, ni un Gaulois si rusé. Commencez donc plutôt, et remplissez la lâche qui vous est imposée, nous avons déjà perdu trop de temps à d’autres choses : les ombres qui s’allongent et le soleil couchant annoncent la fin du jour et l’arrivée de la nuit.
Après quelques moments de silence, Gallus commença ainsi : « Je crois que je dois d’abord prendre garde à ne pas répéter les miracles de Martin que notre ami Sulpice a rapportés dans son livre ; je passerai donc sous silence ce que Martin a fait lorsqu’il portait les armes et pendant qu’il fut laïque et moine, et je raconterai plutôt ce que j’ai vu moi-même, de préférence à ce que je tiens des autres. »
DEUXIÈME DIALOGUE
I. — « Aussitôt que j’eus quitté les écoles, je me joignis à Martin. Quelques jours après, comme nous le suivions pendant qu’il allait à l’église, un pauvre à demi nu (c’était en hiver) se présenta à lui, demandant qu’on lui donnât un vêtement. Martin appela alors l’archidiacre, lui ordonna de revêtir le pauvre immédiatement, et entra ensuite dans la sacristie, où il demeura seul selon sa coutume ; car, même dans l’église, accordant toute liberté au clergé, il préférait la solitude ; quand aux autres prêtres, ils se tenaient dans l’autre sacristie, y recevaient des visites, ou s’occupaient d’affaires. Mais Martin restait dans sa retraite, jusqu’à l’heure où il était d’usage de célébrer l’office pour le peuple. Je n’omettrai pas de vous dire que, dans la sacristie, jamais il ne se servit d’un siège orné, et, dans l’église, personne ne le vit jamais s’asseoir, comme le fit naguère un certain personnage que je vis placé (et j’atteste le Seigneur que ce ne fut pas sans honte) sur un siège élevé et magnifique, comme sur un trône royal. Martin s’asseyait sur un petit escabeau grossier, semblable à ceux dont se servent les esclaves, que nous autres, simples Gaulois, nous appelons sièges à trois pieds, et que vous lettrés et vous qui revenez de la Grèce nommez trépieds. L’archidiacre ayant négligé de donner un vêtement au pauvre, celui-ci entra dans la retraite du saint homme, se plaignant d’avoir été oublié, et de souffrir beaucoup. Aussitôt, sans que le pauvre s’en aperçoive, le bienheureux ôte secrètement sa tunique sous son manteau, en revêt le pauvre et le congédie. Quelque temps après, l’archidiacre entre, et, selon l’usage, avertit Martin, que le peuple attend dans l’église, et qu’il est temps de sortir pour célébrer le sacrifice. Mais le Saint lui répond qu’il faut d’abord vêtir le pauvre (il parlait de lui-même), et qu’il ne peut aller à l’église avant que le pauvre n’ait un vêtement. Le diacre qui ne comprend pas, car Martin étant couvert d’un manteau, il ne peut s’apercevoir de sa nudité, affirme qu’il n’y a pas de pauvre. « Que l’on m’apporte ; dit Martin, le vêtement qu’on lui a préparé, et je trouverai un pauvre à vêtir. » Le prêtre, pressé par cet ordre, et dont la bile était déjà en mouvement, achète rapidement pour cinq pièces d’argent, une robe grossière, courte et velue, et la met, tout irrité, aux pieds de Martin : « La voici, dit-il, mais je ne vois point de pauvre. » Martin, sans aucune émotion, lui ordonne de se tenir quelques instants à la porte, désirant être seul, pendant qu’il se revêt de cette tunique, s’efforçant de cacher ce qu’il fait. Mais les saints peuvent-ils céler ces sortes de choses ! bon gré mal gré ceux qui s’en informent les découvrent toujours.
II. — « Revêtu de cet habit, il alla donc offrir le saint sacrifice. Ce jour-là même (chose merveilleuse !), comme il bénissait l’autel selon la coutume, nous vîmes briller au-dessus de sa tête un globe de feu, qui, en s’élevant en l’air, traça un sillon lumineux. Quoique ce miracle soit arrivé un jour de grande fête, et en présence d’une immense foule de peuple, une vierge, un prêtre et trois moines en furent les seuls témoins. Pourquoi les autres ne le virent-ils pas ? C’est ce que je ne puis expliquer. À peu près à cette époque, mon oncle Evanthius, bon chrétien, quoiqu’il vécut dans le monde, tomba dangereusement malade, et se vit aux portes de la mort ; il fit demander Martin, qui vint aussitôt. Avant que le saint homme eût fait la moitié du chemin, le malade éprouva le bienfait de son approche, recouvra aussitôt la santé, et vint lui-même au-devant de nous. Le lendemain il retint Martin, qui voulait partir, et le même jour un serpent piqua mortellement un des esclaves de la maison. Evanthius le prit sur ses épaules (car le poison était si violent, qu’il était déjà presque inanimé) et le déposa aux pieds du Saint, assuré qu’il n’y avait rien d’impossible pour lui. Déjà le venin s’était répandu dans tous les membres ; vous eussiez vu les veines gonflées soulever la peau et le ventre tendu comme une outre. Martin étendit la main, plaça son doigt près de l’endroit où la bête avait déposé son venin. Alors, (chose admirable !) nous vîmes le poison revenir de tous côtés vers le doigt de Martin, et, mêlé de sang, sortir abondamment par l’étroite ouverture, de même que les mamelles des chèvres ou des brebis, pressées par la main du pasteur, laissent sortir de longs filets d’un lait abondant. L’esclave se leva complètement guéri. Quant à nous, stupéfaits d’un si grand miracle, et cédant à l’évidence, nous avouâmes qu’il n’y avait personne sous le ciel qui pût imiter Martin.
III. – « Quelque temps après, nous voyagions avec Martin qui visitait son diocèse : je ne sais pourquoi nous étions restés en arrière, et il nous précédait un peu. À ce moment un chariot du fisc, plein de soldats, s’avançait sur la voie publique. Dès que les mules qui le traînaient aperçurent près d’elles Martin, enveloppé d’un vêtement grossier et d’un long manteau noir, saisies de frayeur, elles se jetèrent un peu à l’écart ; leurs traits se mêlèrent, et, elles mirent le désordre dans tout l’attelage. Les soldats rétablirent l’ordre difficilement, ce qui leur causa du retard. Irrités de cet accident, ils se précipitèrent en bas de leurs voitures, et se mirent à frapper Martin à coups de fouets et de bâtons ; mais celui-ci supportait leurs coups sans mot dire, avec une incroyable patience, ce qui augmentait la folie de ces malheureux, rendus plus furieux, parce qu’il semblait mépriser et ne pas sentir leurs coups. Nous arrivâmes aussitôt, et nous trouvâmes Martin étendu à terre, à demi mort, horriblement ensanglanté, et tout le corps cruellement déchiré. Après l’avoir placé sur son âne, nous nous hâtâmes de nous éloigner, en maudissant le lieu de cet affreux malheur. Pendant ce temps, les soldats, revenus à leurs chariots, après avoir assouvi leur fureur, excitent leurs mules à continuer la route. Mais ces animaux, fixés au sol comme des statues d’airain, ne font aucun mouvement, malgré les cris perçants de leurs maîtres et les coups de fouets qui résonnent de tous côtés. Enfin ils se lèvent tous pour les frapper, mais c’est en vain qu’ils font usage des fouets gaulois ; ils dévastent la forêt voisine, et frappent les mules avec d’énormes branches ; mais leurs mains cruelles sont impuissantes, elles restent à la même place, immobiles comme des statues. Ces malheureux ne savaient plus que faire ; malgré leur brutalité, ils ne pouvaient déjà plus se dissimuler qu’ils étaient retenus par une puissance divine. Enfin, rentrant en eux-mêmes, ils commencèrent à se demander quel était celui qu’ils avaient frappé dans ce même endroit ; ils s’informent aux passants, qui leur apprennent que c’est Martin qu’ils ont traité si inhumainement. Alors tout leur fut découvert, ils comprirent que c’était à cause de l’outrage fait au saint évêque qu’ils ne pouvaient plus avancer, et ils s’élancèrent rapidement après nous. Sentant leur faute, et remplis d’une juste honte, pleurant, la tête et la figure couvertes de poussière, ils se précipitent aux genoux de Martin, implorent leur pardon et la permission de s’éloigner, disant que les remords de leur conscience les ont assez punis, et qu’ils comprennent bien qu’ils auraient pu être engloutis par la terre, ou, perdant la raison, être changés en durs rochers, comme leurs mules avaient été clouées au sol ; ils le prient et le supplient de leur pardonner et de leur permettre de partir. Le saint homme savait avant leur arrivée qu’ils étaient retenus, et il nous en avait prévenus ; il leur pardonna cependant avec bonté, et leur permit de continuer leur route avec leur équipage. »
IV. — « J’ai plus d’une fois remarqué, Sulpice, que Martin, devenu évêque, disait souvent qu’il n’avait plus autant de puissance qu’autrefois pour opérer des miracles. Si cela est vrai, ou plutôt puisque c’est vrai, nous pouvons conjecturer que les miracles qu’il fit sans témoins, lorsqu’il était moine, furent très remarquables ; car il en opéra publiquement de très grands durant son épiscopat. Beaucoup de ses premiers miracles ne purent échapper au monde, ni demeurer dans l’oubli ; mais le nombre de ceux qu’il cacha pour échapper à la vanité, et qu’il ne laissa pas arriver à la connaissance des hommes, est, dit-on, incalculable. Car, supérieur à la nature humaine et sentant sa puissance, il foulait aux pieds la gloire du monde, et n’avait que le Ciel pour témoin. C’est ce qui a été prouvé par le récit de ceux que nous connaissons, et qu’il n’a pu nous cacher. Avant d’être évêque, il a ressuscité deux morts, ce que vous nous racontez très bien dans votre livre ; mais (et je m’étonne que vous ayez omis de le dire) pendant, son épiscopat il n’en ressuscita qu’un seul ; ce que je puis affirmer comme témoin, si mon témoignage vous paraît suffisant. Voici comment la chose s’est passée : Je ne sais pour quelle raison nous allions à Chartres. Comme nous passions dans un bourg très populeux, nous rencontrâmes une grande foule de gentils, car il ne se trouvait aucun chrétien en cet endroit. À l’annonce de l’arrivée d’un si grand homme, les champs voisins s’étaient couverts d’une foule énorme. Martin sentit qu’il devait agir, le frémissement de tout son corps lui annonça l’approche du Saint-Esprit, et d’une voix surhumaine il annonça aux gentils la parole de Dieu, gémissant souvent qu’une si grande multitude ignorât le Seigneur Jésus. Alors (nous étions entourés d’une grande foule) une femme, dont le fils venait de mourir, tendit vers le Saint ce corps inanimé, et lui dit : « Nous savons que tu es l’ami de Dieu ; rends-moi mon fils, mon fils unique. » Martin, voilant en ce moment (comme il nous le dit plus tard) que pour le salut de tous il pourra obtenir un miracle, reçoit l’enfant entre ses bras, fléchit le genou devant la foule, et, après avoir prié, le rend plein de vie à sa mère. Toute cette multitude pousse aussitôt de grands cris qui s’élèvent jusqu’au ciel, et reconnaît le Christ pour son Dieu ; tous ils se jettent aux pieds du saint homme, demandant avec foi qu’on les fit chrétiens. Martin n’hésite pas. Comme il se trouve au milieu d’une plaine, il les fait tous catéchumènes par une imposition générale des mains ; puis, se tournant vers nous, il nous dit que ce n’est pas sans raison que l’on peut faire des catéchumènes dans une plaine, puisque c’est là ordinairement que se consacrent les martyrs. »
V. — « Tu l’emportes, Gallus, dit Postumianus, non pas sur moi, qui suis dévoué partisan de Martin, qui connais tous ses miracles et y crois fermement, mais tu l’emportes sur tous les ermites et les anachorètes. Aucun d’entre eux, comme votre Martin, ou plutôt comme notre Martin, n’a ressuscité des morts. C’est avec raison que Sulpice le compare aux apôtres et aux prophètes ; il leur ressemble en tout ; sa grande foi et ses miracles nous le prouvent. Mais achève, je t’en prie, quoique nous ne puissions rien entendre de plus magnifique ; achève cependant de nous raconter ce qui te reste à nous dire de Martin. Mon âme désire vivement connaître ses moindres actions de chaque jour, car, sans aucun doute, ses moindres actions sont plus importantes que les plus grandes actions des autres. » — « Il est vrai que je n’ai pas vu ce que je vais raconter, car ce miracle arriva avant que je me fusse joint au bienheureux ; mais il est fort célèbre et a été divulgué par les moines fidèles qui étaient présents. À peu près à l’époque où il reçut l’épiscopat, Martin fut obligé de se présenter à la cour. Valentinien régnait alors. Sachant que Martin demandait des choses qu’il ne voulait pas accorder, il ordonna qu’on ne le laissât pas entrer au palais. Outre sa vanité et son orgueil, il avait une épouse arienne qui l’éloignait du Saint et l’empêchait de lui rendre hommage. C’est pourquoi Martin, après avoir fait plusieurs tentatives inutiles pour pénétrer chez ce prince orgueilleux, eut recours à ses armes ordinaires ; il se revêtit d’un cilice, se couvrit de cendres, s’abstint de boire et de manger ; et pria jour et nuit. Le septième jour, un ange lui apparut et lui ordonna de se rendre avec confiance au palais ; il lui dit que les portes, quoique fermées, s’ouvriront d’elles-mêmes, et que le fier empereur s’adoucira. Rassuré par la présence et les paroles de l’ange, et aidé de son secours, il se rend au palais. Les portes s’ouvrent ; il ne rencontre personne, et parvient sans opposition jusqu’à l’empereur. Celui-ci, le voyant venir de loin, frémit de rage de ce qu’on l’a laissé entrer, et ne veut pas se lever pendant qu’il se tient debout. Tout à coup son siège est couvert de flammes qui l’enveloppent, et forcent ce prince orgueilleux de descendre de son trône et de se tenir debout, malgré lui, devant Martin. Il embrasse ensuite celui qu’il avait résolu de mépriser, et avoue qu’il a ressenti les effets de la puissance divine ; puis, sans attendre les prières de Martin, il lui accorde tout ce qu’il veut, avant qu’il lui ait fait aucune demande. Il le fit souvent venir pour s’entretenir avec lui, ou le faire asseoir à sa table. À son départ, il lui offrit beaucoup de présents ; mais le saint homme, voulant toujours rester pauvre, n’en accepta aucun.
VI. — « Puisque nous voici dans le palais, je raconterai tout ce que Martin y a fait à diverses époques. Il me semble que je ne dois pas omettre de,parler de l’admiration d’une pieuse reine pour Martin. L’empereur Maxime gouvernait l’empire ; c’était un homme dont toute la vie serait digne de louanges, s’il eût pu refuser une puissance illégitime que lui imposèrent des soldats en révolte, et éviter la guerre civile ; mais il n’eût pu sans danger, refuser un si grand empire, et le gouverner sans avoir recours aux armes. Ce prince faisait souvent venir Martin dans son palais, et s’entretenait longtemps avec lui de la vie présente et future, de la gloire des fidèles, de l’éternité des saints ; tandis que jour et nuit la reine restait suspendue aux lèvres de Martin et, semblable à Marie, arrosait ses pieds de pleurs, qu’elle essuyait avec ses cheveux. Martin, qu’aucune femme n’avait jamais touché, ne pouvait éviter la présence continuelle de l’impératrice, ou plutôt cette véritable servitude. Oubliant ses richesses, la dignité impériale, le diadème et la pourpre, prosternée à terre, elle ne pouvait être arrachée des pieds de Martin. Enfin, elle demanda à son mari de lui permettre d’éloigner tous ses serviteurs, et de préparer, seule un repas pour Martin. L’empereur joignit ses instances à celles de l’impératrice, pour décider le bienheureux, qui ne put s’opposer à ce dessein. Elle prépara donc tout de ses mains royales, couvrit son siége d’un tapis, approcha la table, présenta l’eau pour les mains, et apporta les mets qu’elle avait fait cuire elle-même. Pen-dant que Martin était assis, elle se tint immobile à quelque distance, selon l’usage des domestiques, montrant en tout la réserve d’un serviteur et la soumission d’un esclave ; elle-même lui versa à boire et lui présenta la coupe. Après le repas, elle recueillit avec soin les morceaux de pain et les miettes, préférant ces restes aux repas impériaux. Heureuse femme ! ses sentiments de piété la rendent, avec raison, comparable à cette reine qui vint des confins de la terré entendre Salomon, si nous nous en tenons simplement à l’histoire ; mais si nous comparons la foi de ces deux reines (qu’on me permette cela, en mettant de côté la majesté du mystère), on verra que l’une alla entendre un sage, et que l’autre, non contente de l’entendre, le voulut servir elle-même. »
VII. — À cet endroit, Postumianus prit la parole. « Il y a longtemps, Gallus, que je t’écoute et que j’admire profondément la foi de l’impératrice ; mais ne m’avais-tu pas dit que jamais Martin ne se laissait approcher par une femme ? et voici que l’impératrice non seulement s’est approchée de Martin, mais encore l’a servi pendant son repas. » — « Pourquoi, lui dit alors Gallus, ne considérez-vous pas ici, comme le font les grammairiens, le lieu, le temps et la personne ? Représentez-vous la position difficile où se trouvait Martin dans le palais de l’empereur ; l’impératrice qui l’obsédait, qui lui faisait en quelque sorte violence par ses prières et les instances que sa foi lui inspirait ; enfin, considérez les circonstances impérieuses qui le pressaient : il voulait obtenir la liberté d’infortunés captifs, faire révoquer des sentences d’exil, et enfin faire rentrer dans la possession de leurs biens des malheureux qu’on en avait dépouillés. Pour obtenir, toutes ces grâces, auxquelles le saint évêque attachait un si grand prix, n’a-t-il pas dû se relâcher un peu de la rigueur de la règle de vie qu’il s’était tracée ? Néanmoins vous pensez, vous, que quelques personnes pourront s’autoriser de cet exemple et en abuser ; eh bien, moi, je proclame heureux ceux qui, dans une circonstance semblable, prendront modèle sur Martin. Qu’on réfléchisse donc que Martin déjà septuagénaire, une seule fois dans sa vie, fut servi à table, non par une veuve vivant à sa guise, ni par une vierge, mais par une femme mariée, qui le fit à la prière de son mari lui-même, par une impératrice. Elle se tint debout pendant qu’il mangeait, sans s’asseoir à côté de lui ; et, sans oser partager son repas, elle le servit humblement. Voici donc la règle : que la femme vous serve sans vous commander et sans prendre place à côté de vous ; Marthe servit ainsi le Seigneur, sans être admise au repas, et qui plus est Marie, qui écoutait la parole du Sauveur, fut mise au-dessus de Marthe qui le servait. Quant à l’impératrice, elle a pareillement agi envers Martin ; elle l’a servi comme Marthe, et écouté comme Marie. Si quelqu’un veut s’autoriser de cet exemple, qu’il l’imite donc scrupuleusement ; que ce soit le même motif, la même personne, la même humilité, le même festin, et que cela ne lui arrive qu’une fois dans sa vie.
VIII. — « Je vous ai déjà raconté tant de merveilles, que je devrais vous avoir satisfait ; mais puisque je ne puis me refuser à vos désirs, je parlerai encore jusqu’à la fin du jour. Lorsque je regarde cette paille préparée pour nos lits, je me souviens que la paille du lit de Martin fut l’occasion d’un miracle ; voici comment la chose se passa. Le bourg de Claudiomagus se trouve sur les limites du Berri et de la Touraine ; là est une église célèbre par la piété de ses Saints et le troupeau non moins glorieux de ses vierges. Martin passant en cet endroit coucha dans la sacristie. Après son départ, les vierges s’y précipitèrent en foule, baisèrent les endroits où le Saint s’était assis où arrêté, et se partagèrent la paille où il avait reposé. L’une d’elles, quelques jours après, suspendit au cou d’un énergumène la paille qu’elle avait recueillie par respect, et aussitôt, plus vite que je ne vous le raconte, le démon fut chassé et la personne délivrée.
IX. — « À peu près à cette époque, en revenant de Trèves, Martin rencontra une vache agitée par le démon ; elle avait quitté le troupeau, se précipitait sur tous ceux qu’elle rencontrait, et avait déjà frappé plusieurs personnes. Lorsqu’elle fut près de nous, ceux qui la suivaient de loin se mirent à nous crier de prendre garde ; mais Martin éleva la main au moment où elle s’approchait toute furieuse avec des yeux menaçants, et lui commanda de s’arrêter. À cet ordre, elle demeura aussitôt immobile. Ce fut alors que Martin vit un démon assis sur son dos, et lui dit : « Misérable, éloigne-toi de cet animal innocent et cesse de l’agiter. » L’esprit malin obéit et disparut. La vache, ayant assez d’instinct pour comprendre sa délivrance, devint tranquille, se prosterna aux pieds du Saint, et sur son ordre regagna le troupeau, qu’elle suivit plus douce qu’une brebis. Ce fut cette époque que Martin sortit sain et sauf du milieu des flammes. Je ne crois point devoir rapporter ce fait ; car, quoique Sulpice l’ait omis dans son livre ; il l’a cependant raconté avec détail dans sa lettre à Eusèbe, alors prêtre et récemment devenu évêque. Vous l’avez lue, je crois, Postumianus ; si vous ne la connaissez pas, vous la trouverez à votre disposition dans cette bibliothèque, car je ne rapporte que ce que Sulpice a omis. Un jour, Martin visitait son diocèse, lorsque nous rencontrâmes une troupe de chasseurs dont les chiens poursuivaient un lièvre. Déjà la pauvre bête, fatiguée d’une longue course, et ne voyant aucun refuge dans la plaine immense qui l’entourait, s’efforçait de conjurer le péril imminent en bondissant de côté et d’autre. Le Saint, ému du danger qu’elle courait, ordonna aux chiens de cesser leur poursuite et de la laisser s’échapper. À peine eut-il donné cet ordre, qu’ils s’arrêtèrent à l’instant ; on les aurait crus liés ou plutôt cloués au sol, tant ils demeuraient immobiles. Aussi le pauvre lièvre, dont les ennemis étaient ainsi retenus, put s’échapper sain et sauf.
X. — « Les propos spirituels et familiers de Martin méritent d’être rapportés. Apercevant une brebis qu’on venait de tondre, il dit : « Elle a accompli le précepte de l’Évangile ; elle avait deux tuniques, elle en a donné une à celui qui n’en avait pas : c’est aussi ce que vous devez faire. » Voyant encore un porcher à demi nu, transi de froid sous un vêtement fait de peaux : « Voici Adam chassé du paradis, dit-il, qui fait paître ses pourceaux sous un vêtement de peaux ; quant à nous, dépouillons notre vieux vêtement que celui-ci a gardé, et revêtons-nous du nouvel Adam. » Des bœufs avaient brouté une partie d’une prairie, des porcs en avaient fouillé une autre ; le reste, demeuré intact, verdoyait, émaillé de mille fleurs. « La partie que les bœufs ont broutée, nous dit-il, représente le mariage ; si la verdure a encore quelque fraîcheur, les fleurs ne l’ornent plus. La partie fouillée par les porcs immondes représente la dégoûtante image de la débauche ; mais la portion qui n’a reçu aucune souillure nous montre la gloire de la virginité ; l’herbe y est épaisse et le foin abondant, et les fleurs, leur plus grand ornement, y brillent comme des pierres précieuses. Quel magnifique spectacle, digne des yeux de Dieu ! car rien n’est comparable à la virginité. Ceux qui comparent le mariage à la fornication sont grandement dans l’erreur, et ceux qui le comparent à la virginité sont de misérables insensés. Les sages doivent faire cette distinction : que le mariage est toléré, la virginité glorifiée, et la fornication punie, à moins qu’on ne l’expie par la pénitence.
XI. — « Un soldat, ayant abandonné la carrière des armes, fit profession de moine au pied des autels, et se bâtit une cellule dans un lieu retiré pour y vivier en ermite. Mais l’esprit malin, qui agitait de beaucoup de pensées son âme grossière, lui fit changer d’idées et souhaiter de vivre avec sa femme, que Martin avait fait entrer dans un couvent de filles. Ce vaillant ermite alla donc trouver Martin, et lui fit part de son désir. Celui-ci refusa aussitôt, en lui disant qu’il n’était pas convenable qu’une femme habitat avec un homme, qui n’est plus son mari puisqu’il s’est fait moine. Enfin, comme le soldat faisait des instances, affirmant que cela ne nuirait point à son genre de vie, qu’il ne voulait avoir sa femme que comme une consolation, et qu’il n’était point à craindre qu’ils tombassent dans le vice : car, disait-il, je suis soldat du Christ, et ma femme a aussi prêté serment dans cette sainte milice ; accordez donc à, des religieux, qui par le mérite de la foi ne connaissent plus le sexe, la permission de combattre ensemble. Martin lui dit alors (je cite ses propres, paroles) : « As-tu jamais été à la guerre, dans les rangs d’une armée rangée en bataille ? — Souvent, répondit le soldat, je me suis trouvé dans les rangs d’une armée, et j’ai assisté à des combats. — Dis-moi donc, reprit Martin, as-tu jamais vu dans une armée prête à en venir aux mains, ou combattant déjà l’ennemi l’épée à la main, une femme se tenir dans les rangs et prendre part au combat ? » Alors, enfin, le soldat confus rougit et remercia Martin de l’avoir détourné de cette erreur, non par de rudes réprimandes, mais en se servant d’une comparaison juste, raisonnable, et appropriée à un soldat. Puis, Martin se tournant vers nous (car il était souvent entouré d’une nombreuse troupe de frères) : « La femme, dit-il, ne doit point entrer dans le camp des soldats, ni se mêler à eux. Qu’elle reste chez elle ; une armée devient méprisable, lorsqu’une troupe de femmes se mêle à ses rangs. C’est au soldat de combattre en bataille rangée et en plaine ; la femme se doit renfermer dans l’asile de sa demeure. Sa gloire, à elle, c’est de rester pure en l’absence de son mari ; sa première vertu et sa plus grande victoire, c’est de rester cachée. »
XII. — « Vous devez vous rappeler, Sulpice, avec quelle ardeur Martin louait cette vierge qui s’était si complètement soustraite aux regards des hommes, qu’elle ne voulut pas même recevoir Martin, qui voulait la visiter par honneur ; car, passant par le lieu qu’elle habitait depuis plusieurs années, il s’arrêta, ayant entendu parler de sa foi et de ses vertus, afin d’honorer une si sainte personne d’une visite épiscopale. Nous le suivions, persuadés que cette vierge s’en réjouirait, et regarderait comme un témoignage de sa vertu, qu’un évêque si célèbre se relâchât pour la voir de son austérité. Mais le plaisir de sa visite ne fut pas pour elle une raison suffisante pour manquer à la ferme résolution qu’elle avait prise. Le bienheureux reçut, ses excuses par l’entremise d’une autre femme, et s’éloigna plein de joie de la maison de cette vierge, qui ne lui avait pas permis de la voir et de la saluer. Ô la glorieuse vierge ! qui ne souffrit pas les regards de Martin lui-même. Ô heureux Martin ! qui, loin de considérer ce refus comme une injure, exaltait cet acte de vertu, dont on n’avait pas encore vu d’exemple dans ces contrées, et s’en réjouissait dans son cœur. L’approche de la nuit nous ayant forcés de nous arrêter à quelque distance de cette demeure, cette même vierge envoya un cadeau au saint évêque. Martin fit alors ce qu’il n’avait point fait auparavant (car jamais il n’accepta un présent de personne), en disant qu’un évêque pouvait accepter les offrandes bénies d’une vierge si vénérable, que l’on pouvait préférer à bien des évêques. Que les vierges n’oublient pas cet exemple ; qu’elles ferment leurs portes même aux honnêtes gens pour éviter les méchants, et si elles veulent leur fermer tout accès auprès d’elles, qu’elles ne reçoivent pas même les évêques. Que le monde entier l’apprenne, une vierge n’a pas souffert que Martin la vît. Et ce ne fut pas un prêtre quelconque qu’elle refusa de voir, c’était celui dont la vue est le salut de tous ceux qui le voyaient. Quel autre évêque que Martin n’en eût pas été offensé ? Quel n’eût pas été son mécontentement contre cette sainte vierge ? Il l’eût tenue pour hérétique, et l’eût anathématisée. Combien il eût préféré à cette belle âme ces vierges qui toujours vont partout à la rencontre des évêques, leur préparent de somptueux repas, et se mettent à table avec eux. Mais où me conduit mon récit ? Réprimons ce langage trop libre, de peur d’offenser quelqu’un. Car les reproches ne font aucun effet sur lés infidèles, tandis que cet exemple suffit pour les fidèles. Mais si j’exalte la vertu de cette,derge, je ne prétends rien ôter à la gloire de celles qui vinrent de régions fort éloignées pour voir Martin, puisque les anges eux-mêmes ont souvent visité le saint homme avec autant de respect.
XIII. — « Ce que je vais raconter, Postumianus, celui-ci, dit-il en me regardant, vous l’attestera. Un jour, Sulpice et moi nous veillions à la porte de Martin ; nous étions assis là en silence depuis quelques heures, pleins de respect et de crainte, comme si nous veillions à la porte d’un ange. Or la cellule de Martin était fermée, et il ne savait pas que nous fussions là. À ce moment nous entendîmes le bruit d’une conversation ; la frayeur s’empara de nous, et nous sentîmes qu’il se passait quelque chose de surnaturel. Deux heures après Martin sortit. Alors Sulpice (car personne n’est plus familier avec lui) se mit à le prier instamment de satisfaire notre pieuse curiosité, en nous faisant connaître quelle était cette frayeur surnaturelle que nous avions ressentie tous deux, ou quelles étaient les personnes avec lesquelles il avait conversé dans sa cellule ; car nous avions entendu derrière la porte le bruit d’une conversation, qu’à la vérité nous n’avions pu comprendre. Martin hésita beaucoup ; mais il n’y avait rien que Sulpice n’obtint de lui. (Je vais raconter des choses merveilleuses, mais je prends Dieu à témoin que je dis la vérité, et personne ne sera assez sacrilège pour accuser Martin de mensonge). « Je vous le dirai, dit-il, mais, de grâce, ne le confiez à personne ; Agnès, Thècle et Marie étaient avec moi. » Et il nous décrivit le visage et le vêtement de chacune d’elles ; il nous avoua qu’elles ne l’avaient pas visité seulement ce jour-là, mais bien d’autres fois ; il ne nous cacha pas non plus qu’il voyait souvent Pierre et Paul. Lorsque les démons venaient auprès de lui, il les appelait par leurs noms. Mercure lui était particulièrement désagréable ; Jupiter, disait-il, était hébété, et grossier. Toutes ces choses paraissaient incroyables, même à ceux qui habitaient le même monastère que lui, et je ne crois pas que tous ceux, qui les entendront y ajouteront foi. Mais si sa vie, et ses miracles n’étaient pas si étonnants, sa gloire ne serait pas si grande... D’ailleurs il n’est pas surprenant que notre faiblesse humaine doute des miracles de Martin, lorsque nous voyons tous les jours beaucoup de personnes qui ne croient pas même à l’Évangile. Souvent nous avons remarqué que les anges conversaient avec Martin, et nous en avons été témoins. Ce que je vais raconter est peu important, toutefois je le dirai. Martin avait refusé d’assister à un concile d’évêques qui se tenait à Nîmes ; il désirait cependant savoir ce qui s’y passerait. Par hasard, Sulpice était sur le même bateau que lui ; selon son habitude, Martin se tenait loin des autres dans un endroit écarté : là un ange lui annonça ce qui s’était passé dans le concile. Nous nous informâmes avec soin de l’époque où s’était tenu le concile ; nous nous convainquîmes que c’était le jour même de l’apparition, et que les évêques avaient décrété ce que l’ange avait annoncé à Martin.
XIV. — « Lorsque nous l’interrogions sur la fin du monde, il nous disait que Néron et l’Antéchrist devaient d’abord venir. Néron, ajoutait-il, règnera en Occident après avoir vaincu dix rois, et persécutera le peuple ; pour le faire tomber dans l’idolâtrie. Quant à l’Antéchrist, il règnera d’abord en Orient, et établira le siège de son empire à Jérusalem, qu’il rebâtira ainsi que le temple ; il ordonnera une persécution pour forcer ses sujets à renier Dieu, et à le reconnaître pour le Christ. Il mettra Néron à mort, et soumettra toutes les nations de l’univers. Il nous disait encore qu’il n’était pas douteux que l’Antéchrist, engendré par le malin esprit, ne fût déjà né, mais encore enfant, et n’attendant que l’âge viril pour régner. Il y a déjà huit ans que Martin nous parlait ainsi : voyez combien est imminent cet effrayant avenir. » Pendant que Gallus parlait encore, et il n’avait pas tout dit, un serviteur entra annonçant que le prêtre Réfrigérius était à la porte. Comme nous hésitions, ne sachant s’il était préférable d’écouter encore Gallus, ou d’aller à la rencontre d’un prêtre qui nous est si cher et qui venait nous rendre visite, Gallus nous dit : « Quand bien même nous ne devrions pas finir ces discours pour recevoir un si saint prêtre, la nuit nous forcerait d’abandonner ce récit déjà si long. Comme je n’ai pu vous raconter tous les miracles de Martin, que mon récit d’aujourd’hui vous suffise, demain je vous raconterai le reste. » Après cette promesse de Gallus, nous nous levâmes tous.
TROISIÈME DIALOGUE
I. — « Il commence à faire jour, Gallus, levons-nous ; car, comme tu le vois, Postumianus est impatient ; et le prêtre, qui n’a pu t’entendre hier, attend que, selon ta promesse, tu continues tes récits sur Martin. Ce dernier, il est vrai, n’ignore pas ce que tu vas raconter, mais il est doux et agréable d’entendre de nouveau ce qu’on connaît déjà ; il a suivi Martin dès sa jeunesse ; il connaît donc tous ses miracles, mais il les écoutera encore avec plaisir. Je l’avouerai, Gallus, que bien souvent j’ai entendu raconter les miracles de Martin ; j’en ai rapporté beaucoup dans mes lettres ; mais ils sont tellement admirables, que le récit en est toujours nouveau pour moi. D’ailleurs, je suie d’autant plus heureux de voir Réfrigérius grossir notre auditoire ; que Postumianus, qui est pressé de retourner en Orient raconter tâtes ces merveilles, emportera d’ici des récits dont la véracité aura été attestée par un plus grand nombre de témoins. » Après ces paroles, Gallus se préparait à parler, lorsque subitement entrèrent un grand nombre de moines, le prêtre Évagrius, Aper, Sébastien, Agricola ; et peu après le prêtre Actherius, avec le diacre Calupion et l’archidiacre Amator. Enfin le prêtre Aurélius, mon ami intime, arriva le dernier de fort loin et hors d’haleine. « Qui peut vous faire venir de si loin, si subitement et inopinément, à cette heure matinale ? leur dis-je. — Nous avons appris hier, répondirent-ils, que pendant toute la journée Gallus avait parlé des miracles de Martin ; et qu’il avait remis la suite au lendemain, à cause de l’approche de la nuit ; nous avons donc pris la résolution de former un nombreux auditoire à celui qui devait traiter une si belle matière. » On nous annonça en ce moment qu’un grand nombre de laïques étaient à la porte, n’osant entrer, mais priant qu’on voulût bien les admettre. — « Il n’est pas convenable, dit alors Aper, de leur permettre de se mêler à nous, car ils ont été amenés plutôt par la curiosité que par la piété. » Honteux pour ceux qu’Aper ne voulait pas laisser entrer, j’obtins enfin, non sans peine, qu’on admît Eucherius, ancien vicaire, et Celse, personnage consulaire. Alors Gallus, placé sur un siège au milieu de l’assemblée, garda longtemps un modeste silence, puis il commença en ces termes :
II. — « Hommes saints et instruits, qui vous êtes réunis pour m’entendre, je m’adresserai à votre piété, bien plus qu’à votre savoir ; veuillez m’écouter plutôt comme un témoin fidèle, que comme un éloquent orateur. Je ne répèterai pas les choses que j’ai dites hier ; ceux qui ne les ont pas entendues les peuvent lire. Postumianus en attend de nouvelles, afin de les raconter à l’Orient, pour que la comparaison avec Martin l’empêche de se préférer à l’Occident. Et d’abord, je désire vivement vous raconter un miracle que Réfrigérius me souffle à l’oreille ; il s’est passé dans la ville de Chartres. Un père de famille présenta à Martin sa fille, âgée de douze ans et muette de naissance, suppliant le Saint de lui rendre l’usage de la langue par ses mérites. Martin, par déférence pour les évêques Valentinien et Victrice, qui se trouvaient par hasard près de lui, disait que cette tâche était au-dessus de ses forces, mais, qu’elle n’était pas impossible à ces saints évêques. Ceux-ci joignirent leurs pieuses instances aux supplications du père, et le prièrent d’acquiescer à sa demande. Le saint homme n’hésita pas (quelle humilité et quelle admirable miséricorde !) et fit éloigner le peuple. En présence seulement des évêques et du père de la jeune fille, il se mit en prière, selon son habitude il bénit ensuite un peu d’huile, en récitant une formule d’exorcisme, et versa la liqueur sacrée sur la langue de la jeune fille, qu’il tenait entre ses doigts. Son attente ne fut point trompée. Il lui demanda le nom de son père, qu’elle prononça aussitôt ; celui-ci jette un cri, se précipite aux pieds de Martin, en pleurant de joie, et assure aux assistants étonnés que c’est la première parole qu’il entend prononcer à sa fille. Si par hasard ce fait vous parait incroyable, Évagrius, ici présent, vous attestera sa véracité, car il en fut témoin.
III. — « Le fait que le prêtre Harpagius m’a raconté n’est pas très remarquable ; cependant je ne dois pas le passer sous silence. La femme du comte Avicien avait envoyé à Martin de l’huile dont elle se servait, selon l’usage, contre diverses maladies, afin qu’il la bénit. Cette huile était contenue dans une fiole de verre courte et ronde, et dont le col fort long n’était pas tout à fait plein, parce qu’ordinairement on ne remplit pas ces petits vases, afin de laisser de l’espace pour les boucher. Harpagius assure qu’il a vu l’huile croître pendant la bénédiction de Martin, puis déborder et se répandre au dehors ; pendant qu’on portait le vase à la femme d’Avicien, elle bouillonnait et coulait encore entre les mains de l’esclave avec tant d’abondance, qu’elle couvrit ses vêtements. La matrone reçut cependant la fiole pleine jusqu’au bord, et le prêtre Harpagius affirme qu’aujourd’hui encore elle est si pleine, qu’on ne peut y mettre un bouchon, afin de la conserver avec plus de soin. Ce qui est arrivé à celui-ci (et il me regardait) est aussi fort étonnant. Il avait déposé sur une fenêtre élevée une fiole pleine d’huile bénite par Martin. Un domestique tira sans précaution le linge qui la recouvrait, ignorant qu’elle fût dessous, et le vase tomba sur le pavé de marbre. Tous tremblaient que cet objet sacré ne fût brisé ; mais on le trouva intact, comme s’il fût tombé sur la plume la plus douce. On ne peut attribuer ce miracle au hasard, mais à Martin, dont la bénédiction ne devait point se perdre. Raconterai-je ce qui a été fait par une certaine personne dont je tairai le nom, car elle est présente et ne veut pas être connue ; Saturninus, d’ailleurs, fut témoin de ce fait à cette époque. Un chien nous importunait par ses aboiements. « Au nom de Martin, dit cette personne, je t’ordonne de te taire. » Les aboiements s’arrêtèrent aussitôt dans son gosier, et sa langue (qu’on aurait crue coupée) resta muette. C’était peu, croyez-moi, que Martin fit des miracles, car les autres en faisaient en son nom.
IV. — « Vous savez combien se montrait autrefois barbare et cruel le comte Avicien. Il venait d’entrer à Tours fort irrité, ayant à sa suite une longue file de prisonniers enchaînés, à l’aspect misérable ; il avait ordonné qu’on préparât toutes sortes de supplices, se disposant à procéder le lendemain à une si triste tâche à la vue de la ville étonnée. Lorsque Martin en fut instruit, il se rendit seul, un peu avant minuit, au palais de cette bête cruelle. Mais comme, les portes étaient fermées à cette heure de la nuit obscure, où tout le monde dort profondément, Martin se prosterna sur le seuil de cette maison de sang. Cependant Avicien, enseveli dans le sommeil, est réveillé par un ange. « Le serviteur de Dieu est à la porte, et tu reposes, » dit-il. À cette voix, il sort tout troublé de son lit, appelle ses serviteurs en tremblant, leur dit que Martin est à la porte, et ordonne d’aller sur-le-champ lui ouvrir, afin que le serviteur de Dieu n’ait pas à souffrir une injure. Mais ceux-ci (car tels sont les esclaves) ne dépassèrent pas les portes intérieures, se moquant de leur maître, devenu le jouet d’un songe, et dirent qu’il n’y avait personne à la porte ; car, ne croyant pas qu’un homme pût passer la nuit dehors, ils ne pouvaient s’imaginer qu’un évêque fût prosterné devant un seuil étranger, dans l’horreur des ténèbres. Avicien les crut facilement et se rendormit. Mais il est de nouveau réveillé par une puissance supérieure, et s’écrie que Martin est à la porte ; ce qui l’empêche d’avoir aucun repos de corps ou d’âme. Comme les esclaves tardaient à venir, il alla lui-même jusqu’à la porte extérieure, et là il trouva Martin, comme il en avait été averti. Le malheureux, frappé d’un si grand miracle, s’écria : « Pourquoi agir ainsi ? Seigneur, je sais ce que vous désirez, je vois ce que vous demandez ; éloignez-vous de suite, afin que le feu de la colère céleste ne me consume pas, à cause de l’injure que je vous fais ; j’ai assez souffert jusqu’à présent ; croyez-le bien, ce n’est pas sans raison que je suis venu moi-même ici. » Dès que Martin se fut retiré, il appela ses officiers, fit délivrer tous les prisonniers, et bientôt s’éloigna lui-même ; son départ délivra la ville et la remplit de joie.
V. — « C’est Avicien lui-même qui rapporta ce fait à beaucoup de personnes. Le prêtre Réfrigérius, ici présent, l’a récemment entendu raconter par Évagrius, homme rempli de foi et ancien tribun, qui a juré par la majesté divine qu’il le tenait d’Avicien lui-même. Ne vous étonnez point si je fais aujourd’hui ce que je ne faisais point hier ; c’est-à-dire, si à chaque miracle je nomme les témoins et les personnes encore vivantes, auxquelles les incrédules peuvent recourir. J’agis ainsi, parce que certaines personnes ont mis en doute ce que j’ai raconté hier. Je cite donc des témoins encore pleins de vie et de santé ; et ceux qui ne me croient pas auront peut-être plus de confiance en eux ; mais les croiront-ils eux mêmes, ces incrédules ? Je m’étonne qu’avec le moindre sentiment de religion, on puisse être assez coupable pour croire qu’un mensonge est possible en parlant de Martin. Que celui qui craint Dieu éloigne ce soupçon, car Martin n’a pas besoin qu’on se serve du mensonge pour ajouter à sa gloire. Ô Christ ! je te prends à témoin que dans tous mes discours je n’ai rien dit et ne dirai rien que je n’aie vu moi-même, ou que je ne tienne de personnes dignes de foi, et la plupart du temps de Martin lui-même. Quoique j’aie choisi la forme du dialogue, pour éviter la monotonie et varier mes récits, je déclare que je m’en suis loyalement tenu à la vérité de l’histoire. C’est l’incrédulité d’un grand nombre de personnes qui me force, à regret, d’interrompre mon récit. Mais revenons à l’objet de notre réunion ; on m’écoute avec tant d’attention, que je me vois forcé d’avouer qu’Aper avait raison d’éloigner les incrédules, persuadé que ceux-là seulement qui croient doivent m’entendre.
VI. — « En vérité, je suis transporté d’indignation, et la douleur m’égare ; des chrétiens ne croient pas aux miracles de Martin, et les démons y ajoutent foi ! Le monastère du Saint était éloigné de la ville d’environ deux milles. Chaque fois qu’il mettait le pied hors de sa cellule pour aller à l’église, on voyait les énergumènes rugir dans toute l’église, et les coupables trembler comme à l’approche d’un juge ; si bien que les clercs, qui ignoraient l’arrivée de l’évêque, en étaient avertis par les plaintes des démons. J’ai vu un possédé, à l’approche de Martin, s’élever en l’air, les mains étendues, et rester suspendu sans toucher le sol de ses pieds. Lorsque Martin était chargé d’exorciser des démoniaques, il ne les touchait point, ne les réprimandait pas, comme font les clercs, avec un grand bruit de paroles ; mais il faisait approcher les énergumènes, ordonnait à la foule de se retirer ; puis, les portes étant fermées, revêtu d’un cilice, couvert de cendres, il se prosternait au milieu de l’église pour prier. Alors on voyait ces misérables délivrés de diverses manières : les uns, enlevés en l’air par les pieds, semblaient suspendus aux nues, sans que leur vêtement retombât sur leur figure, et que leur nudité choquât la modestie ; les autres étaient cruellement tourmentés, et avouaient leurs noms et leurs crimes, sans qu’on les interrogeât. L’un disait qu’il était Jupiter, l’autre Mercure ; enfin le diable et ses ministres étaient à la torture ; ce qui nous force à avouer qu’en Martin s’est accompli ce qui était écrit : « Les saints jugeront les anges. »
VII. — « La grêle exerçait tous les ans de si affreux ravages sur un village du pays des Sénonais[xix][i], que les habitants, dans cet excès de leurs maux, se déterminèrent à implorer le secours de Martin. Ils lui envoyèrent donc une députation d’hommes honorables, à la tête desquels était Auspicius, ancien préfet, sur les propriétés duquel le fléau faisait ordinairement le plus de dégâts. Après avoir prié dans cet endroit, Martin délivra si complètement tout le pays de cette calamité, que pendant les vingt années qu’il vécut encore la grêle n’y fit de tort à personne. Que l’on n’attribue point cela au hasard, mais plutôt à Martin ; car, l’année même de sa mort, le fléau revint et s’étendit de nouveau sur cette contrée. Le monde se ressentit tellement de la mort de ce saint homme, qu’il pleura la perte de celui dont la vie était pour lui une juste cause de joie. Si, pour s’assurer de la vérité de ce que j’avance, le lecteur incrédule me demande des témoins, je n’en citerai pas seulement un seul, mais plusieurs milliers, et j’appellerai tout le pays de Sens pour rendre témoignage de ce miracle. Mais vous, Réfrigérius, il me semble que vous devriez vous souvenir de ce que nous en avons dit avec le pieux et honorable Romulus, fils d’Auspicius, qui nous racontait ces faits comme si nous les ignorions. Or les pertes continuelles qu’il avait éprouvées le faisaient trembler pour ses récoltes futures ; et il se plaignait amèrement, comme vous l’avez vu, que Martin ne fût plus en vie aujourd’hui.
VIII. — « Mais pour en revenir à Avicien, qui laissait en tous lieux et dans toutes les villes d’horribles traces de sa cruauté, et n’était inoffensif qu’à Tours, cette tête cruelle, avide de sang humain et de supplices, devenait douce et tranquille en présence du bienheureux. Je me rappelle qu’un jour Martin l’alla trouver et entra dans son tribunal, lorsqu’il aperçut un démon d’une grandeur étonnante assis sur son épaule. De loin (ici je suis obligé de me servir d’un mot qui n’est pas très latin) il souffla sur le malin esprit. Avicien croyant qu’il soufflait sur lui : « Pourquoi me recevoir ainsi ? dit-il. — Ce n’est pas sur vous que je souffle, dit Martin, mais sur l’infâme assis sur vos épaules. » Aussitôt le diable abandonna son siège habituel, et c’est un fait constant que depuis ce moment Avicien devint plus doux et plus traitable ; soit que, comprenant qu’il exécutait en tout les volontés du démon, il ait rougi d’être ainsi l’agent du mauvais esprit, soit que ce dernier, chassé par Martin de la place qu’il occupait, ait enfin cessé de l’obséder. Dans le bourg d’Amboise (c’est-à-dire dans le vieux château, maintenant habité par un grand nombre de moines) on voyait un temple d’idoles élevé à grands frais. C’était une tour bâtie en pierres de taille, qui s’élevait en forme de cône, et dont la beauté entretenait l’idolâtrie dans le pays. Le saint homme avait souvent recommandé à Marcel, prêtre de cet endroit, de la détruire. Étant revenu quelque temps après, il le réprimanda de ce que le temple subsistait encore. Celui-ci prétexta qu’une troupe de soldats et une grande foule de peuple viendraient difficilement à bout de renverser une pareille masse de pierres, et que c’était une chose impossible pour de faibles clercs et des moines exténués. Alors Martin, recourant à ses armes ordinaires, passa toute la nuit à prier. Dès le matin s’éleva une tempête qui renversa le temple de l’idole jusque dans ses fondements. Je tiens ce fait de Marcel, qui en fut témoin.
IX. — « Sur le témoignage de Réfrigérius, je vais raconter un miracle semblable au précédent, et accompli en pareille circonstance. Martin désirait renverser une immense colonne, surmontée d’une idole, mais il n’avait aucun moyen d’exécuter ce dessein ; selon sa coutume, il recourut alors à la prière. Tout à coup l’on vit une colonne semblable tomber du ciel sur l’idole, et réduire en poudre cette immense masse de pierres. C’eût été bien peu de chose, si Martin se fût servi invisiblement des puissances du ciel, et si l’œil de l’homme n’eût pu les voir à son service. Le même Rébigérius attestera qu’une femme soufrant d’une perte de sang toucha le vêtement de Martin, à l’exemple de la femme de l’Évangile, et fut aussitôt guérie. Un serpent traversait un fleuve, et nageait vers la rive où nous nous trouvions. « Au nom du Seigneur, dit Martin, je t’ordonne de te retirer. » À la voix du Saint, l’animal pervers se retourna, et, selon notre attente, se dirigea de nouveau vers la rive opposée. Comme nous regardions ce miracle avec étonnement, il se mit à gémir profondément et dit : « Les serpents m’écoutent, et les hommes ne m’écoutent pas. »
X. — « À Pâques, le bienheureux avait coutume de manger un poisson. Un peu avant l’heure du repas, il demanda s’il y en avait. Le diacre Caton, chargé de l’administration du monastère et habile pêcheur, lui dit qu’il n’avait pu rien prendre pendant tout le jour, et que les autres pêcheurs qui en vendaient ordinairement n’avaient pu rien prendre non plus. « Va, dit Martin, jette ton filet, et ta pêche sera fructueuse. » Nos cellules (comme Sulpice l’a écrit) étaient situées près du fleure. Nous allâmes donc tous voir le pêcheur, car c’était un jour de fête, assurés que sa tentative ne serait pas inutile, puisque Martin avait ordonné qu’on péchât pour Martin. Du premier coup de filet (et il était fort petit) le diacre retira un énorme saumon ; il accourut tout joyeux au monastère, et, comme dit je ne sais quel poète (je cite un vers classique, car je parle à des gens lettrés) :
Apporta le sanglier captif aux Argiens étonnés.
C’est ainsi que Martin, véritable disciple du Christ, imitant les miracles que le Sauveur a opérés pour servir d’exemple à ses saints, montrait en lui l’opération de Jésus-Christ, qui glorifiait partout son saint serviteur, et réunissait sur un seul homme tous les dons de la grâce. Arborius, ancien préfet, vous attestera qu’il vit la main de Martin offrant le saint sacrifice briller d’un vif éclat, comme si elle eût été revêtue de magnifiques pierres précieuses, qu’il entendait s’entrechoquer lorsqu’il remuait les mains.
XI. — « J’en viens à ce miracle que Martin cacha toujours, à cause du malheur des temps, mais qu’il ne put nous dissimuler ; je veux parler de la conversation qu’il eut face à face avec un ange. Lorsque Priscillien eut été mis à mort, l’empereur Maxime couvrait de sa protection impériale l’évêque Ithace, et tous ceux de son parti, qu’il n’est pas nécessaire de nommer ici, ne voulant pas qu’on pût lui reprocher d’avoir fait condamner un homme, quel qu’il fût. Martin, forcé d’aller à la cour, afin d’intercéder pour plusieurs personnes en grand danger de mort, eut à supporter tous les coups ‘de la tempête. Des évêques réunis à Trèves, et communiquant tous les jours avec Ithace, avaient ainsi participé à son crime. L’arrivée de Martin, qu’on leur annonça inopinément, les remplit de trouble et d’émoi. La veille déjà l’empereur avait décrété, d’après leur avis, qu’on envoyât en Espagne des tribuns munis de pouvoirs pour rechercher les hérétiques, les mettre à mort et confisquer leurs biens. Il n’était pas douteux que cette tempête ne dût entraîner la perte d’un grand nombre de fidèles, tant il y avait peu de différence entre les hérétiques et ceux qui ne l’étaient pas ; car, à cette époque, les yeux seuls étaient juges, et un homme était convaincu d’hérésie, moins sur l’examen de sa foi, que sur la pâleur de son visage et sur son habit. Les évêques sentaient que de pareils actes ne plairaient point à Martin ; mais comme ils avaient la conscience de leur faute, leur plus grand souci était la crainte qu’à son arrivée il ne voulût pas communiquer avec eux ; car ils savaient bien que son influence lui gagnerait des partisans, qui imiteraient la fermeté d’un si saint homme. De concert avec l’empereur, ils envoyèrent donc au-devant de Martin des officiers chargés de l’empêcher d’entrer à Trèves, à moins qu’il ne déclarât venir en paix avec les évêques réunis dans la ville. Le Saint les trompa habilement, en disant qu’il venait avec la paix du Christ. Il entra pendant la nuit, et se rendit à l’église, seulement pour prier ; le lendemain il alla au palais. Outre les nombreuses requêtes qu’il avait à adresser à l’empereur, et qu’il serait trop long de détailler ici, il avait surtout deux choses à lui demander : la grâce du comte Narsès et du gouverneur Leucade, tous deux ardents partisans de Gratien, et qui s’étaient attirés la colère du vainqueur. Mais le souci principal de Martin était d’empêcher qu’on n’envoyât en Espagne des tribuns avec droit de vie et de mort ; car, dans sa pieuse sollicitude, il voulait sauver non seulement les chrétiens exposés à être persécutés ; mais aussi les hérétiques eux-mêmes. Les deux premiers jours, le rusé Maxime laissa Martin dans l’incertitude, soit pour augmenter l’importance de cette affaire, soit qu’il fût inexorable, ou bien (et c’est l’avis d’un très grand nombre) parce que son avarice l’empêchait d’abandonner des biens qu’il convoitait. Ce prince, que l’on dit doué de nombreuses et belles qualités, ne pouvait résister à l’avarice ; du reste, les besoins du gouvernement le feront peut-être facilement excuser de s’être ainsi ménagé des ressources en toute occasion (car ses prédécesseurs avaient épuisé le trésor public), et il se vit toujours embarrassé par des expéditions ou par les guerres civiles.
XII. — « Cependant les évêques avec lesquels Martin avait refusé de communiquer coururent tout tremblants auprès de l’empereur, se plaignant avec douleur, d’être condamnés d’avance ; c’en était fait d’eux tous, si le puissant Martin se joignait contre eux à l’opiniâtre Théogniste, qui les avait publiquement condamnés ; que Martin n’était déjà plus le défenseur, mais le vengeur dés hérétiques, et que la mort de Prisicillien devenait inutile, puisqu’il se chargeait de la venger. Enfin, prosternés aux pieds de l’empereur, ils le supplièrent avec larmes de faire usage de sa puissance contre lui. Ils avaient presque amené Maxime à confondre Martin parmi les hérétiques ; mais ce prince, malgré sa trop grande déférence pour ces évêques, n’ignorait pas que la foi, la sainteté et les vertus de Martin le rendaient supérieur à tous les mortels. Il essaya donc de le vaincre d’une autre manière ; il le fit secrètement venir près de lui et lui parla avec douceur. « Les hérétiques, dit-il, sont justement coupables, ils ont été condamnés judiciairement, et n’ont point été victimes de la bâtie des évêques ; ce n’est pas une raison suffisante pour refuser de communiquer avec Ithace et ses partisans. Théogniste s’est séparé d’eux plutôt par haine que pour un motif légitime, et il est le seul qui l’ait fait ; les autres évêques n’ont rien changé dans leurs relations avec lui, et le concile lui-même, réuni il y a quelques jours, a déclaré qu’Ithace était innocent. » Comme toutes ces paroles faisaient peu d’impression sur Martin, l’empereur s’enflamma de colère et s’éloigna brusquement ; bientôt après il donna l’ordre d’exécuter ceux pour qui Martin l’avait imploré.
XIII. — « Lorsque Martin l’apprit, il était déjà nuit ; il se rendit précipitamment au palais, et promit à l’empereur de communiquer avec les évêques, s’il pardonnait et rappelait les tribuns envoyés en Espagne pour la ruine des églises. Sans retard, Maxime accorda tout. Le lendemain avait lieu le sacre de l’évêque Félix, très saint homme assurément, et bien digne d’être fait évêque à une meilleure époque. Ce fut ce jour-là que Martin communiqua avec les évêques, pensant qu’il était préférable de céder pour le moment, que d’abandonner ceux que le glaive menaçait. Les évêques s’efforcèrent d’obtenir de lui une attestation écrite de cette communion ; mais ils ne purent y réussir. Il s’éloigna à la hâte le lendemain, en gémissant le long du chemin d’avoir participé pour quelques heures à une coupable communion. Près du bourg d’Andethauna[xx][ii], là où commencent à s’étendre de vastes forêts solitaires, ses compagnons l’ayant un peu dépassé, il s’assit accusant et défendant tour à tour dans son esprit cette communion, cause de sa douleur. Tout à coup un ange se présenta à lui : « Martin, c’est avec raison que tu t’affliges, dit-il, mais tu ne pouvais t’en tirer autrement ; ranime ton courage, afin de ne pas mettre maintenant en péril non ta gloire, mais ton salut. » À partir de cette époque, il se garda de communiquer avec le parti d’Ithace. Comme il délivrait les possédés avec moins de facilité qu’auparavant, il nous avoua en pleurant qu’à cause de cette coupable communion, à laquelle il avait participé un instant par nécessité et non de cœur, il sentait une diminution de sa puissance. Pendant les seize années qu’il vécut encore, il n’assista à aucun concile ou à aucune réunion d’évêques.
XIV. — « Mais cette puissance diminuée pour un temps lui fut, certes, rendue avec usure, comme nous pûmes nous en convaincre. Car je vis plus tard un énergumène, amené à la porte dérobée du monastère, se trouver délivré avant d’en avoir touché le seuil. Une personne qui a été témoin du fait m’a raconté que, se rendant à Rome par la mer Tyrrhénienne, une tempête s’éleva, qui mit dans le plus grand péril la vie de tous les passagers. Alors un marchand égyptien, qui n’était pas encore chrétien, s’écria à haute voix : « Dieu de Martin, sauvez-nous. » À l’instant les flots s’apaisèrent, et pendant le reste du voyage ils demeurèrent calmes et tranquilles. Lycontius, ancien vicaire et homme d’une vive foi, écrivit à Martin pour implorer son secours, car une maladie contagieuse avait atteint ses esclaves et encombré sa maison de malades. Le bienheureux répondit alors que la guérison serait difficile, car le Saint-Esprit lui avait révélé que la main de Dieu s’était appesantie sur cette demeure. Pendant sept jours et sept nuits il ne cessa pas de prier et de jeûner, afin d’obtenir du Seigneur ce qu’il s’était chargé de demander. Bientôt Lycontius accourut vers lui, pénétré de reconnaissance, pour lui annoncer que tous ses esclaves étaient sauvés. Il lui offrit cent livres d’argent que le Saint accepta sans les recevoir ; car, avant que cet argent fût arrivé au monastère, il l’avait déjà employé à racheter des captifs. Et comme les frères lui suggéraient d’en garder un peu pour l’entretien du monastère, lui représentant qu’ils avaient à peine de quoi vivre et que plusieurs d’entre eux manquaient de vêtements, il leur dit : « L’église doit nous nourrir et nous vêtir, pourvu que nous ne demandions rien pour notre usage. » À présent revient à ma mémoire, le souvenir de grands miracles opérés par ce saint prélat, et qu’il est plus facile d’admirer que de rapporter. Vous reconnaîtrez certainement avec moi qu’il y en a beaucoup qu’on ne peut raconter. En voici un, par exemple, que je doute pouvoir vous exposer comme il s’est passé. Un des frères (vous le connaissez, mais je ne le nommerai pas, afin de ne pas causer de honte à un saint homme), ayant trouvé quelques charbons dans le fourneau de Martin, approcha un siège, écarta les jambes et s’assit au-dessus du feu en relevant indécemment sa robe. Martin, s’apercevant aussitôt qu’on profanait sa cellule, s’écria à haute voix : « Quel est celui qui souille ainsi notre chambre ? » Le frère l’entendit, et, reconnaissant la faute qu’on lui reprochait, il accourut tout tremblant auprès de nous, et confessa sa honte et la puissance de Martin.
XV. — « Un jour que Martin était assis dans la petite cour qui entourait sa cellule, sur l’escabeau de bois que vous connaissez tous, il vit deux démons passer sur le rocher élevé qui domine le monastère, et de là, gais et joyeux, pousser des cris d’encouragement : « Allons ! Brice ; courage ! Brice. » Ils voyaient de loin, je crois, ce malheureux qui s’approchait, et savaient bien quelle rage le malin esprit,avait excité dans son cour. Aussitôt Brice entra furieux, et dans sa folie vomit mille injures contre Martin. Ce dernier, en effet, lui avait reproché la veille d’entretenir des chevaux et d’avoir des esclaves, lui qui ne possédait rien avant d’être clerc, et qui avait été élevé, dans le monastère par Martin lui-même. Beaucoup l’accusaient alors d’acheter de jeunes esclaves des deus sexes. Ce fût pour cela que ce malheureux, enflammé d’une colère insensée et surtout, comme je le crois, excité par ces démons, s’emporta si violemment contre Martin, qu’il le menaça presque de le frapper, tandis que le saint, le visage calme, l’âme tranquille, s’efforçait par de douces paroles de calmer l’irritation qui lui troublait le jugement. Le démon avait si bien envahi le cœur de Brice, qu’il eu avait presque perdu la raison ; les lèvres tremblantes, le visage décomposé et pâle de colère, il proférait des paroles de péché, assurant qu’il était plus saint que Martin. « Car moi, disait-il, j’ai passé mes premières années à observer les saintes règles du monastère où vous m’éleviez ; quant à vous, dès votre jeunesse, vous ne pouvez le nier, vous avez été souillé par la licence des camps, et maintenant, dans votre vieillesse, vous êtes tombé dans de vaines superstitions et des visions ridicules. » Après avoir vomi ces injures et d’autres plus graves encore, qu’il vaut mieux taire, il s’éloigna après avoir exhalé sa colère et croyant s’être vengé ; puis il reprit en marchant rapidement la route par laquelle il était venu. Cependant les prières de Martin, j’en suis persuadé, chassèrent les démons du cœur de Brice, qui, plein de repentir, revint tout de suite trouver Martin, se jeta à ses pieds, et, rentrant en lui-même, avoua qu’il avait cédé aux instigations du démon ; rien n’était plus facile à Martin que de pardonner à un suppliant ! C’est alors qu’il nous raconta, ainsi qu’à Brice, comment il avait vu le diable l’agiter et était demeuré insensible à des injures qui nuisaient plutôt à celui qui les proférait. Dans la suite, ce même Brice fut accusé de grands crimes ; mais jamais Martin ne put se résoudre à déposer ce prêtre, de peur de paraître venger une injure personnelle ; souvent il répétait : « Si le Christ a supporté Judas, pourquoi ne supporterai-je pas Brice ? »
XVI. — « Postumianus prit alors la parole : « Voici un bel exemple pour notre voisin ; lorsqu’on l’irrite, malgré tout son bon sens, il oublie le présent et l’avenir, ne se contient plus, s’emporte contre les clercs, attaque les laïques, et remue toute la terre pour se venger. Voilà trois ans qu’il est continuellement en querelle ; ni le temps, ni la raison ne le peuvent apaiser. Qu’il est à plaindre ! que cet état est déplorable ! et ce n’est cependant pas là son seul vice incurable. Tu aurais dû lui raconter souvent, Gallus, ces exemples de patience et de calme, afin qu’il pût oublier ses fureurs et apprendre à pardonner. Si jamais il vient à être instruit de la petite digression qu’il a occasionnée dans mon discours, qu’il considère que je parle plutôt comme ami que comme ennemi ; car, si cela était possible, j’aimerais mieux le voir ressembler au saint évêque qu’au tyran Phalaris. Mais laissons ce souvenir désagréable, et revenons à notre Martin. »
XVII. — « Comme je m’aperçus que le soleil disparaissait à l’horizon et que la nuit arrivait : « La fin du jour approche, dis-je à Postumianus ; levons-nous, car nous devons offrir à souper à des auditeurs aussi attentifs. Ne crois pas pouvoir terminer tes récits sur Martin, c’est une matière abondante qui jamais ne s’épuise. Va porter ces récits à l’Orient, et en retournant sur tes pas, en traversant les ports, les îles et les cités, répands parmi le peuple le nom et la gloire de Martin. N’oublie pas surtout la Campanie ; quoique ce pays ne soit pas sur ton chemin, ne regarde pas à un détour, même considérable, pour visiter l’illustre Paulin, cet homme célèbre dans tout l’univers. Raconte-lui, je t’en prie, tout ce que nous avons dit hier et aujourd’hui ; raconté-lui bien tout, n’oublie rien, afin qu’il fasse connaître à Rome la gloire du bienheureux, comme il a déjà répandu mon livre non seulement en Italie, mais encore dans toute l’Illyrie. Paulin, nullement jaloux de la gloire de Martin, et grand admirateur des miracles opérés en Jésus-Christ, ne refusera point de comparer notre saint évêque avec Félix de Nole. Si, par hasard, tu passes en Afrique, raconte à Carthage ce que tu viens d’entendre, bien que cette ville, comme tu nous l’as dit, connaisse déjà Martin, afin qu’elle ne garde pas toute son admiration pour son martyr Cyprien, qui l’a consacrée en y répandant son sang. Si, inclinant à gauche, tu entres dans le golfe d’Achaïe, apprends à Corinthe et à Athènes que Platon à l’Académie n’a pas surpassé Martin par sa science, et que Socrate dans sa prison ne s’est pas montré plus courageux que lui. Heureuse est la Grèce qui a mérité d’entendre la parole de l’Apôtre ! Mais le Christ n’a pas non plus abandonné les Gaules, à qui il a donné Martin. Lorsque tu seras enfin parvenu en Égypte, quoique cette contrée soit fière de la multitude et des miracles des saints, qu’elle ne dédaigne pas d’apprendre que, grâce au seul Martin, l’Europe ne le cède en rien à l’Asie tout entière.
XVIII. — « Enfin, lorsque tu mettras de nouveau à la voile pour te rendre à Jérusalem, je te charge d’une mission douloureuse : si jamais tu touches au rivage où est située l’illustre Ptolémaïs[xxi][iii], c’est de t’informer avec soin de l’endroit de la sépulture de notre cher Pomponius, et de ne pas refuser une visite à des ossements déposés en terre étrangère. Là, que la douleur que tu éprouves de la perte d’un ami que nous chérissions tous te fasse verser des larmes, et, tout vain que soit cet hommage, couvrir sa tombe de brillantes fleurs et d’herbes odoriférantes. Dis-lui, sans dureté ni sans aigreur en le plaignant, et sans lui adresser de reproches ; que s’il eût voulu suivre toujours tes conseils et les miens, et imiter plutôt Martin que certaine personne que je ne veux pas nommer, jamais il n’aurait été si cruellement séparé de moi ; ses cendres ne reposeraient pas sous le sable d’une plage inconnue ; il n’aurait pas péri au milieu de la mer, comme un pirate naufragé, et n’aurait pas trouvé à grand’peine une sépulture à l’extrémité du rivage. Qu’ils voient leur ouvrage, ceux qui voulurent me nuire en l’éloignant de moi ! et qu’ils cessent maintenant de s’acharner contre moi, puisqu’ils tiennent maintenant leur vengeance. » Ces tristes paroles, prononcées d’une voix altérée, arrachèrent des larmes à tout l’auditoire, qui se leva rempli d’admiration pour Martin, et non moins ému de mes pleurs.
FIN
[xxii][i] Le pays des Sénonais comprenait les départements actuels de l’Yonne, du Loiret, de Seine-et-Marne et de l’Aude.
[xxiii][ii] C’est aujourd’hui le bourg d’Echternach, à l’entrée du Luxembourg, sur la rivière de Sour, à quatorze kilomètres de Trèves.
[xxiv][iii] Aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre, à soixante kilomètres environ au nord de Jérusalem.
- (1)
"The Chronicle";
- (2)
"Life of St. Martin";
- (3) two dialogues, formerly divided into three;
- (4) three
letters.
January 29
St. Sulpicius Severus
[Disciple of
St. Martin] HE 1 was
born in Aquitain, not at Agen, as Scaliger, Vossius, Baillet, &c. have
falsely inferred from a passage of his history, 2 but
near Toulouse. 3 That
he was of a very rich and illustrious Roman family, we are assured by the two
Paulinus’s, and Gennadius. His youth he spent in studying the best Roman
authors of the Augustan age, upon whom he formed his style, not upon the
writers of his own time: he also applied himself to the study of the laws, and
surpassed all his contemporaries in eloquence at the bar. His wife was a lady
of a consular family, whom he lost soon after their marriage, but he continued
to enjoy a very great estate which he had inherited by her. His mother-in-law
Bassula loved him constantly as if he had been her own son: they continued to
live several years in the same house, and had in all things the same mind. 4 The
death of his beloved consort contributed to wean his heart from the world: in
which resolution he seems to have been confirmed by the example and
exhortations of his pious mother-in-law. His conversion from the world happened
in the same year with that of St. Paulinus of Nola, 5 though
probably somewhat later: and St. Paulinus mentions that Sulpicius was younger
than himself, and at that time (that is, about the year 392) in the flower of
his age De Prato imagines Sulpicius to have been ten years younger than St.
Paulinus, consequently that he was converted in the thirty-second year of his
age. Whereas St. Paulinus distributed his whole fortune amongst the poor at
once; Sulpicius reserved his estates to himself and his heirs, employing the
yearly revenue on the poor, and in other pious uses, so that he was no more
than a servant of the church and the poor to keep accounts for them. 6 But
he sold so much of them as was necessary to discharge him of all obligations to
others. Gennadius tells us that he was promoted to the priesthood; but from the
silence of St. Paulinus, St. Jerom, and others, Tillemont and De Prato doubt of
the circumstance. Sulpicius suffered much from the censures of friends who
condemned his retreat, having chosen for his solitude a cottage at Primuliacus,
a village now utterly unknown in Aquitain, probably in Languedoc. In his
kitchen
nothing was ever dressed but pulse and herbs, boiled
without any seasoning, except a little vinegar. He ate also coarse bread. He
and his few disciples had no other beds but straw or sackcloth spread on the
ground. He set at liberty several of his slaves, and admitted them and some of
his old servants to familiar intercourse and conversation. About the year 394,
not long after his retreat, he made a visit to Saint Martin at Tours, and was
so much taken with his saintly comportment, and edified by his pious discourses
and counsels, that he became from that time his greatest admirer, and regulated
his conduct by his direction. Ever after he visited that great saint once or
twice almost every summer as long as he lived, and passed some time with him,
that he might study more perfectly to imitate his virtues. He built and adorned
several churches. For two which he founded at Primuliacus, he begged some
relics of St. Paulinus, who sent him a piece of the cross on which our Saviour
was crucified, with the history of its miraculous discovery by St. Helena. 7 This
account Sulpicius inserted in his ecclesiastical history. These two saints sent
frequent presents to each other of poor garments or the like things, suitable
to a penitential life, upon which they make in their letters beautiful pious
reflections, that show how much they were accustomed to raise their thoughts to
God from every object. 8 Our
saint recommending to St. Paulinus a cook, facetiously tells him that he was
utterly a stranger to the art of making sauces, and to the use of pepper, or
any such incentives of gluttony, his skill consisting only in gathering and
boiling herbs in such a manner that monks, who only eat after having fasted
long, would find delicious. He prays his friend to treat him as he
would his own son, and wishes he could himself have served him and his family
in that quality. 9 In
the year 399 St. Paulinus wrote to our saint that he hoped to have met him at
Rome, whither he went to keep the feast of the prince of the apostles, and
where he had staid ten days, but without seeing anything but the tombs of the
apostles, before which he passed the mornings, and the evenings were taken up
by friends who called to see him. 10 Sulpicius
answered, that an indisposition had hindered him from undertaking that journey.
Of the several letters mentioned by Gennadius, which Sulpicius Severus wrote to
the devout virgin Claudia, his sister, two are published by Baluze. 11 Both
are strong exhortations to fervour and perseverance. In the first our saint
assures her that he shed tears of joy in reading her letter, by which he was
assured of her sincere desire of serving God.
In a letter to Aurelius the deacon, he relates that
one night in a dream he saw St. Martin ascend to heaven in great glory, and
attended by the holy priest Clarus, his disciple, who was lately dead: soon after,
two monks arriving from Tours, brought news of the death of St. Martin. He
adds, that his greatest comfort in the loss of so good a master, was a
confidence that he should obtain the divine blessings by the prayers of St.
Martin in heaven. St. Paulinus mentions this vision in an inscription in verse,
which he made and sent to be engraved on the marble altar of the church of
Primuliacus. 12 St.
Sulpicius wrote the life of the incomparable St. Martin, according to Tillemont
and most others, before the death of that saint: but De Prato thinks that
though it was begun before, it was neither finished nor published till after,
his death. The style of this piece is plainer and more simple than that of his
other writings. An account of the death of St. Martin, which is placed by De
Prato in the year 400, is accurately given by St. Sulpicius, in a letter to
Bassula, his mother-in-law, who then lived at Triers. The three dialogues of
our saint are the most florid of all his writings. In the first Posthumain, a
friend who had spent three years in the deserts of Egypt and the East, and was
then returned, relates to him and Gallus, a disciple of St. Martin, (with whom
our saint then lived under the same roof,) the wonderful examples of virtue he
had seen abroad. In the second dialogue Gallus recounts many circumstances of
the life of St. Martin, which St. Sulpicius had omitted in his history of that
saint. In the third, under the name of the same Gallus, several miracles
wrought by St. Martin are proved by authentic testimonies. 13 The
most important work of our saint is his abridgment of sacred history from the
beginning of the world down to his own time in the year 400. The elegance,
conciseness, and perspicuity with which this work is compiled, have procured
the author the name of the Christian Sallust, some even prefer it to the
histories of the Roman Sallust, and look upon it as the most finished model
extant of abridgments. 14 His
style is the most pure of any of the Latin fathers, though also Lactantius,
Minutius Felix, we may almost add St. Jerom, and Salvian of Marseilles, deserve
to be read among the Latin classics. The heroic sanctity of Sulpicius Severus
is highly extolled by St. Paulinus of Nola, Paulinus of Perigueux, about the
year 460, 15 Venantius
Fortunantus, and many others down to the present age. Gennadius tells us, that
he was particularly remarkable for his extraordinary love of poverty and
humility. After the death of St. Martin, in 400, St. Sulpicius Severus passed
five years in that illustrious saint’s cell at Marmoutier. F. Jerom De Prato
thinks that he at length retired to a monastery at Marseilles, or in that
neighbourhood; because in a very ancient manuscript copy of his works,
transcribed in the seventh century kept in the library of the chapter of Verona,
he is twice called a monk of Marseilles. From the testimony of this manuscript,
the Benedictin authors of the new treatise On the Diplomatique, 16 and
the continuators of the Literary History of France, 17 regard
it as undoubted that Sulpicius Severus was a monk at Marseilles before his
death. Whilst the Alans, Sueves, and Vandals from Germany and other barbarous
nations, laid waste most provinces in Gaul in 406, Marseilles enjoyed a secure
peace under the government of Constantine, who, having assumed the purple,
fixed the seat of his empire at Arles from the year 407 to 410. After the death
of St. Chrysostom in 407, Cassian came from Constantinople to Marseilles, and
founded there two monasteries, one for men, the other for women. Most place the
death of St. Sulpicius Severus about the year 420, Baronius after the year 432;
but F. Jerom De Prato about 410, when he supposes him to have been near fifty
years old, saying that Gennadius, who tells us that he lived to a
very great age, is inconsistent with himself. Neither St. Paulinus nor any
other writer mentions him as living later than the year 407, which seems to prove
that he did not survive that epoch very many years. Guibert, abbot of
Gemblours, who died in 1208, in his Apology for Sulpicius Severus, 18 testifies
that his festival was kept at Marmoutier with great solemnity on the 29th of
January. Several editors of the Roman Martyrology, who took Sulpicius Severus,
who is named in the calendars on this day, to have been this saint, added in
his eulogium, Disciple of St. Martin, famous for his learning and merits. Many
have proved that this addition was made by the mistake of private editors, and
that the saint originally meant here in the Roman Martyrology was Sulpicius
Severus, bishop of Bourges; 19 and
Benedict XIV. proves and declares 20 that
Sulpicius Severus, the disciple of St. Martin, is not commemorated in the Roman
Martyrology. Nevertheless, he has been ranked among the saints at Tours from
time immemorial, and is honoured with a particular office on this day in the
new Breviary used in all that diocess. See his works correctly printed, with
various readings, notes, dissertations, and the life of this saint at Verona in
1741, in two volumes folio, by F. Jerom De Prato, an Italian Oratorian of
Verona: also Gallia Christiana tum Vetus tum Nova: Tillemont, t. 12. Ceillier,
t. 10. p. 635. Rivet, Hist. Litér de la France, t. 2. p. 95.
Note
1. Severus was his own proper name, Sulpicius that of his family, as
is testified by Gennadius and all antiquity. Vossius, Dupin, and some others,
on this account, will have him called Severus Sulpicius, with Eugippius and St.
Gregory of Tours. But other learned men agree, that after the close of the
republic of Rome, under the emperors, the family name was usually placed first,
though still called Cognomen, and the other Prænomen, because the proper name
went anciently before the other. Thus we say Cæcilius Cyprianus, Eusebius
Hieronymus, Aurelius Augustinus, &c. See Sirmond, Ep. prætixa Op. Servati
Lupi, and Hier. De Prato in vita Sulpicii Severi, p. 56, &c.
Note
2. Sulp. Sev. Hist. l. 2. c. 44.Note
3. Ib. c. 48. and Ep. ad Bassulam. de Prato, p. 57
Note
4. S. Paulinus, Ep. 5 & 35.
Note
5. Ib. Ep. 11. n. 6.
Note
6. S. Paulinus, Ep. 1 & 24.
Note
7. Ib. Ep. 52.
Note
8. Sulpic. Sev. Ep. ad Paulin. ed à D’Achery in Spicileg. T. 5.
p. 532. et inter opera S. Paulini, p. 119.
Note
9. Sulp. Sever. Ibid.
Note
10. S. Paulin. Ep. ad Sulpic. Sev. p. 96
Note
11. Baluze, T. 1. Miscellan. p. 329.
Note
12. S. Paulinus. Ep. 32. p. 204.
Note
13. Many, upon the authority of St. Jerom, rank Sulpicius Severus
among the Millenarians, though all allow that he never defended any error so as
to be out of the communion of the church. But that he could not be properly a
Millenarian seems clear from several parts of his writings. For, in Ep 2 and 3.
he affirms, that the souls of St. Martin and St. Claras passed from this world
to the immediate beatific vision of God. He establishes the same principles,
Ep. 1. ad Claudiam Soror. c. 5. And in his Sacred History, l. 2. c. 3.
explaining the dream of Nabuchodonosor he teaches, that the destruction of the
kingdoms of this world will be immediately succeeded by the eternal reign of
Christ with his saints in heaven. In the passage, Dial. 2. c. 14. upon which
the charge is founded, Sulpicius relates in the discourse of Gallus, that St.
Martin on a certain occasion said, that the reign of Nero in the West and his
persecution were immediate forerunners of the last day: as is the reign of
Antichrist in the East, who will rebuild Jerusalem and its temple, reside in
the same, restore circumcision, kill Nero, and subject the whole world to his
empire. Where he advances certain false conjectures about the reign of Nero,
and the near approach of the last judgment at that time: likewise the restoration
of Jerusalem by Antichrist; though this last is maintained probable by cardinal
Bellarmin, l. 3. de. Rom. Pontif. c. 13. But the Millenarian error is not so
much as insinuated. Nor could it have been inserted by the author in that
passage and omitted by copiers, as De Prato proves against that conjecture of
Tillemont. St. Jerom indeed, l. 11. in Ezech. c. 36. represents certain
Christian writers who imitated some later Jews in their Deuteroseis in a carnal
manner of expounding certain scripture prophecies, expecting a second Jerusalem
of gold and precious stones, a restoration of bloody sacrifices, circumcision,
and a Sabbath. Amongst these he names Tertullian in his book De Spe Fidelium,
(now lost,) Lactantius, Victorinus Petabionensis, and Severus (Sulpicius) in
his dialogue entitled, Gallus, then just published: and among the Greeks
Irenæus and Apollinarius. De Prato thinks he only speaks of Sulpicius Severus
by hearsay, because he mentions only one dialogue called Gallus, whereas two
bear that title. At least St. Jerom never meant to ascribe all these errors to
each of those he names; for none of them maintained them all except
Apollinarius. His intention was only to ascribe one point or other of such
carnal interpretations to each, and to Sulpicius the opinion that Jerusalem,
with the temple and sacrifices, will be restored by Antichrist, &c. which
cannot be called erroneous; though St. Jerom justly rejects that
interpretation, because the desolation foretold by Daniel is to endure to the end.
In the decree of Gelasius this dialogue of Gallus is called Apocryphal, but in
the same sense in which it was rejected by St. Jerom. Nor is this exposition
advanced otherwise than as a quotation from St. Martin’s answer on that
subject. See the justification of Sulpicius Severus, in a dissertation printed
at Venice in 1738, in Racolta di Opuscoli Scientifici, t. 18. and more amply by
F. Jerom de Prato, Disser. 5. in Opera Sulpicii Severi, t. 1. p. 259. commended
in the Acta Eruditor. Lipsiæ, ad an. 1760. Gennadius, who wrote about the year
494, tells us, (Cat. n. 19.) that Sulpicius was deceived in his old age by the
Pelagians, but soon opening his eyes condemned himself to five years rigorous
silence to expiate this fault. From the silence of other authors, and the great
commendations which the warmest enemies of the Pelagians bestow on our saint,
especially Paulinus of Milan, in his life of St. Ambrose, (written at latest in
423,) and St. Paulinus of Nola, and Paulinus of Perigueux, (who in 461 wrote in
verse the life of St. Martin,) l. 5. v. 193, &c. some look upon this
circumstance as a slander, which depends wholly on the testimony of so
inaccurate a writer, who is inconsistent with himself in other matters relating
to Sulpicius Severus, whose five years silence might have other motives. If the
fact be true, it can only be understood of the Semi-Pelagian error, which had
then many advocates at Marseilles, and was not distinguished in its name from
Pelagianism till some years after our saint’s death, nor condemned by the
church before the second council of Orange in 529. Pelagius was condemned by
the councils of Carthage and Milevis in 416, and by Pope Innocent I. in 417. If
Sulpicius Severus fell into any error, especially before it had been clearly
anathematized by the church, at least he cannot be charged with obstinacy,
having so soon renounced it. We must add, that even wilful offences are blotted
out by sincere repentance. See F. Jerom De Prato in vita Sulp. Sev. s. 12. p.
69, & 74. t. 1. Op. Veronæ, 1741.
Note
14. The sacred history of Sulpicius Severus is a most useful classic
for Christian schools; but not to be studied in the chosen fragments mangled by
Chompré, and prescribed for the schools in Portugal. True improvement of the
mind is impossible without the beauties of method and the advantages of taste,
which are no where met with but by seeing good compositions entire, and by
considering the art with which the whole is wound up. A small edition of
Sulpicius’s history, made from that correctly published by De Prato, would be
of great service. Nevertheless, Sulpicius, though he has so well imitated the
style of the purest ages, declares that he neglects elegance; and he takes the
liberty to use certain terms and phrases which are not of the Augustan
standard, sometimes because they were so familiar in his time, that he
otherwise would not have seemed to write with ease, and sometimes because they
are necessary to express the mysteries of our faith. How shocking is the
delicacy of Bembo; who, for fear of not being Ciceronian, conjures the
Venetians per Deos immortales, and uses the words Dea Lauretana! or
that of Justus Lipsius, who used Fatum, or destiny, for Providence,
because this latter word is not in Cicero, who, with the Pagans, usually speaks
according to the notion of an overruling destiny in events which they believed
ordained by heaven. For this term some of Lipsius’s works were censured, and by
him recalled.
Note
15. Vit. St. Martin, versu expressa, l. 5. v. 193, &c.
Note
16. Tr. de Diplomatique, T. 3.
Note
17. Hist. Litér. T. 11. Avertissement préliminaire, p. 5.
Note
18. Published by Bollandus, ad 29 Jan. p. 968.
Note
19. See Annatus, Theolog. positives, l. 4. c. 26. and Dominic Georgi
in Notis ad Martyrol. Adonis, ad 17 Jan.
Note
20. Bened. XIV. in litteris apost. præfixis novæ suæ editioni Romani
Martyrologii (Romæ, 1749.) s. 47. p. 34.
Rev. Alban Butler (1711–73). Volume I: January. The Lives of the Saints. 1866.
SOURCE : http://www.bartleby.com/210/1/292.htmlSAINT SULPICIUS
SEVERUS, DISCIPLE OF ST. MARTIN
HE was born in
Aquitaine, not at Agen, as Scaliger, Vossius, Bailiet, &c have falsely
inferred from a passage of his history,1 but near Toulouse. That
he was of a very rich and illustrious Roman family, we are assured by the two
Paulinus’s, and Gennadius.2 His youth he spent in studying the best Roman
authors of the Augustan age, upon whom he formed his style, not upon the
writers of his own time: he also applied himself to the study of the laws, and
surpassed all his contemporaries in eloquence at the bar. His wife was a lady
of a consular family, whom he lost soon after their marriage, but he continued
to enjoy a very great estate which he had inherited by her. His mother-in-law,
Bassula, loved him constantly, as if he had been her own son: they continued to
live several years in the same house, and had in all things the same mind.3 The
death of his beloved consort contributed to wean his heart from the world: in
which resolution he seems to have been confirmed by the example and
exhortations of his pious mother-in-law. His conversion from the world happened
in the same year with that of St. Paulinus of Nola,4 though probably somewhat
later: and St. Paulinus mentions that Sulpicius was younger than himself, and
at that time (that is, about the year 392) in the flower of his age. De Prato
imagines Sulpicius to have been ten years younger than St. Paulinus, consequently
that he was converted in the thirty-second year of his age. Whereas St.
Paulinus distributed his whole fortune among the poor at once; Sulpicius
reserved his estates to himself and his heirs, employing the yearly revenue on
the poor, and in other pious uses, so that he was no more than a servant of the
church and the poor, to keep accounts for them.5 But he sold so much of them as
was necessary to discharge him of all obligations to others. Gennadius tells us
that he was promoted to the priesthood; but from the silence of St. Paulinus,
St. Jerom, and others, Tillemont and De Prato doubt of this circumstance.
Sulpicius suffered much from the censures of friends, who condemned his
retreat, having chosen for his solitude a cottage at Primuliacus, a village now
utterly unknown in Aquitaine, probably in Languedoc. In his kitchen nothing was
ever dressed but pulse and herbs, boiled without any seasoning, except a little
vinegar: he ate also coarse bread. He and his few disciples had no other beds
but straw or sackcloth spread on the ground. He set at liberty several of his
slaves, and admitted them, and some of his old servants, to familiar
intercourse and conversation. About the year 394, not long after his retreat,
he made a visit to St. Martin at Tours, and was so much taken with his saintly
comportment, and edified by his pious discourses and counsels, that he became
from that time his greatest admirer, and regulated his conduct by his
direction. Ever after he visited that great saint once or twice almost every summer
as long as he lived, and passed some time with him, that he might study more
perfectly to imitate his virtues. He built and adorned several churches. For
two which he founded at Primuliacus, he begged some relics of St. Paulinus, who
sent him a piece of the cross on which our Saviour was crucified, with the
history of its miraculous discovery by St. Helena.6 This account Sulpicius
inserted in his ecclesiastical history. These two saints sent frequent presents
to each other, of poor garments of the like things, suitable to a penitential
life, upon which they make in their letters beautiful pious reflections, that
show how much they were accustomed to raise their thoughts to God from every
object.7 Our saint recommending to St. Paulinus a cook, facetiously tells him
that he was utterly a stranger to the art of making sauces, and to the use of
pepper, or any such incentives of gluttony, his skill consisting only in
gathering and boiling herbs in such a manner that monks, who only eat after
having fasted long, would find delicious. He prays his friend to treat him as
he would his own son, and wishes he could himself have served him and his
family in that quality.8 In the year 399 St. Paulinus wrote to our saint that
he hoped to have met him at Rome, whither he went to keep the feast of the
prince of the apostles, and where he had stayed ten days, but without seeing
any thing but the tombs of the apostles, before which he passed the mornings,
and the evenings were taken up by friends who called to see him.9 Sulpicius
answered, that an indisposition had hindered him from undertaking that journey.
Of the several letters mentioned by Gennadius, which Sulpicius Severus wrote to
the devout virgin Claudia, his sister, two are published by Baluze.10 Both are
strong exhortations to fervor and perseverance. In the first, our saint assures
her that he shed tears of joy in reading her letter, by which he was assured of
her sincere desire of serving God. In a letter to Aurelius the deacon, he
relates that one night in a dream he saw St. Martin ascend to heaven in great
glory, and attended by the holy priest Clarus, his disciple, who was lately
dead: soon after, two monks arriving from Tours; brought news of the death of
St. Martin. He adds, that his greatest comfort in the loss of so good a master,
was a confidence that he should obtain the divine blessings by the prayers of
St. Martin in heaven. St. Paulinus mentions this vision in an inscription in
verse, which he made and sent to be engraved on the marble altar of the church
of Primuliacus.11 St. Sulpicius wrote the life of the incomparable St. Martin,
according to Tillemont and most others, before the death of that saint: but De
Prato thinks, that though it was begun before, it was neither finished nor
published till after his death. The style of this piece is plainer and more
simple than that of his other writings. An account of the death of St. Martin,
which is placed by De Prato in the year 400, is accurately given by St.
Sulpicius in a letter to Bassula, his mother-in-law, who then lived at Triers.
The three dialogues of our saint are the most florid of all his writings. In
the first Posthumian, a friend who had spent three years in the deserts of
Egypt and the East, and was then returned, relates to him and Gallus, a disciple
of St. Martin, (with whom our saint then lived under the same roof,) the
wonderful examples of virtue he had seen abroad. In the second dialogue, Gallus
recounts many circumstances of the life of St. Martin, which St. Sulpicius had
omitted in his history of that saint. In the third, under the name of the same
Gallus, several miracles wrought by St. Martin are proved by authentic
testimonies.* The most important work of our saint is his abridgment of sacred
history from the beginning of the world down to his own time, in the year 400.
The elegance, conciseness, and perspicuity with which this work is compiled,
have procured the author the name of the Christian Sallust; some even prefer it
to the histories of the Roman Sallust, and look upon it as the most finished
model extant of abridgments.† His style is the most pure of any of the Latin
fathers, though also Lactantins, Minutius Felix, we may almost add St. Jerom,
and Salvian of Marseilles, deserve to be read among the Latin classics. The
heroic sanctity of Sulpicius Severus is highly extolled by St. Paulinus of
Nola, Paulinus of Perigueux, about the year 460.12 Venantius Fortunatus, and
many others, down to the present age. Gennadius tells us, that he was
particularly remarkable for his extraordinary love of poverty and humility.
After the death of St. Martin, in 400, St. Sulpicius Severus passed five years
in that illustrious saint’s cell at Marmoutier. F. Jerom de Prato thinks that
he at length retired to a monastery at Marseilles, or in that neighborhood;
because in a very ancient manuscript copy of his works, transcribed in the
seventh century, kept in the library of the chapter of Verona, he is twice
called a monk of Marseilles. From the testimony of this manuscript, the
Benedictin authors of the new treatise On the Diplomatique,13 and the
continuators of the Literary History of France,14 regard it as undoubted that
Sulpicius Severus was a monk at Marseilles before his death. While the Alans,
Sueves, and Vandals from Germany and other barbarous nations, laid waste most
provinces in Gaul in 406, Marseilles enjoyed a secure peace under the
government of Constantine, who, having assumed the purple, fixed the seat of
his empire at Arles from the year 407 to 410. After the death of St. Chrysostom
in 407, Cassian came from Constantinople to Marseilles, and founded there two
monasteries, one for men, the other for women. Most place the death of St.
Sulpicius Severus about the year 420, Baronius after the year 432; but F. Jerom
de Prato about 410, when he supposes him to have been near fifty years old,
saying that Gennadius, who tells us that be lived to a very great age, is
inconsistent with himself. Neither St. Paulinus nor any other writer mentions
him as living later than the year 407, which seems to prove that he did not
survive that epoch very many years. Guibert, abbot of Gemblours, who died in
1208, in his Apology for Sulpicius Severus,15 testifies that his festival was
kept at Marmoutier with great solemnity on the 29th of January. Several editors
of the Roman Martyrology, who took Sulpicius Severus, who is named in the
calendars on this day, to have been this saint, added in his eulogium. Disciple
of St. Martin, famous for his learning and merits. Many have proved that this
addition was made by the mistake of private editors, and that the saint
originally meant here in the Roman Martyrology was Sulpicius Severus, bishop of
Bourges;16 and Benedict XIV. proves and declares17 that Sulpicius Severus, the
disciple of St. Martin, is not commemorated in the Roman Martyrology.
Nevertheless, he has been ranked among the saints at Tours from time
immemorial, and is honored with a particular office on this day in the new
breviary used in all that diocese. See his works correctly printed, with
various readings, notes, dissertations, and the life of this saint, at Verona
in 1741, in two volumes folio, by F. Jerom de Prato, an Italian Oratorian of
Verona: also Gallia Christiana tum Vetus tum Nova: Tillemont, t. 12. Ceillier,
t. 10, p. 635. Rivet, Hist. Littér, de la France, t. 2, p. 95.