Détail
d'une miniature du Maître de Jacques de Besançon. Jacques
de Voragine prêchant,
tirée d'un manuscrit de la Légende dorée, vers 1480.
Bienheureux Jacques de
Voragine
Frère prêcheur,
archevêque de Gênes (+ 1298)
Originaire de Varazze (Voragine) en Italie, d'où son nom, dans la région de Savone, il entra dans l'Ordre de saint Dominique dont il devint le provincial pendant 19 ans. Devenu évêque de Gênes, il écrivit une compilation des "Légendes dorées des saints"*, riche d'enseignement moral mais aussi accompagnée souvent de récits étranges et légendaires. Il a été béatifié en 1816.
* Numérisation Abbaye Saint Benoît de Port-Valais.
À Gênes en Ligurie, en 1298, le bienheureux Jacques de Voragine, évêque, de
l'Ordre des Prêcheurs. Pour promouvoir dans le peuple la vie chrétienne, il
proposa dans ses écrits les vertus des saints.
Martyrologe romain
Nous avons besoin de
saints comme protecteurs à invoquer, comme modèles à imiter, et surtout comme
signes transparents de la présence de l'amour du Christ. C'est la sainteté qui
rend crédible et fructueuse l'évangélisation, parce que, comme on l'a dit,
'seule une flamme peut allumer une autre flamme' (Léon Harmel).
SOURCE : https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1498/Bienheureux-Jacques-de-Voragine.html
Voragine Jacques de
Hagiographe italien (v.
1230-1298), archevêque de Gênes, commentateur de Saint Augustin et auteur
d'une Chronique de Gênes, il est surtout connu pour sa Légende dorée,
une compilation des vies légendaires et miraculeuses des saints et saintes du
calendrier liturgique. Un des grands classiques de la littérature chrétienne
populaire, ce recueil de récits hagiographiques marque une des premières
tentatives de laïcisation de la littérature religieuse. On compte plusieurs
incunables parmi les premières éditions imprimées de l'ouvrage qui connut un
immense popularité et fut une source d'idéal pour la chrétienté durant tout le
Moyen-Âge et la Renaissance. «En rendant la religion plus ingénue, plus
populaire, et plus pittoresque, il l'a presque revêtue d'un pouvoir nouveau: ou
du moins il a permis aux âmes d'y prendre un nouvel intérêt, et, pour ainsi
dire, de s'y réchauffer plus profondément», note T. Wyzewa qui fut un des
premiers à réhabiliter l'oeuvre dont la popularité ne put résister, au XVIe
siècle, au moment de la Réforme, à la critique des humanistes. Ceux-ci s'en
moquaient et la qualifiaient de Légende de «fer» ou de «plomb» pour souligner
la crédulité de son auteur auquel ils reprochaient de colporter des récits sans
fondements historiques et de propager, à travers le culte des saints, une
nouvelle forme d'idolâtrie. Il faut dire que l'oeuvre a été en partie victime
de sa popularité et que de très nombreux ajouts — les premières éditions ne
comportaient que 270 chapitres alors que des éditions ultérieures pouvaient en
contenir jusqu'à 480 — sont venus déformer le projet initial de l'archevêque
génois.
«L'auteur de
la Légende Dorée, nous dit son traducteur Teodor
de Wyzewa, était à la fois, un des hommes les plus savants de son temps, et
un saint. Sa vie, si quelque érudit voulait prendre la peine d'en reconstituer
le détail, enrichirait d'un chapitre précieux l'histoire de la pensée
religieuse au treizième siècle; et puis l'on en tirerait une petite
"compilation", qui mériterait d'avoir sa place entre les plus belles
et touchantes vies de saints qu'il nous a, lui-même, contées. Mais, du reste,
son livre suffit à nous le faire connaître tout entier. Le savant s'y montre à
chaque page, aussi varié dans ses lectures qu'original, ingénieux, souvent
profond dans ses réflexions; et sans cesse, sous la science du théologien, nous
découvrons une âme infiniment pure, innocente, et douce, une vraie âme d'enfant
selon le cœur du Christ.»
Entrez dans une vieille
église de Bruges, de Cologne, de Tours ou de Sienne: toutes les œuvres d'art
qui vous y accueilleront ne sont que des illustrations immédiates, littérales,
de la Légende Dorée. C'est d'après Jacques de Voragine que Memling et
Carpaccio nous racontent le voyage de sainte Ursule avec ses onze mille
compagnes. Quand Piero della Francesca, dans ses fresques d'Arezzo, ou Agnolo
Gaddi dans celles de Florencé, nous font assister aux aventures diverses du
bois de la sainte Croix, ils suivent de phrase en phrase le texte de
la Légende Dorée. D'autres prennent même, dans le vieux livre, des
sujets profanes, et, comme Thierry Bouts au Musée de Bruxelles, nous
détaillent, d'après l'Histoire Lombarde, un acte de justice de
l'empereur Othon. Et il n'y a point jusqu'aux grands tableaux. de Rubens, de
Murillo, de Poussin, qui ne reproduisent les scènes des martyres des saints ou
de leurs miracles exactement comme le bienheureux évêque de Gênes les a
"compilées" à notre intention. Toute la part que, aujourd'hui encore,
notre imagination mêle à ce que nous apprennent, de l'histoire sacrée, les
Écritures et la Tradition, tout cela nous vient, en droite ligne, de
la Légende Dorée.
L'auteur de
la Légende Dorée était, à la fois, un des hommes les plus savants de
son temps, et un saint. Sa vie, si quelque érudit voulait prendre la peine d'en
reconstituer le détail, enrichirait d'un chapitre précieux l'histoire de la
pensée religieuse au treizième siècle; et puis l'on en tirerait une petite
«compilation», qui mériterait d'avoir sa place entre les plus belles et
touchantes vies de saints qu'il nous a, lui-même, contées 1. Mais, du reste,
son livre suffit à nous le faire connaître tout entier. Le savant s'y montre à
chaque page, aussi varié dans ses lectures qu'original, ingénieux, souvent
profond dans ses réflexions; et sans cesse, sous la science du théologien, nous
découvrons une âme infiniment pure, innocente, et douce, une vraie âme d'enfant
selon le cœur du Christ.
Le bienheureux Jacques est né, en l'année 1228, à Varage, d'où son nom latin:
Jacobus de Voragine. Et j'imagine que c'est, ensuite, l'erreur d'un copiste
qui, en substituant un o au premier a de son nom, aura valu
à l'auteur de la Légende Dorée de devenir, pour la postérité, Jacques
de Voragine.
Quant à Varage [Varazza], où il est né, c'est une charmante, ville de la côte
de Gênes, à mi-chemin entre Savone et Voitri. Moins heureuse que sa voisine
Cogoleto, — qui fut, comme l'on sait, la patrie de Christophe Colomb, — la
patrie de Jacques de Voragine n'a rien gardé de ses édifices d'autrefois, à
l'exception des ruines imposantes de ses remparts, et d'une haute tour de
briques que le petit Jacques, peut-être, aura vu construire: car, avec
l'élancement léger de ses colonnettes, et la sveltesse du clocheton pointu dont
elle est couronnée, elle doit dater de cette première moitié du XIIIe siècle
qui fut, en Italie, une époque incomparable de renaissance chrétienne. Et si le
reste de la ville s'est entièrement renouvelé, depuis cette époque, tout y a
conservé cependant son caractère ancien, ou, pour mieux dire, éternel. Entre
des maisons modernes serpentent, de même que jadis, d'étroites rues pleines
d'ombre. Sur la plage ensoleillée, d'honnêtes artisans façonnent, à leur
loisir, des barques de pêche, pareilles à celles que façonnait, peut-être, le
père de l'auteur de la Légende Dorée, dont un chroniqueur génois nous
apprend «qu'il est né de condition basse dans une petite terre». Plus haut,
au-delà des vieux remparts crénelés, se déploie un cirque merveilleux de
collines plantées d'oliviers; et, de quelque côté que les yeux se tournent, ces
collines sont plantées aussi de couvents, de chapelles, de chemins de croix,
qui créent autour de la petite ville une atmosphère de piété ingénue et joyeuse.
Mais nulle part l'âme de Varage ne subsiste plus vivante que sur la place
carrée du Municipe, où l'on arrive, du quai, par une belle porte à créneaux de
style féodal. C'est là, sans doute, que se sont réunis en grand apparat, le 19
février 1251, les représentants des cités de Savone, d'Albenga et de
Vintimille, pour jurer soumission et fidélité à la république de Gênes.
Aujourd'hui, la Place du Municipe n'a plus guère l'occasion d'assister à des
scènes aussi solennelles: mais à toute heure des badauds s'y promènent de long
en large, des mendiants y jouissent doucement de la vie, des enfants y courent
en se querellant; et c'est là encore que se trouve le marchand d'oiseaux. J'ai
vu chez lui, dans des cages de bois, des merles, des fauvettes, et un couple de
jeunes verdiers, qui m'ont rappelé avec quel empressement Jacques de Voragine,
leur vénérable concitoyen, avait accueilli dans sa Légende toute
sorte d'oiseaux, depuis les moineaux de saint Rémy jusqu'à la perdrix de
l'apôtre saint Jean. Et ainsi cette petite place m'apparaissait tout imprégnée
de son souvenir, lorsque, relevant la tête, je l'ai aperçu lui-même qui me
souriait paternellement. Les habitants de Varage ont eu, en effet, l'excellente
idée de placer sa statue dans une niche, au fronton de leur maison communale.
Peut-être, seulement, avec un légitime désir de mieux accentuer son autorité,
lui ont-ils laissé faire des épaules trop larges et un ventre trop fourni: de
telle sorte qu'on a d'abord quelque peine à reconnaître, dans ce majestueux
prélat, l'humble moine qui, jusque sur le trône archiépiscopal de Gênes, s'est
plu à vivre en pauvre au profit des pauvres. Mais, ressemblant ou non,
c'est lui qui se tient là; et, sous sa statue, une inscription latine nous
apprend que, dès l'année 1645, la ville de Varage «se l'est choisi pour patron
céleste», quem cives sui anno 1645 patronem cœlestenz sibi
adscriverunt. Aussi veille-t-il, depuis lors, sur la petite ville, y
maintenant une paix, une grâce, une sérénité, dont je ne crois pas qu'aucune
autre ville de cette âpre Rivière ligure offre l'équivalent.
Le vent même y est tiède et léger, au plus rude de l'hiver. Et quand ensuite,
dans les rues de Gênes, on grelotte au soleil sous une bise glacée, on ne peut
se défendre d'un vif sentiment de dépit contre l'ingratitude des Génois, qui,
peut-être, a attiré sur leur ville cette calamité. Car si Jacques de Voragine
est né à Varage, c'est à Gênes qu'il a prodigué tous les trésors de son âme de
saint. Il y a joué un rôle si actif et si bienfaisant que les historiens les
plus «libéraux», — qui racontent le passé de l'Italie comme si les événements
religieux n'y avaient, pour ainsi dire, point tenu de place, —sont tous
contraints pourtant de rendre hommage au «pieux évêque» de Gênes, père des
pauvres, et «pacificateur des discordes civiles». Or, en vain on chercherait,
dans toute la ville de Gênes, la moindre trace de son souvenir. Entre des
centaines de plaques commémoratives, célébrant un séjour de Garibaldi, ou la
munificence d'un riche bourgeois qui a fait entourer d'un grillage le pont de
Carignan, «pour empêcher les désespérés de s'ôter la vie», en vain on
chercherait une inscription où figurât le nom du saint évêque
«pacificateur». En vain on chercherait son nom sur les plaques blanches
des via, vivo, vicolo, sauta, dont la vieille cité ligure est plus
abondamment pourvue qu'aucune ville d'Europe. Et l'on songe que cet hommage-là,
du moins, serait bien dû à un homme qui non seulement a comblé Gênes de
services plus précieux encore que les Manin et les Mazzini, mais qui a en
outre, pendant plus de trois siècles, nourri la chrétienté tout entière de
belles histoires et de beaux sentiments.
Mais je m'aperçois que je n'ai pas dit encore le peu que je sais sur la vie de
l'auteur de la Légende Dorée, et sur son séjour à Gênes en
particulier.
Né en 1228, il avait seize ans lorsque, en 1244, il entra dans l'ordre des
Frères Prêcheurs, fondé par saint Dominique en 1215. Cet ordre avait été fondé
surtout, on ne l'ignore pas, pour «extirper les hérésies», ce qui lui assignait
une tâche plutôt belliqueuse. Mais, par un phénomène singulier, l'ordre des
Frères Prêcheurs a produit, en plus grand nombre même que l'ordre rival des
Frères Mineurs, des moines d'une suavité d'âme toute franciscaine. Tel fut,
notamment, saint Thomas d'Aquin, le «docteur angélique»; tels le bienheureux
Fra Angelico et son frère Fra Benedetto; tel encore, un siècle plus tard, le
délicat rêveur Fra Bartolommeo. Et le Frère Jacques de Voragine était de leur
race. Tour à tour novice, moine, professeur de théologie, prédicateur, il
unissait à l'éclat de sa science des mœurs si pures et une vertu si aimable
que, aujourd'hui encore, tous les couvents dominicains du Nord de l'Italie
conservent le souvenir de sa sainteté. À trente-cinq ans, il fut élu par ses Frères
prieur de son couvent. Puis, en 1267, ils lui confièrent le gouvernement
général des monastères dominicains de la provinée de Lombardie: fonction
infiniment fatigante et difficile, qu'il fut contraint de remplir pendant
dix-huit ans.
À peine était-il enfin parvenu à s'en décharger que, en 1288, à la mort de
l'archevêque de Gênes Charles Bernard de Parme, le chapitre le choisit
pour succéder à ce prélat. Nous ne savons pas s'il fit alors comme saint
Grégoire, qui s'était échappé de Rome dans un tonneau en apprenant qu'on
s'apprêtait à le proclamer pape: nous savons, en tout cas, qu'il refusa
obstinément le nouvel honneur dont on le menaçait; et ce fut le patriarche
d'Antioche, Obezzon de Fiesque, qui fut nommé à sa place. Mais quand celui-ci
mourut, quatre ans plus tard, le peuple de Gênes tout entier se joignit au
chapitre pour exiger que le Frère Jacques devînt leur évêque. Le saint moine,
cette fois, dut se résigner; et il dut se résigner encore au voyage de Rome, le
pape Nicolas IV lui ayant exprimé le désir de le sacrer de ses propres mains.
Malheureusement Nicolas IV mourut, le 4 avril, sans avoir pu réaliser son
désir: et tout de suite Jacques de Voragine, s'étant fait sacrer par l'évêque
d'Ostie, reprit le chemin de son diocèse, qu'il s'engagea, dès lors, à ne plus
quitter.
Aussi bien les occasions n'y manquaient-elles point, pour lui, de remplir son
rôle d'évêque tel qu'il le concevait. Il y avait, avant tout, à essayer de
ramener la paix dans la ville de Gênes, dont les citoyens, vainqueurs de leurs
ennemis de Savone et de Pise, n'en étaient devenus que plus ardents à s'égorger
entre eux. Sans cesse les Guelfes, partisans des Fiesque et des Grimaldi,
protestaient contre la domination du parti gibelin en brûlant des maisons, en
saccageant des églises, en assassinant, au détour d'une ruelle, quelque
inoffensif client des Doria ou des Spinola: et l'on entend bien que les
Gibelins, étant les plus forts, ne se faisaient pas faute, le jour suivant, de
le leur prouver par des procédés tout pareils. Depuis des années, la guerre
sévissait à demeure dans les rues de Gênes une guerre si violente que les
Génois en étaient presque, aussi fiers que de leurs colonies, se glorifiant
volontiers d'exceller autant dans les luttes civiles que dans les navales. Or, en
1295, après trois années d'efforts, leur évêque Jacques de Varage obtint d'eux
cette chose incroyable: que Guelfes et Gibelins consentissent solennellement à
se réconcilier. Pour la première fois, depuis un demi-siècle, un calme
fraternel régna dans les petites rues voisines de Saint-Laurent, de
Saint-Donat, et de Saint-Mathieu, qui formaient alors le centre de la vie
génoise. Et quand, onze mois plus tard, les Guelfes, excités en secret par le
roi de Naples Charles II, attaquèrent de nouveau le parti des Spinola, on vit,
racontent les chroniqueurs, «le pieux évêque Jacques de Varage se précipiter
entre les combattants, pour les séparer au péril de sa vie».
Mais pomment résisterais-je à la tentation de citer le passage de
la Chronique de Gênes où Jacques de Voragine nous raconte lui-même
ces événements, n'oubliant que de faire la moindre allusion à la part très
active que, de l'aveu de tous, nous savons qu'il y a prise? Voici ce passage,
traduit non pas sur l'inexacte copie de la Chronique de Gênes qui
se trouve dans le recueil de Muratori, mais sur un manuscrit magnifique et
vénérable de la Bibliothèque Municipale de Gênes, datant, selon toute
apparence, de la première moitié du XIVe siècle. Le saint prélat, après s'être
longuement étendu sur les mérites des évêques et archevêques ses prédécesseurs,
arrive enfin à son propre épiscopat. «Le frère Jacques, — nous dit-il, —
huitième archevêque de Gênes, a été élu en 1292, et vivra tant que Dieu voudra
bien le laisser en vie.» Puis il mentionne son voyage à Rome, et la mort du
pape Nicolas, «qui, croyons-nous, est entré ainsi au palais céleste». Et voici
toute la fin de cette touchante autobiographie: L'an du Seigneur 1295, au mois
de janvier, fut conclue une paix générale et universelle, dans la ville de
Gênes, entre ceux qui s'appelaient Mascarati, ou Gibelins, et ceux qui
s'appelaient Rampini, ou Guelfes entre lesquels, en vérité, le malin esprit
avait depuis longtemps suscité de nombreuses divisions et querelles de parti.
Soixante ans durant, ces dissensions pleines de dangers avait troublé la ville.
Mais, grâce à la protection spéciale de Notre-Seigneur, tous les Génois sont
enfin revenus à la paix et à la concorde, de telle manière qu'ils se sont juré
de ne plus faire qu'une seule société, une seule fraternité, un seul corps. Ce
qui a produit tant de joie que la ville entière s'est remplie de gaîté. Et nous
aussi, dans l'assemblée solennelle où fut conclue la paix, vêtu de nos
ornements pontificaux, nous avons prêché la parole de Dieu; après quoi, avec
notre clergé, nous avons chanté Te Deum laudamus, ayant auprès de
nous quatre évêques et abbés mitrés. Mais comme, dans ce bas monde, il ne
saurait y avoir de pur bien, — car le pur bien est au ciel, le pur mal en
enfer, et notre monde est un mélange de bien et de mal, — voilà que, hélas!
notre cithare a dût changer ses cantiques joyeux en de nouvelles plaintes, et
l'harmonie de nos orgues a été interrompue par des voix pleines de larmes! En
effet, dans cette même année, au mois de décembre, cinq jours après Noël,
l'ennemi de la paix humaine a excité nos concitoyens à une telle discorde et
tribulation que, au milieu des rues et des places, ils se sont attaqués l'un
l'autre, les armes en main. À quoi ont succédé nombre de meurtres, de
blessures, d'incendies et de rapines. Et l'aveuglement de la haine commune est
allé si loin que, pour s'emparer de la tour de notre église de Saint-Laurent,
une troupe de nos concitoyens n'a pas craint de mettre le feu à l'église, dont
tout le toit s'est trouvé brûlé. Et cette périlleuse sédition a duré depuis le
cinquième jour de Noël jusqu'au jour du 7 février. C'est à la suite des
événements susdits qu'on a décidé de nommer capitaines du peuple messires
Conrad Spinola et Conrad Doria.
Et non moins admirable, non moins digne d'être commémoré, fut le rôle joué à
Gênes par Jacques de Voragine en tant que père des pauvres de son diocèse. De
cela non plus il ne fait point mention, dans sa Chronique; mais les
auteurs génois s'accordent à nous dire que, durant les six années dee son
épiscopat, la ville a été comblée de sa charité. «Toutes les vertus
rivalisaient en lui», reconnaît Muratori, peu suspect de partialité à l'égard
d'un homme dont il traite l'œuvre entière de «bavardage imbécile». D'autres
nous affirment que, aussi longtemps qu'il fut évêque, pas une fois on ne le vit
manger à sa faim. Il allait lui-même soigner les malades, dans les ruelles du
port. Il s'était fait donner une liste des indigents et «les visitait du matin
au soir, s'entretenant avec eux de leurs menues affaires». Son revenu et celui
de son église, qui, au dire de Muratori, était «des plus gras», tout allait aux
pauvres. Pour avoir autrefois compilé avec attendrissement les histoires de
saint Jean l'Aumônier, de saint Basile, et d'autres «fous de charité», ces grands
saints avaient daigné permettre à leur biographe de leur ressembler. Et
j'imagine que lui aussi, comme l'abbé Sérapion, aurait été heureux de vendre
son évangile pour nourrir un mendiant: après quoi il aurait répondu à ceux qui
se seraient avisés de le lui reprocher: «Ce livre me disait de vendre ce que
j'avais pour en donner le prix aux pauvres. Or je n'avais plus que lui. Comment
aurais-je pu m'empêcher de le vendre?»
Avant de mourir, en 1298, il défendit qu'on privât les pauvres du prix de ses
funérailles. Et il demanda que son corps, au lieu de reposer dans la cathédrale
auprès de ceux des autres évêques, fût transporté dans l'Église de son ancien
couvent, où on l'a, en effet, déposé, à gauche du chœur. Mais l'église de
Saint-Dominique a été démolie, il y a quelques années, et parmi ce que l'on a
conservé de ses débris, à l'Académie des Beaux-Arts et au Palais-Blanc,
vainement j'ai cherché un vestige de la sépulture de Jacques de Voragine.
Je crois en revanche qu'on pourrait aisément, dans les bibliothèques françaises
et italiennes, retrouver des copies de tous ses ouvrages, car tous, sans parler
de la Légende Dorée, ont eu jusqu'au XVe siècle une célébrité
universelle; et quelques-uns ont même été imprimés. À l'exception de
la Chronique de Gênes, dont on vient de lire les dernières pages, ils
datent tous des années qui ont précédé l'avènement du Frère Prêcheur à
l'épiscopat. Les auteurs contemporains mentionnent, surtout, une traduction de
la Bible en langue italienne, un volumineux commentaire de saint Augustin, et
plusieurs recueils de sermons. J'ai eu entre les mains un de ces recueils, à la
Bibliothèque Municipale de Tours, qui, si même elle n'avait hérité que du seul
fonds de Marmoutier; aurait encore de quoi être une des plus riches
bibliothèques de France en œuvres religieuses du Moyen Âge. Et, en vérité, les
sermons de Jacques de Voragine m'ont paru valoir, eux aussi, que quelque pieux
savant prit un jour la peine de nous les révéler. Tout comme la Légende Dorée, ils ont, sous leur appareil scolastique, une simplicité et une
bonhommie très originales, et les mieux faites du monde pour nous émouvoir. Le
seul malheur est que l'appareil scolastique y tient une place infiniment plus
considérable que dans la Légende Dorée, avec une telle quantité de
divisions et de subdivisions, de points coupés en d'autres points qui se
trouvent coupés à leur tour, que, à chaque ligne, un lecteur d'à présent risque
de perdre le fil de l'argumentation, étant donnée surtout l'absence complète de
tout signe graphique qui puisse l'aider à se reconnaître. Et je crains bien que
des motifs semblables ne nous interdisent, à jamais, de prendre plaisir et,
profit à la lecture des Commentaires de Jacques de Voragine sur saint
Augustin.
Mais d'ailleurs aucun autre des livres du savant et saint moine n'a eu, même en
son temps, un succès comparable à celui de cette Légende des
Saints que, presque dès son apparition, l'Europe tout entière s'est plus
appeler la Légende Dorée. Ce livre sans pareil doit avoir été écrit
vers 1255, lorsque l'auteur n'était encore qu'un tout jeune professeur de
théologie: car l'Histoire Lombarde, qui en forme l'appendice,
s'arrête à la mort de Frédéric II, sans même signaler l'élection au trône
pontifical d'Alexandre IV 2. Resterait l'hypothèse que Jacques de Voragine eût
écrit sa Légende après l'Histoire Lombarde, et se fût,
ensuite, borné à joindre à son nouveau livre cette chronique, rédigée quelques
années plus tôt mais il n'eût point manqué, en ce cas, de mettre au courant la
fin de sa chronique, de même qu'il a fait pour le commencement: puisque, aussi
bien, parmi les innombrables erreurs qui ont cours, depuis le seizième siècle,
au sujet de la Légende Dorée, aucune n'est plus scandaleusement
injuste que celle qui consiste à représenter comme une rapsodie, comme un
mélange incohérent de morceaux rassemblés au hasard, un livre d'une unité et
d'un ensemble parfaits, où chaque récit se trouve expressément chargé de
compléter, de rectifier, ou de nuancer quelque récit précédent.
Non, la Légende Dorée n'est pas une simple rapsodie, ainsi que l'ont
prétendu des critiques, et même des traducteurs, qui, croirait-on, ne se sont
jamais sérieusement occupés de la lire! Et pas davantage elle n'est une
«compilation», au sens ou nous entendons aujourd'hui ce mot. On trouve bien,
dans les éditions de la fin du XVe siècle, deux histoires, celle de Sainte
Apolline et celle de Sainte Paule, qui reproduisent, mot pour
mot, des textes antérieurs: et ce sont celles-là qu'on cite, quand on veut
prouver que Jacques de Voragine s'est contenté de transcrire, dans son livre,
des passages copiés à droite et à gauche. Mais le fait est que ces deux
histoires ne sont point de Jacques de Voragine, car elles manquent non
seulement dans la plupart des vieux manuscrits, mais même dans les premières
éditions imprimées. Ce sont donc de ces innombrables interpolations que, au
cours des siècles, les copistes ont introduites dans 1e texte original de
la Légende Dorée 3: et j'ajoute que, si même nous n'avions pas
la ressource de pouvoir reconstituer ce texte original en éliminant tous les
chapitres qui ne figurent point dans les premiers manuscrits, le style des
chapitres ajoutés suffirait à nous mettre en défiance contre eux. Car Jacques
de Voragine n'est peut-être pas un grand écrivain: mais à coup sûr il possède
un style qui lui appartient en propre, un style, et une façon de composer, et
surtout une façon de raconter; de telle sorte que les citations les plus
diverses prennent aussitôt, sous sa plume, la même allure et le même attrait.
Que l'on compare, à ce point de vue, son récit des martyres des saints avec le
récit qu'en donne le Bréviaire: ou, plutôt encore, qu'on compare ses
légendes de Saint Jean l'Aumônier, de Saint Antoine, de Saint
Basile, avec le texte de la Vie des Pères, d'où il nous dit
qu'il les a «directement extraites»! Et l'on comprendra alors ce que sa
«compilation» impliquait de travail personnel, de réelle et
précieuse création littéraire. Et l'on comprendra aussi, très
clairement, le caractère et la portée véritables de la Légende Dorée.
Mais avant de définir ce caractère et cette portée, il y a une autre erreur
encore que je dois signaler celle qui consiste à voir dans la Légende
Dorée un recueil de «légendes», autant dire de fables, et présentées comme
telles par l'auteur lui-même. En réalité, Legenda Sanctorum signifie:
lectures de la vie des saints. Legenda est ici l'équivalent du
mot lectio, qui, dans le Bréviaire, désigne les
passages des auteurs consacrés que le prêtre est tenu de lire entre deux
oraisons. Et Jacques de Voragine n'a nullement l'intention de nous donner pour
des fables les histoires qu'il nous raconte. Il entend que son lecteur les
prenne au sérieux, ainsi qu'il les prend lui-même, sauf à exprimer souvent des
réserves sur la valeur de ses sources, ou, avec une loyauté admirable, à mettre
vivement en relief une contradiction, une invraisemblance, un risque d'erreur.
Et de là ne résulte point que nous devions, aujourd'hui, admettre la vérité de
tous ses récits: aucun d'eux, au moins dans le détail, n'est proprement article
de foi. Mais par là s'explique que lui, l'auteur, admettant de toute son âme
cette vérité, ait pu employer à ses récits une franchise, une chaleur
d'imagination, et un élan d'émotion qui, depuis des siècles, et aujourd'hui
encore, les revêtent d'un charme où le lecteur le plus sceptique a peine à
résister. Ce livre n'a si profondément touché tant de cœurs que parce qu'il a
jailli, tout entier, du cœur.
Et son unique objet était, précisément, de toucher les cœurs. Car
la Légende Dorée est, à sa façon, un des signes les plus
caractéristiques de son temps, du temps qui a produit saint François, saint
Dominique, saint Louis, et rempli le monde d'églises merveilleuses. C'est un
temps où, dans l'Europe entière, le peuple, s'éveillant enfin d'une longue
somnolence, a commencé tout à coup d'aspirer fiévreusement à la vie de
l'esprit. Tout à coup l'architecture, la sculpture, tous les arts se sont
laïcisés, sont sortis des couvents pour aller au peuple. Et, de même, la pensée
religieuse. En même temps qu'il s'occupait à construire des églises, le peuple
réclamait d'être initié aux secrets de la théologie: il voulait qu'un contact
plus intime s'établît désormais entre Dieu et lui. De là son enthousiasme à
accueillir le Pauvre d'Assise, dont l'âme parfumée n'était qu'une expression
plus haute et plus profonde de toute l'âme populaire. De là l'immense et
soudain succès des deux grands ordres qui, créés pour des fins différentes,
avaient tous deux en commun de s'adresser directement au peuple, de se mêler au
peuple plus étroitement que les ordres antérieurs, et le séculier même. Le
peuple voulait, en quelque sorte, pénétrer jusqu'au chœur de l'église, afin de
mieux célébrer Dieu, étant plus près de lui. Et c'est à cette tendance que
répond la conception de la Légende Dorée, comme par elle s'explique,
aussi, l'extraordinaire fortune de ce livre.
La Légende Dorée est, essentiellement, une tentative de
vulgarisation, de «laïcisation», de la science religieuse. Bien d'autres
théologiens, avant Jacques de Voragine, avaient écrit non seulement des vies de
saints, mais des commentaires de toutes les fêtes de l'année.
Le Bréviaire, par exemple, dès le XIe siècle, avait été compilé, à
peu près sous sa forme d'aujourd'hui, avec des leçons équivalant aux
chapitres de la Légende Dorée. Et, à chaque page, le bienheureux
Jacques de Voragine cite d'autres compilations analogues, le Livre
Mitral, le Rational des offices divins de maître Jean Beleth,
chanoine d'Amiens, etc. Mais tous ces ouvrages s'adressaient aux théologiens, aux
clercs: et la Légende Dorée s'adresse aux laïcs. Elle a pour objet de
faire sortir, des bibliothèques des couvents, les trésors de vérité sainte qu'y
ont accumulés des siècles de recherches et de discussions, et de donner à ces
trésors la forme la plus simple, la plus claire possible, et en même temps la
plus attrayante: afin de les mettre à la portée d'âmes naïves et passionnées
qui aussitôt s'efforcent, par mille moyens, de témoigner la joie extrême
qu'elles éprouvent à les accueillir. Voilà pourquoi Jacques de Voragine ne
dédaigne point d'admettre, dans son livre, jusqu'à des récits dont il avoue
lui-même qu'ils ne méritent pas d'être pris bien à cœur! Voilà pourquoi il ne
néglige jamais une occasion d'expliquer longuement le sens des diverses cérémonies
religieuses, la tonsure des prêtres, les processions, la dédicace des églises!
Et voilà pourquoi, tout en nommant toujours les auteurs dont il «compile» les
savants écrits, il a toujours soin de modifier les passages qu'il leur
emprunte, de manière que l'âme la plus simple puisse les comprendre et en
profiter. Sa Légende est, ainsi, la suite directe de cette traduction
italienne de la Bible que ses biographes signalent comme l'un de ses premiers
ouvrages. Et si, au lieu d'écrire sa Légende en italien, il l'a
écrite dans un honnête latin de sacristie, dont les humanistes de la
Renaissance ont eu beau jeu à railler la médiocrité, c'est que, sans doute,
sous cette forme, il a su que son livre pourrait se répandre plus loin, et
ouvrir à plus d'âmes la maison de Dieu.
Le fait est qu'il n'y a peut-être pas de livre qui ait été plus souvent copié
et traduit. Toutes les bibliothèques du monde en possèdent des manuscrits, dont
quelques-uns comptent parmi les chefs-d'œuvre des deux arts délicieux de la
calligraphie et de l'enluminure. Et lorsque, deux cents ans après, l'imprimerie
vient, hélas! se substituer à ces deux arts et les anéantir, c'est encore
la Légende Dorée qu'on imprime le plus. Les catalogues mentionnent
près de cent éditions latines différentes, publiées entre les années 1470 et
1500: sans compter d'innombrables traductions françaises, anglaises,
hollandaises, polonaises, allemandes, espagnoles, tchèques, etc. Du treizième
siècle jusqu'au seizième, la Légende Dorée reste, par excellence, le
livre du peuple.
Et je dois ajouter qu'il n'y a peut-être pas de livre, non plus, qui ait exercé
sur le peuple une action plus profonde, ni plus bienfaisante. Car le «petit»
livre du bienheureux Jacques de Voragine, — si l'on me permet de lui garder une
épithète que tous les auteurs anciens s'accordent à lui attribuer, — a été,
pendant ces trois siècles, une source inépuisable d'idéal pour la chrétienté.
En rendant la religion plus ingénue, plus populaire, et plus pittoresque, il
l'a presque revêtue d'un pouvoir nouveau: ou du moins il a permis aux âmes d'y
prendre un nouvel intérêt, et, pour ainsi dire, de s'y réchauffer plus
profondément. Tout de suite les nefs des églises se sont peuplées d'autels en
l'honneur des saints et des saintes du calendrier. Tout de suite les tailleurs
de pierres se sont mis à sculpter, aux porches des cathédrales, les touchants
récits de la Légende Dorée, les peintres, les verriers, à les
représenter sur les murs ou sur les fenêtres. Entrez dans une vieille église de
Bruges, de Cologne, de Tours ou de Sienne: toutes les œuvres d'art qui vous y
accueilleront ne sont que des illustrations immédiates; littérales, de
la Légende Dorée. C'est d'après Jacques de Voragine que Memling et
Carpaccio nous racontent le voyage de sainte Ursule avec ses onze mille
compagnes. Quand Piero della Francesca, dans ses fresques d'Arezzo, ou Agnolo
Gaddi dans celles de Florencé, nous font assister aux aventures diverses du
bois de la sainte Croix, ils suivent de phrase en phrase le texte de
la Légende Dorée. D'autres prennent même, dans le vieux livre, des
sujets profanes, et, comme Thierry Bouts au Musée de Bruxelles, nous
détaillent, d'après l'Histoire Lombarde, un acte de justice de
l'empereur Othon. Et il n'y a point jusqu'aux grands tableaux. de Rubens, de Murillo,
de Poussin, qui ne reproduisent les scènes des martyres des saints ou de leurs
miracles exactement comme le bienheureux évêque de Gênes les a «compilées» à
notre intention. Toute la part que, aujourd'hui encore, notre imagination mêle
à ce que nous apprennent, de l'histoire sacrée, les Écritures et la Tradition,
tout cela nous vient, en droite ligne, de la Légende Dorée.
Aussi ne saurait-on trop déplorer le profond discrédit qu'ont cru devoir jeter
sur ce livre d'éminents écrivains religieux de la Renaissance et du XVIIe
siècle, depuis Vivès, l'ami. d'Érasme, jusqu'à l'impitoyable Jean de Launoi, le
«dénicheur de saints», dont un contemporain disait qu'il «avait plus détrôné de
saints du paradis que dix papes n'en avaient canonisé». Ces savants hommes ont
évidemment lu la Légende Dorée, comme toutes choses, avec
l'impression qu'un ministre calviniste lisait par-dessus leur épaule, guettant
une occasion de se moquer d'eux. Et ainsi ils se sont trouvés empêchés de
réfléchir au sens et à la portée du vieux livre; de telle sorte qu'au lieu
d'honorer en Jacques de Voragine, l'un des plus érudits en même temps que le plus
vénérable de leurs devanciers, il n'y a pas d'injure dont ils ne l'aient
accablé: poussés, par leur indignation, jusqu'au calembour, car les uns
l'appelaient un «gouffre d'ordures», jouant sur le sens latin du
mot vorago, tandis que d'autres déclaraient que
sa Légende n'était pas d'or, mais de fer et de plomb.
Ils ne lui pardonnaient pas, notamment, d'avoir mis saint Georges aux prises
avec un dragon avant de le mettre aux prises avec les tenailles du préfet
Dacien, ni d'avoir raconté que saint Antoine avait rencontré au désert un
centaure et un satyre, ni d'avoir conduit à Rome les onze mille compagnes de
sainte Ursule, ni, en maints endroits, d'avoir confondu les noms et brouillé
les dates.
Et certes je ne prétends pas que, à la considérer au point de vue
historique, la Légende Dorée ne contienne pas d'affirmations
inexactes, ou, tout au moins, d'une exactitude à jamais incertaine. Je croirais
volontiers, plutôt, qu'elle en est remplie, comme tous les ouvrages historiques
de son temps, comme ceux de tous les temps; et, sans doute, les écrits mêmes de
Vivès et de Launoi, si un érudit voulait aujourd'hui les contrôler à ce point
de vue, apparaîtraient, eux aussi, amplement pourvus d'erreurs et de légendes.
Mais, d'abord, ainsi que le dit très sagement Bollandus, rien n'est plus
injuste que d'attribuer à Jacques de Voragine la responsabilité d'affirmations
qu'il a, toutes, puisées dans des ouvrages antérieurs, en les contrôlant de son
mieux chaque fois qu'il pu, ou en nous faisant part des doutes qu'elles lui
inspiraient. Pour citer encore une expression de Bollandus, le tort de Vivès et
des autres détracteurs de la Légende Dorée a été «de vouloir
critiquer ce qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ignoraient». Ils ignoraient
qu'un érudit du XIIIe siècle ne disposait point des mêmes moyens d'information
que ceux dont ils disposaient, trois ou quatre siècles plus tard: c'est-à-dire
qu'il manquait de beaucoup de ceux qu'ils avaient, mais que, peut-être aussi,
il en avait d'autres qui désormais leur manquaient. Et quant à soutenir, comme
ils le soutenaient, que la plupart des récits de la Légende
Dorée sont des fables parce que les documents contemporains n'en font pas
mention, c'est en vérité montrer, à l'égard de ces. documents, une crédulité
plus naïve encore que celle des contemporains de Jacques de Voragine à l'égard
du dragon de saint Georges et du centaure de saint Antoine. Qu'un document soit
contemporain des faits qu'il atteste, comme par exemple nos journaux, ou qu'il
leur soit postérieur, comme les histoires et les chroniques les plus
abondantes, on ne risque guère à soutenir que l'erreur y tient plus de place
que la vérité; que de mille choses considérables ils ne font point mention, et
qu'ils en mentionnent mille autres qui n'ont jamais existé.
Mais surtout le tort de Vivès et de ses successeurs a été de «vouloir critiquer
ce qu'ils ne comprenaient pas». Ils ne comprenaient pas, en effet, que des
erreurs comme celles qu'ils signalaient dans la Légende
Dorée n'avaient point, pour un lecteur catholique, la même importance que
pour ce ministre calviniste qui hantait leurs rêves. Car, si les protestants
estiment que Dieu, après avoir parlé aux hommes depuis Adam jusqu'à
Jésus-Christ, s'est tu à jamais dès qu'il nous a légué le Nouveau Testament,
c'est, au contraire, la croyance des catholiques que, suivant sa promesse, il a
«envoyé aux hommes son Esprit», pour continuer à les instruire et à les guider.
Lors donc que la Sainte Église a proclamé saints des hommes dont, le plus
souvent, la vie et les actes lui étaient connus de la façon la plus sûre et la
plus directe, aucun catholique n'a le droit de contester le fait de leur
sainteté. C'est ce que ne comprenait pas Launoi, quand, sous prétexte que ses
recherches ne lui avaient pas démontré l'existence de sainte Catherine, il
remplaçait l'office de cette sainte par une messe de Requiem: le
«dénicheur de saints» prouvait simplement, par là, qu'il était un sot, à
vouloir mettre ses petites recherches personnelles au-dessus de l'autorité de
sa mère l'Église. Et, puisque la sainteté des saints de la Légende
Dorée ne saurait faire de question pour nous, qu'importe ensuite que, à
défaut de l'histoire véritable de leur vie, nous ayons de belles légendes qui
certainement expriment, sinon les faits de cette vie, du moins son âme et son
sens profond? Ainsi l'entendaient les chrétiens des premiers siècles, qui ne
tenaient nullement pour illicite d'embellir à leur fantaisie, dans leurs
chroniques, la vie de la Vierge et des saints, pas plus que les vieux peintres
ne s'interdisaient de représenter leurs traits à leur fantaisie.
Et de même que maintes images de la Vierge, sans prétendre le moins du monde à
être des portraits, ont reçu de Dieu le pouvoir d'opérer des miracles, de même
rien ne nous empêche d'admettre que Dieu, s'il le juge bon, puisse prêter aux
légendes de ses saints une réalité supérieure. Cela encore était une des
croyances favorites des grands âges chrétiens; et la trace s'en retrouve à
chaque page dans la Légende Dorée. Nous y lisons, par exemple,
l'histoire d'un gardien d'église qui, au lieu de donner à un pèlerin un vrai
doigt de saint Augustin, s'était amusé à lui donner le doigt d'un pauvre homme
qui venait de mourir: après quoi, apprenant que ce doigt faisait des miracles,
il était allé voir le corps du saint, et s'était aperçu qu'un doigt y manquait.
Rien n'est impossible à Dieu; et il n'y a point de Vivès, de Launoi, ni de
Baillet, dont l'érudition prévaille contre cet article de foi.
Je ne crois pas, au reste, que personne s'avise plus, aujourd'hui, de reprocher
à la Légende Dorée la faiblesse de sa critique, ni l'incohérence de
sa chronologie. Et je suis sûr que personne ne pourra s'empêcher de sentir
l'exquise douceur poétique de cette Légende, son charme ingénu, mais,
par-dessus tout, la pureté et la beauté incomparables de l'esprit chrétien dont
elle est imprégnée. Quelque opinion que l'on ait de l'exactitude documentaire
de chacun de ses récits, on reconnaîtra que leur ensemble forme un manuel
parfait de la vie suivant l'Évangile, un manuel infiniment varié, et d'autant
mieux adapté aux diverses conditions de l'existence humaine. Car
la Légende Dorée restera toujours ce que son auteur a voulu qu'elle
fût: un livre à l'adresse du peuple, offrant à tout homme la leçon et l'exemple
qui peuvent lui convenir. Mais leçons et exemples, malgré leur diversité, y ont
toujours en commun d'être directement inspirés de la parole du Christ.
Et la religion qu'on y trouve exprimée est toute d'indulgence et de
consolation. C'est la religion telle que la concevait saint François d'Assise,
telle qu'allait la traduire, deux siècles après, le bienheureux Fra Angelico,
dans ces miniatures et ces fresques dont, seul, un chrétien peut apprécier la
surnaturelle vérité chrétienne. Qu'on voie avec quelle ardente sympathie
Jacques de Voragine nous raconte les actes charitables des saints, comme il
s'échauffe lorsqu'il nous parle de saint Basile, de saint Jean l'Aumônier, ou
de saint Martin! Peu s'en faut qu'il ne les préfère aux martyrs eux-mêmes, tant
il découvre en eux des disciples fidèles de son divin maître. Et ses martyrs,
combien ils sont joyeux et doux, combien ils ont de tendre pitié pour leurs
persécuteurs! Le préfet qui torturait saint Longin est, tout à coup, devenu
aveugle et supplie le saint de lui rendre la vue: «Sache, mon pauvre ami, lui
répond le saint, que tu ne pourras être guéri qu'après m'avoir tué! Mais,
aussitôt que je serai mort, je prierai pour toi; et Dieu m'accordera bien la
guérison de ton corps et de ton âme!» Et saint Christophe, de son côté, dit au
roi de Samos: «Quand tu m'auras fait trancher la tête, applique un peu de mon
sang sur tes yeux, et tu recouvreras la vue!» Voilà vraiment de beaux saints;
et il n'y a point de pécheur qui n'ait de quoi reprendre courage, en songeant
que, là-haut, de tels amis s'emploient à plaider pour lui!
Peut-être même est-ce cet esprit d'indulgence et de compassion infinies qui,
plus encore que le dragon de saint Georges, a valu à la Légende
Dorée la mauvaise humeur de certains écrivains religieux du XVIIe siècle.
Sous l'influence du protestantisme et du jansénisme, nombre d'excellents
catholiques, alors, estimaient imprudent de trop prêcher au peuple la bonté de
Dieu. Les peintres, ayant à peindre Jésus sur la croix, le représentaient avec
les bras levés au ciel, et non plus avec les bras étendus pour bénir la terre.
Les philosophes insistaient sur la différence essentielle de la bonté divine et
de l'humaine. Et tous, d'une façon générale, ils s'efforçaient plutôt
d'effrayer les hommes que de les rassurer. Peut-être, dans ces conditions,
la Légende Dorée leur aura-t-elle paru trop consolante, je veux dire
faite pour nous donner une notion trop inexacte de l'éternelle justice? Mais
aujourd'hui, de même que nos imaginations ont soif de légendes, nos coeurs ont
soif de pitié et de consolation. Nous avons besoin que Jésus vienne à nous avec
les bras grands ouverts, que, dans nos peines, il nous dise, comme à l'apôtre
dans sa prison d'Antioche: «Mon ami, as-tu cru vraiment que je t'oubliais?»
Nous avons besoin que, comme au brigand qui récitait tous les jours
son Ave Maria, il daigne nous promettre le pardon de toutes nos
fautes, en échange du peu de foi que nous pouvons lui offrir.
«Si tu dois tenir compte de nos iniquités, Seigneur, qui osera affronter ton
jugement?» C'est à ce cri de nos misérables âmes que répond surtout
la Légende Dorée, par la voix de ses confesseurs et par l'exemple de
ses pécheresses, nous apportant le témoignage de treize siècles de
christianisme, dont elle est, sinon une histoire toujours bien exacte, à coup
sûr le testament le plus authentique. Elle nous apprend que la justice de Dieu
n'est toute faite que de sa bonté. «Ne craignez pas trop, nous dit-elle, que le
Seigneur vous tienne compte de vos iniquités! Lui-même, suivant l'expression de
saint Bernard, est prêt à vous faire bénéficier du surplus de ses mérites; et
puis il y a, auprès de lui, la Vierge et tous les saints, qui ne cessent point
de le solliciter en votre faveur. Mais il ne vous pardonnera qu'à la condition
que vous l'aimiez, dans la personne du pauvre et du malade, de la veuve et de
l'orphelin, de tous ceux que la souffrance élève jusqu'à lui; à la condition
que vous restiez humbles d'esprit et de coeur, vous gardant avec soin des
fruits amers de l'arbre de la science, dont le diable vous affirme qu'ils
pourront vous rendre pareils à des dieux; et à la condition, enfin, que vous
honoriez le Seigneur dans la nature, son œuvre, au lieu de mépriser et de
détruire celle-ci comme vous vous acharnez à le faire. Habituez-vous plutôt à
écouter les leçons des forêts que celles des livres! Obtenez des moineaux
qu'ils consentent à venir manger dans vos mains! Et, quand vous verrez un ours ou
un loup pris au piège, hâtez-vous de courir à lui pour le délivrer! Renoncez à
vous-mêmes pour vivre tout entiers dans le reste du monde: moyennant quoi le
Seigneur non seulement vous préparera une petite place dans son paradis, mais,
dès cette vie, imprimera sur vos lèvres le tranquille "et heureux sourire
que vous voyez rayonner sur les lèvres des saints!» Telle est la leçon que nous
enseigne, à toutes ses pages, la Légende Dorée, avec son mauvais
style et ses erreurs de dates; et peut-être, cette leçon, les contemporains même
de Jacques de Voragine n'avaient-ils pas autant que nous besoin de l'entendre!
Quant à la traduction de la Légende Dorée que je soumets aujourd'hui
au lecteur français, je dirai seulement que je l'ai faite sur une édition
latine imprimée, en 1517, à Lyon, chez Constantin Fradin; mais, sans cesse,
autant que j'ai pu, je me suis reporté à des éditions plus anciennes et à des
copies manuscrites.
J'ai retranché, naturellement, la plupart des chapitres des éditions
postérieures qui, ne se trouvant point dans les manuscrits, sont à coup
sûr des interpolations. J'ai cru, cependant, devoir en conserver deux, qui, du
reste, ont été introduits de très bonne heure dans le texte de la Légende
Dorée ceux de Saint François et de Sainte Élisabeth. J'ai
écourté, çà et là, quelques développements scolastiques où l'auteur expliquait,
par exemple, les dix motifs, divisés chacun en une dizaine d'autres, qui
avaient décidé le Seigneur à se laisser circoncire ou à naître d'une vierge. Et
je me suis également, décidé à retrancher, après les avoir d'abord traduites,
les étymologies placées par l'auteur en tête de ses chapitres. Bollandus et
d'autres écrivains autorisés ont soutenu que ces étymologies n'étaient point de
Jacques de Voragine; mais je crains bien, hélas! qu'elles ne soient de lui, et
ce n'est point ce scrupule-là qui m'a empêché de les publier. Je les ai
retranchées, simplement, parce qu'elles auraient prêté à rire, sans profit pour
personne. Le saint évêque de Gênes, de même que tous les savants de son temps,
ignorait le grec. Et nous aussi, en vérité, nous l'ignorons, mais nous en
savons assez pour être surs que le nom d'Agathe, par exemple, ne vient
point «d'Aga, parlant, et de thau, perfection». Quand
Jacques de Voragine nous affirme que le nom d'Antoine
vient «d'ana, en haut, et de tenens, tenant», nous
éprouvons malgré nous une tentation de sourire qui risque de nous faire mal
apprécier, ensuite, la touchante beauté de la vie du saint. L'art d'un temps,
pour peu que l'artiste y ait mis de son coeur, a de quoi nous plaire
éternellement: mais la science d'un temps ne vaut que pour son temps.
Et, à part ces suppressions et ces abréviations, dont le total ne dépasse pas
une trentaine de pages, j'ai essayé de traduire aussi fidèlement que possible
le texte original de la Légende Dorée. Puisse l'œuvre du vénérable
Jacques de Varage retrouver parmi nous, sous cette forme nouvelle; un peu de sa
bienfaisante action d'autrefois
Notes
TEODOR DE WYZEWA, préface
à sa traduction de La légende dorée, Paris, Perrin et cie, 1910. Voir
ce texte
Oeuvres
Oeuvres en ligne
La
légende dorée, trad. par Teodor de Wyzewa, Paris, Perrin, 1910 (Sur
Gallica-BNF).
Legenda
aurea (extraits de la version latine). (Corpus scriptorum Latinorum)
The
Golden Legend (version anglaise). (Medieval Sourcebook)
Édition récente
SOURCE : http://agora.qc.ca/Dossiers/Jacques_de_Voragine
Ossa e ceneri del Beato Giacomo da Varazze, Chiesa di San Domenico, Varazze, provincia di Savona
Luca Baudo (1460–1509), Beato Jacopo da Varagine / Jacobus de Voragine, Catherine of Siena, Agatha of Sicily, Alberto da Bergamo, Jesus, Mary, Joseph,
circa 1490, oil on panel, 218 x 153,Chiesa
San
Domenico, Varazze
13 juillet. Bienheureux
Jacques de Voragine, dominicain, archevêque de Gènes. 1298.
Pape : Boniface
VIII.
Capitaine du peuple de
Gènes : Olberto Doria.
Roi de France
: Philippe IV, le Bel.
" La science
parfaite consiste à faire tout avec soin et à se bien pénétrer qu'on n'est rien
par ses propres mérites."
Saint Bonaventure, sup.
Job.
Jacques de Voragine est
né entre 1228 et 1229 à Varazze ou, plus probablement, à Gênes, où est attestée
la présence d’une famille originaire de Varazze, appelée de " Varagine
". La formule de " Voragine " par laquelle il est parfois
désigné dans les sources anciennes est une variante de " da Varagine
". L’idée remontant au XVIe siècle et devenue ensuite traditionnelle selon
laquelle " Voragine " vient de " vorago ", pour indiquer
l’abîme de connaissance dont Jacques a fait preuve dans ses oeuvres est donc
extravagante, même si elle exprime une certaine vérité.
C’est le bienheureux Jacques lui-même qui fournit, dans une rapide
autobiographie contenue dans l’une de ses oeuvres, la Chronica civitatis
Ianuenses, les premières dates marquantes de sa vie : 1239 lorsque dans son
enfance il assiste à une éclipse solaire, 1244 lorsque, adolescent, il entre
dans l’Ordre des frères prêcheurs, et 1264, lorsqu’il a eu l’occasion d’admirer
pendant quarante jours un autre fait prodigieux, c’est-à-dire l’apparition
d’une comète.
Jacques avait pris une responsabilité importante à l’intérieur de l’Ordre avant
1267, date à laquelle il fut élevé, au Chapitre Général de Bologne, à l’office
de prieur de l’importante province de Lombardie, qui comprenait à l’époque
toute l’Italie septentrionale, l’Emilie et le Picenum. Il a occupé cette charge
pendant dix années, participant aux chapitres provinciaux et généraux de
l’Ordre et résidant probablement au couvent de Milan ou dans celui de Bologne,
jusqu’à ce qu’il soit absolutus de cette charge au chapitre général de Bordeaux
en 1277.
Après quelques années, au chapitre provincial de Bologne de 1281, il fut à
nouveau nommé prieur de la province lombarde, charge qu’il a occupée pour cinq
années encore, jusqu’en 1286. De 1283 à 1285, il exerça les fonctions de régent
de l’Ordre après la mort de Jean de Verceil et avant l’élection du nouveau
maître général, Munio de Zamora.
Entre temps, il continua
à maintenir de forts liens avec la cité de Gênes. Le jour de Pâques 1283, comme
il le raconte lui-même dans son opuscule Historia reliquiarum que sunt in
monasterio sororum Sanctorum Philippi et Iacobi, il fit transporter une
précieuse relique, la tête d’une des vierges de Sainte-Ursule, de Cologne au
couvent des soeurs dominicaines de Gênes des saints Jacques et Philippe ; il
s’agit du même couvent auquel quelques années plus tôt, durant son précédent
priorat, il avait donné une autre relique, le doigt de saint Philippe, qu’il
avait lui-même détaché de la main du saint conservée dans le couvent de Venise.
A cette occasion Jacques, après la procession solennelle, a donné une messe et
un prêche au peuple. En 1288, alors qu’il n’était plus depuis deux ans prieur
de la Lombardie, il fut candidat à la charge d’archevêque de Gênes, mais
n’obtint pas, comme les trois autres candidats, la majorité des voix ; le pape
Nicolas IV suspendit la nomination, confiant cependant à Jacques, le 18 mai de
la même année, la tâche d’absoudre en une cérémonie publique, qui se tint dans
l’église de Saint-Dominique, les Génois excommuniés pour avoir eu des rapports
commerciaux avec les Siciliens, eux-mêmes excommuniés à cause de la guerre des
Vêpres. La même année, il fut nommé diffinitor au chapitre général de Lucques.
En 1290, à l’occasion du chapitre général de Ferrare, Jacques résista aux
pressions des cardinaux romains qui, dans une lettre, demandaient la démission
du maître général Munio de Zamora, mal vu pour son rigorisme à l’intérieur de
l’Ordre et de la Curie romaine. La lettre n’obtint aucun effet : non seulement
le maître général ne démissionna pas, mais il fut soutenu par une déclaration
publique, signée aussi de Jacques, qui exaltait sa vertu et approuvait sa
politique.
Selon la relation de Gerolamo Borsello (XVe) et, après lui, d’autres biographes
anciens, ce serait justement à cause de ce soutien donné à la ligne rigoureuse
de Munio de Zamora que Jacques aurait subi cette année une tentative d’homicide
de la part de confrères qui voulaient le jeter dans le puits du couvent de
Ferrare. Une tentative qui, raconte encore Borsello, se serait répétée l’année
suivante, en 1291, à Milan, cette fois parce que Jacques avait exclu du chapitre
provincial frère Stefanardo, prieur du couvent milanais.
Rappelons à ce sujet que notre bienheureux combattit dans la grande querelle
qui opposa les Guelfes et les Gibelins.
En 1292, il fut nommé par
le pape Nicolas IV archevêque de Gênes. Jacques consacra les six dernières
années de sa vie à gouverner le diocèse génois, de 1292 à 1298, année de sa
mort. Son action s’est tournée d’abord vers la réorganisation législative du
clergé sous l’autorité archiépiscopale. Dans ce but, il convoca un concile provincial,
qui se tint dans la cathédrale Saint-Laurent en juin 1293, durant lequel, comme
le raconte Jacques lui-même dans la chronique de Gênes, fut accomplie, en
présence des gouvernants et des notables puis de tout le peuple, une
reconnaissance des os de san Siro, patron de la cité, qui confirmait
solennellement l’authenticité de la relique.
L’activité de Jacques est intense sur le plan politique, il en offre lui-même
un ample compte-rendu dans la Chronique de Gênes . En 1295, dans les premiers
mois de l’année, il promut la pacification entre les factions de la cité et
célébra la paix finalement obtenue dans une assemblée publique lors de laquelle
il prêcha et entonna, avec ses ministres, les louanges à Dieu ; suivit ensuite
une procession solennelle à travers les rues de la cité, guidée par ce même
Jacques à cheval qui se conclut avec la remise de l’insigne de miles au
podestat de Gênes, le milanais Jacques de Carcano.
La même année, en avril, avec les ambassadeurs envoyés par la Commune, il
accomplit un voyage à Rome, convoqué par le pape Boniface VIII qui cherchait à
prolonger l’armistice entre Gênes et Venise. Le séjour à la Curie romaine se
prolongea une centaine de jours, et Jacques ne manqua pas de montrer une
certaine fatigue face à l’indécision du pape et surtout face aux manoeuvres
dilatoires des ambassadeurs vénitiens.
A ce point les Génois, après la longue attente, décidèrent d’aller à
l’affrontement contre Venise, réunissant, dans l’enthousiasme populaire, une
flotte qui aurait dû affronter les ennemis dans une bataille décisive près de
Messine, à laquelle cependant les Vénitiens ne se présentèrent pas,
contraignant le commandant Oberto Doria à retourner à Gênes sans avoir
combattu, accueilli cependant en triomphe par la cité et par son évêque.
A la fin de 1295, Jacques subit un revers politique et une profonde déception
personnelle : en effet, la paix entre les factions citadines se rompit, cette
paix qu’il avait voulue et solennellement célébrée quelques mois plus tôt ; des
incidents violents éclatèrent, durant lesquels la cathédrale Saint-Laurent fut
incendiée, et son toit fut totalement brûlé. Les dommages furent si importants
que Jacques demanda au pape une aide, qui lui fut accordée le 12 juin 1296.
Jacques mourut dans la nuit du 13 au 14 juillet 1298. Il demanda à ce que les
frais nécessaire soient intégralement distribués aux pauvres. Son corps,
d’abord enseveli dans l’église Saint-Dominique du couvent des frères prêcheurs
de Gênes, fut, à la fin du XVIIIe siècle, transféré dans une autre église
dominicaine, Santa Maria di Castello, où il se trouve encore. En vertu de la
vénération et du culte dont il fut l’objet pendant des siècles, Jacques a été
béatifié en 1816 par le pape Pie VII.
Son oeuvre est ample et remarquable tant par sa quantité que par sa qualité et
sa science hors du commun. Quelques liens nous permettent de consulter entre
autres la très fameuse Legenda aurea (tant de fois illustrée par les plus
grands artistes) ou ses sermons.
Rq : On lira entre autres :
- http://www.abbaye-saint-benoit.ch/voragine/index.htm
- http://www.jesusmarie.com/jacques_de_voragine.html
- http://www.sermones.net et http://thesaurus.sermones.net/voragine/index.xsp;jsession...
Scultore Genovese, Statua funeraria, sepolcro di Beato Giacomo da Varazze nato nel 1228 c. e morto a Genova nel 1292, Arcivescovo di Genova, (1289-1300), originariamente nel coro alla sinistra dell’altar maggiore della chiesa di San Domenico, Museo di Sant'Agostino (Genova. La statua fu realizzata da un anonimo scultore genovese del XIII secolo in marmo bianco apuano)
Scultore
Genovese, Statua funeraria, sepolcro di Beato Giacomo da Varazze nato nel 1228 c.
e morto a Genova nel 1292, Arcivescovo di Genova, (1289-1300), originariamente
nel coro alla sinistra dell’altar maggiore della chiesa di San Domenico, Museo
di Sant'Agostino (Genova. La statua fu realizzata da un anonimo scultore
genovese del XIII secolo in marmo bianco apuano)
Scultore Genovese, Statua funeraria, sepolcro di Beato Giacomo da Varazze nato nel 1228 c. e morto a Genova nel 1292, Arcivescovo di Genova, (1289-1300), originariamente nel coro alla sinistra dell’altar maggiore della chiesa di San Domenico, Museo di Sant'Agostino (Genova. La statua fu realizzata da un anonimo scultore genovese del XIII secolo in marmo bianco apuano)
Édition électronique d'un
corpus de sermons latins médiévaux
Menu principal
Présentation
Dans le cadre du
renouvellement récent des travaux sur la prédication médiévale, Sermones.net propose l’édition électronique de
corpus de sermons, dont le premier est la série de sermons de Carême de Jacques
de Voragine. La réalisation de ce corpus annoté est conduite par une équipe
internationale de chercheurs sous la direction de Nicole
Bériou(link is external).
On mesure mieux
aujourd’hui, grâce à un ensemble de travaux récents, l’importance historique du
système de communication de masse mis au point par les frères de saint
Dominique et de saint François à la faveur de leur engagement de prédicateurs
au XIIIe siècle. Un équipement intellectuel de premier ordre, adapté à leurs
besoins, fut alors produit dans les couvents, et diffusé par des techniques de
reproduction rapide, deux siècles avant l’invention de l’imprimerie.
L’enseignement par la parole auquel les prédicateurs s’adonnaient ne
s’improvisait pas, il supposait un apprentissage, et le recours à des
instruments de travail efficaces.
Les recueils de sermons
modèles attestent la réalité et l'importance de la diffusion de ces
innovations. Ils ont été utilisés par d'innombrables prédicateurs médiévaux
comme des modèles de l’art de communiquer qu’ils se devaient de maîtriser, et
comme des mines d’idées sur tous les sujets qu’ils pouvaient aborder dans leurs
sermons. Ils trouvaient là, en latin, matière à préparer les sermons qu'ils
allaient délivrer au peuple en langue vernaculaire.
Pour les chercheurs d’aujourd’hui, cette documentation est une véritable mine
d’informations sur les données sociales, religieuses, et culturelles propres à
une époque révolue sans doute, mais cependant capitale, car fondatrice de la
civilisation européenne des temps modernes.
Pour faciliter l'étude de
ces sources médiévales, Sermones.net offre une édition électronique
annotée de corpus de sermons, dont le premier exemple est la série de 98
sermons de Carême du dominicain Jacques de Voragine. Cette édition électronique,
qui se veut complémentaire des éditions critiques classiques sur papier, offre
non seulement la possibilité de faire des recherches de vocabulaire, mais les
annotations ajoutées permettent au lecteur de mieux appréhender les éléments
rhétoriques et narratifs qui structurent le sermon et lui donnent chair. Le
plan du sermon, les distinctiones, les figurae, les exempla sont
autant d'éléments qui ont été attentivement repérés dans les textes, et que les
possibilités des nouvelles technologies font ressortir à différents niveaux
(index, mise en valeur dans le corps même des sermons, recherches ciblées,
...).
Avant de commencer
à utiliser le
corpus, nous vous invitons à consulter l'introduction historique (repères
biographiques de Jacques de Voragine, ses oeuvres, bibliographie...), et à
prendre connaissance du tutoriel qui vous guidera dans l'utilisation de
l'édition électronique. Les non latinistes désireux de se familiariser avec les
sermons-modèles latins pourront accéder à la version traduite de deux sermons
SOURCE : http://www.sermones.net/
Jacques de Voragine
Le Thesaurus des
sermons de Jacques de Voragine est la première série de sermons proposée
sur Sermones.net.
Célèbre depuis sept siècles pour avoir rédigé la Legenda aurea (“
Légende dorée ”), Jacques de Voragine (v. 1228-1229 / 1298) appartient à la
même génération que Thomas d’Aquin.
Il a composé quatre grandes collections de sermons totalisant plus de sept cents
textes, dont les premières éditées ici sont les collections de Carême (98
sermons) et du Mariale (161 textes).
Consulter l'édition
électronique des sermons
Articles de cette
rubrique
Le
projet d’édition des Sermones de sanctis et des Sermones de
tempore de Jacques de Voragine
Ou De nuptiis
philologiae hodiernis temporibus
La
vie et les oeuvres de Jacques de Voragine, o.p.
Les
sermons de Jacques de Voragine et leur audience
La
préparation de l’édition électronique
BibliographieSOURCE :
http://www.sermones.net/content/jacques-de-voragine
Les sermons de Jacques de
Voragine et leur audience
Jacques de Voragine a
compilé trois grands recueils de sermons et un recueil de matériaux de
prédication, destinés à aider les prédicateurs à préparer leurs sermons. Si
l’on suit son témoignage dans la Chronique de Gênes, l’ordre de composition
serait le suivant :
1) après la première
rédaction de la Legenda aurea (1267), le recueil sur les saints (Sermones
de omnibus sanctis et festis).
2) à la suite, le recueil
de sermons du Temps, associant les dimanches et les grandes fêtes du Christ
(titres divers dans les recueils : Sermones de omnibus evangeliis
dominicalibus, Sermones de tempore per annum, Sermones dominicales, Sermones
festivales)
3) le recueil de sermons
pour le Carême (Quadragesimale), avant 1286
4) le recueil de
matériaux pour prêcher sur la Vierge Marie (Liber marialis, Sermones aurei
de Maria Virgine), pendant son archiépiscopat, entre 1292 et 1298.
Description sommaire
Le De sanctis contient
les 305 pièces répertoriées dans Schneyer, RLS 3, p. 246-266, auxquelles il
faut en ajouter 10 à l’examen de la tradition manuscrite.
Jacques de Voragine déclare l’avoir rédigé sous deux formes, l’une longue,
l’autre plus brève et condensée.
Plus de 300 manuscrits.
Editio princeps : Cologne, 1478.
Le De tempore contient
160 pièces (Schneyer, RLS 3, p. 221-233).
Plus de 350 manuscrits.
Editio princeps : Cologne, 1467-1469
Le Quadragesimale contient
98 pièces (Schneyer, RLS 3, p. 238-244, y ajoute d’après les éditions, à la fin
de la série, deux pièces qui ne figurent pas dans les manuscrits : Sermo
de Passione Domini, et Sermo in Planctu Beatae Virginis Mariae).
Plus de 300 manuscrits.
Editio princeps : Brescia, 1483
Le Liber marialis contient
160 pièces (Schneyer, RLS 3, p.273-283) classées d’après l’ordre alphabétique
de mots vedettes thématiques, de Abstinentia à Vulnerata
70 manuscrits environ
Editio princeps : Hambourg, 1491
Traduit en flamand au XVe siècle
L’audience des
sermons : exemples d’utilisation
Ces quatre recueils,
bénéficiant du support exceptionnel de diffusion que constituait le réseau des
couvents, ont été très tôt connus et utilisés, non seulement par les frères
dominicains, mais aussi par beaucoup d’autres prédicateurs, comme des modèles
de l’art de communiquer qu’ils se devaient de maîtriser, et comme des mines
d’idées, de citations d’autorités, d’images, de comparaisons, de récits, sur
tous les sujets qu’ils pouvaient aborder dans leurs sermons. On connaît plus de
mille manuscrits des sermons de Jacques de Voragine encore conservés aujourd’hui
dans tous les pays d’Europe, et le succès de cette œuvre monumentale a été
ensuite confirmé par des dizaines d’éditions, dès les débuts de l’imprimerie,
et jusqu’au XIXe siècle.
Les travaux suivants
offrent quelques exemples de la réutilisation par les prédicateurs de la
matière puisée dans les sermons de Jacques de Voragine :
L’article de Stanislava
Kuzmova, Reception
of Voragine’s sermons in Central Europe – a few examples (en anglais)
étudie en particulier l’exemple d’un sermon pour la fête de saint Stanislas
composé par un auteur anonyme qui a utilisé des éléments tirés de deux sermons
différents de Jacques de Voragine, l’un pris dans sa collection De
tempore , l’autre dans sa collection de Carême.
L’article du Dr. Ottó
Gecser, The
Pécs Sermones Dominicales and the Sermones de tempore of James of Varazze (en
anglais), illustre la façon dont la matière des Sermones de tempore de
Jacques de Voragine a été réutilisée dans une collection de sermons hongroise
du XVe siècle.
L’article d’Olivier Marin
(Université Paris XIII), Manuscrits
de l’oeuvre de Jacques de Voragine à la bibliothèque universitaire d’Olomouc
(République Tchèque) rappelle le succès des sermons du dominicain en
Europe centrale, à travers l’analyse du catalogue de la bibliothèque.
SOURCE : http://www.sermones.net/content/les-sermons-de-jacques-de-voragine-et-leur-audience
La vie et les oeuvres de
Jacques de Voragine, o.p.
Carla CASAGRANDE
Sa vie
Jacques de Voragine est
né entre 1228 et 1229 à Varazze ou, plus probablement, à Gênes, où est attestée
la présence d’une famille originaire de Varazze, appelée « de
Varagine ». La formule « de Voragine » par laquelle il est
parfois désigné dans les sources anciennes est une variante de « da
Varagine ». L’idée remontant au XVIe siècle et devenue ensuite
traditionnelle selon laquelle « Voragine » vient de
« vorago », pour indiquer l’abîme de connaissance dont Jacques a fait
preuve dans ses oeuvre est donc extravagante, même si elle exprime une certaine
vérité.
C’est Jacques lui-même
qui fournit, dans une rapide autobiographie contenue dans l’une de ses oeuvres,
la Chronica civitatis Ianuenses , les premières dates certaines de sa
vie : 1239 lorsque dans son enfance il assiste à une éclipse solaire, 1244
lorsque, adolescent, il entre dans l’Ordre des frères prêcheurs, et 1264,
lorsqu’il a eu l’occasion d’admirer pendant quarante jours un autre fait
prodigieux, c’est-à-dire l’apparition d’une comète. On ne dispose à l’inverse
d’aucune information certaine sur sa formation de frère prêcheur ni sur sa
prédication ; comme on ne sait rien non plus de sa carrière à l’intérieur
de l’Ordre : il n’existe en fait aucune preuve d’éventuels séjours d’étude
à Bologne et à Paris, ni de ses nominations comme lector ,
comme magister theologiae , comme prieur du couvent de Gênes et
ensuite de celui d’Asti, comme le soutiennent quelques biographes anciens.
Toutefois, on peut supposer que Jacques avait pris une responsabilité
importante à l’intérieur de l’Ordre avant 1267, date à laquelle il fut élevé,
au Chapitre Général de Bologne, à l’office de prieur de l’importante province
de Lombardie, qui comprenait à l’époque toute l’Italie septentrionale, l’Emilie
et le Picenum. Il a occupé cette charge pendant dix années, participant aux
chapitres provinciaux et généraux de l’Ordre et résidant probablement au
couvent de Milan ou dans celui de Bologne, jusqu’à ce qu’il soit absolutus de
cette charge au chapitre général de Bordeaux en 1277. Après quelques années, au
chapitre provincial de Bologne de 1281, il fut à nouveau nommé prieur de la
province lombarde, charge qu’il a occupée pour cinq années encore, jusqu’en
1286. De 1283 à 1285, il exerça les fonctions de régent de l’Ordre après la
mort de Jean de Verceil et avant l’élection du nouveau maître général, Munio de
Zamora.
Entre temps, il continua
à maintenir de forts liens avec la cité de Gênes. Le jour de Pâques 1283, comme
il le raconte lui-même dans son opuscule Historia reliquiarum que sunt in
monasterio sororum Sanctorum Philippi et Iacobi , il fit transporter une
précieuse relique, la tête d’une des vierges de Sainte-Ursule, de Cologne au
couvent des soeurs dominicaines de Gênes des saints Jacques et Philippe ;
il s’agit du même couvent auquel quelques années plus tôt, durant son précédent
priorat, il avait donné une autre relique, le doigt de saint Philippe, qu’il
avait lui-même détaché de la main du saint conservée dans le couvent de Venise.
A cette occasion Jacques, après la procession solennelle, a donné une messe et
un prêche au peuple. En 1288, alors qu’il n’était plus depuis deux ans prieur
de la Lombardie, il fut candidat à la charge d’archevêque de Gênes, mais
n’obtint pas, comme les trois autres candidats, la majorité des voix ; le
pape Nicolas IV suspendit la nomination, confiant cependant à Jacques, le 18
mai de la même année, la tâche d’absoudre en une cérémonie publique, qui se
tint dans l’église de Saint-Dominique, les Génois excommuniés pour avoir eu des
rapports commerciaux avec les Siciliens, eux-mêmes excommuniés à cause de la
guerre des Vêpres. La même année, il fut nommé diffinitor au chapitre
général de Lucques.
En 1290, à l’occasion du
chapitre général de Ferrare, Jacques résista aux pressions des cardinaux
romains qui, dans une lettre,demandaient la démission du maître général Munio
de Zamora, mal vu pour son rigorisme à l’intérieur de l’Ordre et de la Curie romaine.
La lettre n’obtint aucun effet : non seulement le maître général ne
démissionna pas, mais il fut soutenu par une déclaration publique, signée aussi
de Jacques, qui exaltait sa vertu et approuvait sa politique. Selon la
reconstruction de Gerolamo Borsello (XVe s.) et, après lui, d’autres biographes
anciens, ce serait justement à cause de ce soutien donné à la ligne rigoriste
de Munio de Zamora que Jacques aurait subi cette année une tentative d’homicide
de la part de confrères qui voulaient le jeter dans le puits du couvent de
Ferrare. Une tentative qui, raconte encore Borselli, se serait répétée l’année
suivante, en 1291, à Milan, cette fois parce que Jacques avait exclu du
chapitre provincial frère Stefanardo, prieur du couvent milanais. Rien ne confirme
la véracité de ces deux épisodes.
En 1292, il fut nommé par
le pape Nicolas IV archevêque de Gênes. Jacques consacra les six dernières
années de sa vie à gouverner le diocèse génois, de 1292 à 1298, année de sa
mort. Son action s’est tournée d’abord vers la réorganisation législative du
clergé sous l’autorité archiépiscopale. Dans ce but, il convoca un concile
provincial, qui se tint dans la cathédrale Saint-Laurent en juin 1293, durant
lequel, comme le raconte Jacques lui-même dans la chronique de Gênes, fut
accomplie, en présence des gouvernants et des notables puis de tout le peuple,
une reconnaissance des os de san Siro, patron de la cité, qui confirmait
solennellement l’authenticité de la relique.
L’activité de Jacques est
intense sur le plan politique, il en offre lui-même un ample compte-rendu dans
la Chronique de Gênes . En 1295, dans les premiers mois de l’année,
il promut la pacification entre les factions de la cité et célébra la paix
finalement obtenue dans une assemblée publique lors de laquelle il prêcha et
entonna, avec ses ministres, les louanges à Dieu ; suivit ensuite une
procession solennelle à travers les rues de la cité, guidée par ce même Jacques
à cheval qui se conclut avec la remise de l’insigne de miles au podestat de
Gênes, le milanais Jacques de Carcano. La même année, en avril, avec les
ambassadeurs envoyés par la Commune, il accomplit un voyage à Rome, convoqué
par le pape Boniface VIII qui cherchait à prolonger l’armistice entre Gênes et
Venise. Le séjour à la Curie romaine se prolongea une centaine de jours, et
Jacques ne manqua pas de montrer une certaine fatigue face à l’indécision du
pape et surtout face aux manoeuvres dilatoires des ambassadeurs vénitiens. A ce
point les Génois, après la longue attente, décidèrent d’aller à l’affrontement
contre Venise, réunissant, dans l’enthousiasme populaire, une flotte qui aurait
dû affronter les ennemis dans une bataille décisive près de Messine, à laquelle
cependant les Vénitiens ne se présentèrent pas, contraignant le commandant Oberto
Doria à retourner à Gênes sans avoir combattu, accueilli cependant en triomphe
par la cité et par son évêque. A la fin de 1295, Jacques subit un revers
politique et une profonde déception personnelle : en effet, la paix entre
les factions citadines se rompit, cette paix qu’il avait voulue et
solennellement célébrée quelques mois plus tôt ; des incidents violents
éclatèrent, durant lesquels la cathédrale Saint-Laurent fut incendiée, et son
toit fut totalement brûlé. Les dommages furent si importants que Jacques
demanda au pape une aide, qui lui fut accordée le 12 juin 1296.
Jacques mourut dans la
nuit du 13 au 14 juillet 1298. Son corps, d’abord enseveli dans l’église
Saint-Dominique du couvent des frères prêcheurs de Gênes, fut, à la fin du
XVIIIe siècle, transféré dans une autre église dominicaine, Santa Maria di
Castello, où il se trouve encore. En vertu de la vénération et du culte dont il
fut l’objet pendant des siècles, Jacques a été béatifié en 1816 par le pape Pie
VII.
Les oeuvres
Important pour son rôle à
l’intérieur de l’Ordre des frères prêcheurs et par son action comme archevêque
de Gênes, Jacques de Voragine est connu avant tout pour ses oeuvres que nous
listons dans l’ordre selon lequel Jacques lui-même les cite dans le dernier
chapitre de la Chronica civitatis Ianuensis : les Legende
Sanctorum ( Legenda Aurea ), trois recueils de modèles de
sermons, les Sermones de omnibus sanctis , les Sermones de
omnibus Evangeliis dominicalibus , les Sermones de omnibus Evangeliis
que in singulis feriis in Quadragesima leguntur , le Liber
Marialis et la Chronica civitatis Ianuensis . Sont exclus de de
cette liste « autobiographique » certains opuscules de caractère
hagographique retenus comme authentiques par la critique : la Legenda
seu vita sancti Syri episcopi Ianuensis , l’ Historia translationis
reliquiarum Sancti Iohannis Baptistae Ianuam , l’ Historia
reliquiarum que sunt in monasterio sororum SS. Philippi et Iacobi de
Ianua , le Tractatus miraculorum reliquiarum Sancti Florentii.
Historia translationis reliquiarum eiusdem , la Passio Sancti
Cassiani . Incertaine est, à l’inverse, l’attribution à Jacques du Tractatus
de libris a Beato Augustino editis qui lui est attribué dans quelques
manuscrits des XIV-XVe siècles (Jacobi di Voragine Tractatus de libris b.
Augustini ep. editis , ed. by J. A. McCormick from Manuscripts and Unique
Printing, Dissertation Abstract 25, 1964-65).
Legenda aurea
Il s’agit de la première
et de la plus fameuse oeuvre de Jacques de Voragine. Le titre de Legenda
aurea , sous lequel elle a été traditionnellement transmise, n’apparaît
pas dans les manuscrits les plus anciens qui mentionnent à la place le titre
de Legende sanctorum , celui-là même avec lequel Jacques désigne l’oeuvre
dans le passage de la Chronica rappelé plus haut. Les autres titres
sous lesquels l’oeuvre est désignée, Liber passionalis , Vitae ou Flores ou Speculum
sanctorum , Historia Lombardica ou Longobardica (d’après
l’avant-dernier chapitre, dédié au pape Pélage, où sont racontés les principaux
événements survenus de l’arrivée des Lombards en Italie à 1245) n’appartiennent
pas non plus à la tradition la plus ancienne du texte. L’oeuvre se compose de
récits dédiés aux vies des saints et aux fêtes liturgiques (178 selon l’édition
Maggioni, 182 selon l’édition Graesse), disposés, et cela constitue une
innovation au regard des oeuvres du même genre, selon l’ordre du calendrier
liturgique. Les saints, dont on raconte la vie, appartenaient tous aux premiers
siècles du christianisme, à l’exception de six saints
« modernes » : deux du XIIe siècle, Bernard de Clairvaux et
Thomas Beckett, quatre du XIIIe, Dominique, François, Pierre Martyr, Elisabeth
de Hongrie. L’oeuvre appartient au genre des legendae novae , compilations
préparées entre le XIIIe et le XIVe siècle le plus souvent par des
représentants de l’Ordre des frères prêcheurs, dans lesquelles, avec la double
intention de mettre à disposition des prédicateurs un matériau qui serait sans
cela trop abondant et diffus et d’offrir à la lecture des textes qui soient en
même temps plaisants et édifiants, étaient recueillis et condensés les récits
hagiographiques qui s’étaient accumulés en grand nombre depuis les premiers
siècles de l’ère chrétienne.
La Legenda
aurea a été écrite par Jacques à partir de 1260 et ensuite retravaillée
par lui, alors qu’en circulaient déjà les premières versions, par étapes
successives jusqu’à peu avant sa mort, comme l’a démontré Giovanni Paolo
Maggioni dans son édition de l’oeuvre. Dans la première rédaction prévaut la
volonté de Jacques de préparer un instrument utile à la prédication ;
ensuite, l’insertion de quelques récits montre de la pat de Jacques la volonté
de tenir compte des exigences d’un public de lecteurs certes dévôts mais aussi
cultivé et intéressé. Les sources de la Legenda aurea sont
multiples : l’Ecriture sainte, les textes des Pères et des plus influents
représentants de la tradition monastique, les sources hagiographiques (en
particulier les précédentes legendae novae compilées à l’intérieur de
l’ordre dominicain, l’ Abbreviatio in gestis sanctorum de Jean de
Mailly et le Liber epilogorum in gesta sanctorum de Barthélemy de
Trente), des sources historiques, parmi lesquelles l’ Historia
scholastica de Pierre le Mangeur, le Speculum historiale de
Vincent de Beauvais, la Chronica de Martin le Polonais, les textes
pour les prédicateurs composés par des confrères de l’ordre, comme le Tractatus
de diversis materiis praedicabilibus d’Etienne de Bourbon, et aussi des
textes théologiques, philosophiques, juridiques, et quelques rares auteurs
profanes.
La Legenda eut
un succès rapide, durable et étendu à toute l’Europe comme aucun autre texte à
l’époque médiévale, à part la Bible. En témoigne le grand nombre de manuscrits
restants, plus de 1200, les nombreuses éditions qui se sont succédées à partir
de l’ editio princeps de Cologne en 1470, les nombreuses
vulgarisations dans toutes les principales langues européennes qui se succèdent
à partir de la fin du XIIIe siècle (voir Lexicon des Mittelalters ,
V, 1991, coll. 1796-1801). L’influence qu’exerça l’oeuvre dans le milieu
artistique fut également notable, en constituant un répertoire inépuisable pour
la représentation des vies des saints. A cause de cette extraordinaire
diffusion, la Legenda fut une oeuvre en continuelle transformation,
du fait de ses divers utilisateurs qui intervinrent sur le texte en l’adaptant
aux diverses pratiques culturelles locales et à l’utilisation qui en était
faite de temps en temps dans la sphère de la prédication et de la dévotion.
L’édition par Theodor Graesse (Dresde 1846, reproduction anastatique de
l’édition Dresden-Leipzig 1890, Onasbrück 1969), basée sur une des premières
éditions imprimées, celle de Drese 1472, rend compte du texte vulgaire de la Legenda
qui s’est constitué durant les deux siècles de sa diffusion maximale ;
l’édition plus récente de Giovanni Paolo Maggioni (2 vol. Florence, 1998, qui a
été suivie, en 1999, d’une seconde édition revue par l’éditeur avec un CD-ROM
attaché, contenant le texte de la Legenda, par L. G. G. Ricci) présente
l’ultime rédaction de l’auteur de l’oeuvre et est basée sur deux manuscrits
(Milan, Ambr., C 240 sup. et Milan, Ambr., M 76 sup.) identifiés parmi les 70
manuscrits les plus anciens comme des témoins de l’ultime rédaction réalisée
par Jacques sur le texte.
Le succès de la Legenda
ne s’est pas terminé avec le Moyen Age, même si le jugement négatif des
humanistes et des Réformés a contribué à son déclin comme texte religieux dans
la prédication comme dans la dévotion privée. Reste cependant le plaisir de la
lecture que le récit hagiographique de Jacques a su offrir et qui en a garanti
la fortune jusqu’à nos jours : nombreuses sont les traductions dans toutes
les principales langues modernes, et nombreuses sont aussi les oeuvres
théâtrales, musicales, figuratives inspirées par elle. Rappelons les deux plus
récentes traductions intégrales en italien et en français, réalisées sur le
texte de l’édition de Graesse, par Alessandro et Lucetta Vitale Brovarone
(Torino 1995) et par une équipe dirigée par Alain Boureau et Monique Goullet
(Paris 2004).
Les recueils de sermons
Jacques a écrit trois
recueils de sermons modèles, les Sermones de sanctis et festis ,
les Sermones de tempore , les Sermones quadragesimales .
Chaque sermon est développé selon la technique du sermo modernus :
il donne un thema initial, toujours constitué par un passage scripturaire, suit
une division qui sépare les parties du sermon, qui sont en général au nombre de
trois, mais le nombre peut varier selon les cas de deux à huit ; chaque
partie peut à son tour être sujette à des divisions spécifiques et plus ou
moins étendues, à l’intérieur desquelle on trouve placés des passages
scripturaires, des auctoritates , des métaphores, des étymologies,
des insertions doctrinales, hagiographiques, liturgiques. Si la technique est
la même dans tous les sermonnaires, toutefois dans le De sanctis les
modèles apparaissent plus schématiques, tandis que dans le De
tempore et ensuite, encore plus, dans les Quadragesimales les
plans se font plus articulés et plus riches de contenu. Les modèles de sermons
de Jacques sont caractérisés, outre un certain caractère schématique comme on
l’a dit, par de multiples citations scripturaires, par l’absence de prothema ,
par l’utilisation modérée des auctores profanes, par la présence
faible et épisodique des exempla , par le recours constant au langage
figuré, par l’usage continu et envahissant de la distinctio , par
laquelle est souvent traitée la divisio du sermon et les divisions
internes des parties individuelles. Les sources, souvent citées indirectement
de florilegia , sont celles déjà utilisées pour la Legenda
aurea : la littérature patristique et monastique, les textes pour la
prédication élaborés en milieu dominicain, quelques oeuvres de caractère
historique et quelques auteurs profanes.
Les dates de composition
sont incertaines. L’ordre de composition des trois sermonnaires est
probablement celui selon lequel Jacques les liste dans la Chronica ,
c’est-à-dire De sanctis , De tempore et Quadragesimales .
Puisque le premier sermonnaire, le De sanctis , a été composé après
la rédaction de la Legenda aurea , comme on le lit dans le prologue
présent dans certains manuscrits, et le dernier, le Quadragesimale ,
pourrait avoir été porté à terme en 1286, comme il apparaît dans le colophon
des manuscrits de l’aire anglaise (“expliciunt sermones fratris Ianuensis
ordinis praedicatorum compilati anno Domini MCCLXXXVI”), on peut supposer que
dans l’ensemble les trois recueils ont été écrits après 1267, c’est-à-dire la
première rédaction de la Legenda , ou peut-être après 1277,
c’est-à-dire après la fin du premier provincialat, comme beaucoup de biographes
sont portés à le croire, et pas après 1286. Les trois sermonnaires eurent un
extraordinaire succès, comme en témoigne le grand nombre de manuscrits
restants, plus de 1120. Un nombre qui fait des sermonnaires de Jacques de
Voragine les sermonnaires médiévaux dont nous est parvenu le plus de
manuscrits.
Les Sermones de
omnibus sanctis et festis comprennent 305 sermons dédiés aux saints et aux
fêtes liturgiques. A chaque saint ou fête sont dédiés de deux à neuf sermons.
Dans la Chronica , Jacques déclare avoir écrit deux volumes de ces
sermons, un plus ample, celui qui nous est parvenu, l’autre plus bref, dont on
n’a pas connaissance. Les saints et les fêtes sont listés selon l’ordre du
calendrier ecclésiastique déjà adopté dans la Legenda aurea , en
nombre cependant réduit : des 178 chapitres de la Legenda plus
de cent ne sont pas repris dans les Sermones , pour la plupart ceux
dédiés à des saints « mineurs » des premiers siècles, martyrs et
moines. Nombreux sont les extraits repris de la Legenda et présentés
dans les Sermones sous une forme résumée et moralisée. L’oeuvre se
présente en effet comme la transposition sous forme de sermon du matériau
hagiographique recueilli dans la Legenda . Jacques lui-même, dans le
prologue, reconnaît avoir écrit le De sanctis à la suite des sollicitations de
ses confrères qui avaient lu et apprécié la Legenda aurea . Le succès
du recueil est attesté par plus de 300 manuscrits, et par les éditions, qui se
sont succédées de façon ininterrompue du XVe au XIXe siècle à partir de
l’editio princeps de Cologne 1478 (pour la liste des manuscrits, voir Schneyer,
III, pp. 266-268 ; Kaeppeli-Panella, II, n. 2155, pp. 359-61 et IV, p.
141). L’édition des Sermones de sanctis par Giovanni Paolo Maggioni
est sous presse à la Sismel – Editions del Galuzzo. Pour le texte et les
problèmes liés à l’édition, voir le matériau recueilli par Giovanni Paolo
Maggioni sur le site ephilology.org(link
is external).
Le deuxième recueil,
connu sous des titres variés ( Sermones de omnibus evangeliis
domenicalibus , selon l’indication de Jacques lui-même, ou Sermones
de tempore per annum , Sermones dominicales , Sermones
festivales ), comprend 160 modèles de sermons, trois pour chaque Evangile
du dimanche. Cette oeuvre également écrite, comme le déclare Jacques dans le
prologue, sur la sollicitation de ses confrères (“importuna fratrum instantia”)
est dédiée à la Trinité, à la Vierge Marie et à saint Dominique, à
l’intercession duquel il se recommande pour la bonne diffusion de l’oeuvre.
Dans ce cas aussi on compte énormément de manuscrits, plus de 350, et de
nombreuses éditions qui suivent la princeps de Cologne 1467-69 (voir Schneyer,
IIII, 233-235 ; Kaeppeli-Panella, II, n. 2156, pp. 361-364 et IV, p. 141).
Pour confirmer la fortune séculaire du recueil, signalons une traduction
italienne éditée à Milan chez Fabiani en 1913-1914 sous le titre Sermoni
domenicali .
Les Sermones
quadragesimales comprennent 98 modèles de sermons prêchables durant la
période de Carême (deux pour chaque feria). L’édition disponible depuis peu,
réalisée par Giovanni Paolo Maggioni (Sismel – Edizioni del Galluzzo, Firenze
2004), est basée sur six témoins des principales aires de diffusion du texte
(aire italienne, germanique et britannique) : Firenze, Laurenz., Acq. e
Doni 344 ; Graz, Universitätbibl., 1472 ; London, Lambeth Palace
Library, 23 ; München, Bayerische Staatsbibl., clm 18850 ; Tosi,
Bibl. Com., 142 ; Würzburg, Universitätbibl., M.p.th.f. 54. Les manuscrits
appartiennent tous au XIIIe siècle à l’exception du témoin anglais, remontant
aux ultimes décennies du XIVe siècle, le plus ancien de la famille insulaire,
la seule caractérisée par la datation 1286, présente dans l’ explicit .
L’édition, bien que constituant, comme l’affirme son éditeur, une sorte
de prolegomena à une future édition définitive, représente une
avancée notable par rapport aux éditions précédentes et parvient à certaines
conclusions : la confirmation que Jacques s’est servi de florilegia pour
les citations des auctoritates , l’hypothèse, hautement probable, que
le texte est le fruit d’une unique rédaction, la certitude que les deux sermons
finaux présents dans de nombreuses éditions, le Sermo de Passione
Domini et le Sermo in planctu Beatae Virginis Mariae ,
n’appartiennent pas au recueil original et ne sont donc pas authentiques. Comme
les autres recueils, les Sermones quadragesimales ont eu aussi un
extraordinaire succès, attesté par plus de 300 manuscrits et de nombreuses
éditions du XVe au XIXe siècle, suite à la princeps de Brescia 1483.
Pour la liste des manuscrits, voir l’Appendice à l’édition Maggioni qui reprend
et complète les listes de Schneyer (III, pp. 244-246) et Kaeppeli-Panella (II,
n. 2157, pp. 364-367 et IV, p. 141).
Le Liber Marialis
Le Liber
marialis a aussi été considéré pendant longtemps comme un recueil de
sermons, comme en témoigne, par exemple, le titre Sermones aurei de Maria
virgine Dei matri , présent dans l’édition Venise 1590 et la récente
inclusion dans le Repertorium des sermons de Schneyer. En réalité,
le Liber marialis est certainement un texte composé à l’usage des
prédicateurs mais pas un recueil de sermons. Il s’agit d’un opuscule, comme
l’écrit Jacques lui-même dans le prologue, en l’honneur de la Vierge, qui
présente une liste, par ordre alphabétique, des termes qui illustraient les
caractéristiques, les fonctions, les images, les vertus qui lui étaient
traditionellement attribuées. Les termes listés sont au nombre de 160, d’ Abstinentia à Vulnerata ,
en passant par Ancilla , Assumptio , Aurora , Conceptio , Domus , Fides , Gaudium , Humilitas , Ignis , Luna , Lux , Mater , Mediatrix , Palma , Regina , Requies , Salutatio , Stella , Templum ,
pour ne retenir que quelques exemples ; chacun de ceux-ci constitue le
point de départ d’un traitement schématique qui rappelle fortement le style
d’exposition des sermons. Dans ce cas aussi, on part d’une distinction en
plusieurs points, dans laquelle se trouvent placés des passages de l’Ecriture,
des citations d’ auctores , d’autres distinctions, des métaphores.
Jacques, dans le prologue, déclare avoir composé l’oeuvre à un âge avancé,
lorsque, archevêque de Gênes, il s’est senti désormais proche de la mort et a
voulu se remettre à la tutelle de la Vierge. La date de composition de l’oeuvre
doit donc être placée entre sa nomination à l’archiépiscopat, en 1292, et sa
mort, en 1298. Bien qu’il soit moins important que les autres oeuvres, le Liber
marialis a connu aussi une certaine fortune au Moyen Age et dans les siècles
suivants. On compte environ soixante-dix manuscrits et, à partir de celle
d’Hambourg 1491, beaucoup d’autres éditions du XVe au XIXe siècle (voir
Schneyer, III, p. 283 et Kaeppeli-Panella, II, n. 2158, pp.367-368). Récemment,
une traduction en langue italienne (Iacopo da Varagine, Mariale
aureo , versione italiana, introduzione e dizionario di Valerio Ferrua,
EDB, Bologna 2006).
La Chronique de Gênes
La Chronica
civitatis Ianuensis ab origine urbis usque ad annum MCCXCVII est la
dernière oeuvre de Jacques, écrite à partir de 1295 ou du début 1296, jusqu’à
1298, année de sa mort, c’est-à-dire durant les dernières années de son mandat
archiépiscopal à Gênes. Le texte se divise en douze parties : les cinq
premières traitent de la fondation de la cité, des premières phases de son
histoire, des origines de son nom, de la conversion au christianisme et de son
développement progressif jusqu’à l’année 1294. Suivent quatre parties qui
constituent une sorte de traité politique sur la nature et la typologie du
gouvernement séculier et ses modèles du rector et du civis chrétien.
Trois parties viennnent conclure l’oeuvre, la première dédiée à la
tranformation de Gênes de siège épiscopal en siège archiépiscopal, les deux
autres au passage en revue, par ordre chronologique, des évêques et des
archevêques et des principaux événements arrivés à Gênes et dans le monde
durant leur mandat. La narration se conclut avec une sorte de petite
autobiographie de Jacques, et avec le récit jusqu’en 1297 des événements
arrivés dans les années de son mandat d’archevêqe dans la cité. Comme on le
voit, il s’agit d’un texte “composite”, inspiré par divers styles
d’écriture : l’éloge des laudes civitatum , la narration des
chroniques universelles, le compte-rendu des événements selon les modules de
l’histoire annalitique, le discours doctrinal et normatif des specula .
Les objectifs de l’oeuvre
sont également divers : souligner le lien entre histoire citadine et
action épiscopale, proposer une idée “augustinienne” de l’histoire humaine
comme scénario de l’action salvatrice de Dieu, et, en général, “instruire et
édifier”, comme l’écrit Jacques lui-même dans le prologue. Dans ce but, Jacques
ne se limite pas à alterner le récit des événements avec des considérations de
caractère doctrinal et moral, mais consacre la partie centrale du texte à
l’exposition d’un véritable speculum civitatis dans lequel, à
l’intérieur d’un discours qui ne se s’adresse plus seulement aux Gênois mais
qui acquiert une valeur universelle, sont analysées et évaluées les diverses
formes du gouvernement séculier, sont montrées les qualités du bon rector et
de ses consiliarii , sont indiqués les devoirs du bon citadin dans
ses rapports avec les gouvernants, sa femme, ses fils et ses serviteurs. Le but
didactique et d’édification de l’oeuvre la rend très voisine des textes pour la
prédication : ce n’est pas un hasard si Jacques insère de longs extraits
tirés de la Legenda aurea ou des sermonnaires, ce n’est pas un hasard
si le texte a été de fait utilisé comme un support pour la prédication, comme
le démontre la présence dans la tradition manuscrite d’index thématiques alphabétiques,
instruments typiques de consultation pour les prédicateurs. Les sources de
la Chronica sont elles aussi en grande partie communes aux autres
oeuvres pour la prédication : à côté de sources historiques spécifiques,
comme par exemple les Annali di Caffaro , relatives à l’histoire de
Gênes, nous retrouvons en fait cet ensemble varié d’ auctores déjà
utilisé pour la compilation de la Legenda et des sermonnaires. Il
faut signaler aussi l’utilisation du De regno de Thomas d’Aquin, en
particulier en ce qui concerne l’analyse des diverses formes de gouvernement,
étant bien entendu qu’il existe une distance entre la conception politique de
Jacques et celle du théologien dominicain. La Chronica a eu une
certaine fortune au Moyen Age et dans les siècles suivants, même si elle est
mineure comparée aux autres oeuvres de Jacques : on compte 44 manuscrits
(voir Monleone, I, pp. 351-509 avec l’intégration de Kaepelli-Panella, II, p.
368) et une édition partielle réalisée par Ludovico Muratori ( Rerum Ital.
Script ., IX, Mediolani 1726, coll. 1-56). L’édition critique est de
Giovanni Monleone (Fonti per la storia d’Italia, Roma 1941), qui a fait
précéder le texte par une Etude introductive sur la vie de Jacques et
ses oeuvres, jusqu’à aujourd’hui un point de référence fondamental. L’édition
Monleone, outre le fait de mettre à disposition une version critiquement fiable
de la Chronica , a le mérite d’avoir confirmé le caractère tout à
fait particulier de l’oeuvre de Jacques à l’intérieur du genre des chroniques,
la soustrayant aux jugements impitoyables sur sa fiabilité comme oeuvre
historique que beaucoup dans le cours des siècles, parmi lesquels Coluccio
Salutati et Muratori, lui avaient réservé. Récemment, Stefania Bertini Guidetti
a fourni une traduction intégrale de la Chronica en langue italienne
(ECIG, Genova, 1995), précédée d’un réexamen critique de l’oeuvre en rapport
avec l’histoire de Gênes et l’action pastorale et politique des frères
Prêcheurs.
Autres opuscules
hagiographiques
Jacques a écrit, en
outre, quelques opuscules de caractère hagiographique qui sont
traditionnellement retenus comme authentiques. Certains sont mentionnés par
Jacques lui-même dans plusieurs passages de la Chronica , d’autres
lui sont attribués dans les manuscrits et semblent par le style très proches de
la Legenda aurea .
Trois concernent des
saints et des reliques liés à l’histoire de Gênes : la Legenda seu
vita sancti Syri episcopi Ianuensis , écrite en 1293 (le texte, qui
correspond au chapitre dédié à san Siro dans l’une des ultimes révisions
éditoriales de la Legenda aurea , a été publiée en 1874 par Vincenzo
Promis comme une oeuvre autonome dans Leggenda e inni di san Siro vescovo
di Genova , dans Atti della Società ligure di storia patria , X
(1874), pp. 357-383) ; l’ Historia reliquiarum que sunt in Monasterio
SS. Philippi et Iacobi de Ianua , probablement composée entre 1286 et
1292, et l’ Historia translationis reliquiarum Sancti Iohannis
Baptistae Ianuam , rédigée entre 1296 et 1298 (toutes deux publiées
dans Due opuscoli di Jacopo da Varagine , ed. a cura di A. Vigna e L.
T. Belgrano in Atti della Società ligure di storia patria , X (1874),
pp. 465-479 e pp. 480-491).
Le Tractatus
miraculorum reliquiarum Sancti Florentii et l’ Historia translationis
reliquiarum eiusdem , composés probablement entre 1281 et 1285, sont
contenus dans le manuscrit Fiorenzuola d’Arda, Bibl. Parrochiale (sec. XV), ff.
33r-53v (traduction italienne dans G. Bonnefoy, San Fiorenzo vescovo di
Orange , Roma 1945, pp. 108-126 ; pour la bibliographie sur ce
manuscrit et sur l’oeuvre voir Kaeppeli-Panella, II, p. 369).
La Passio sancti
Cassiani a été écrite par Jacques en 1282 sur la reqête de l’évêque
d’Imola, Sinibaldo de’ Milotti, qui avait consacré en 1271 la nouvelle
cathédrale de la cité à saint Cassien ( Bibliotheca Hagiographica
Latina , 1635b-c).
Bibliographie
Sources
Hieronymus de
Bursellis, Cronica magistrorum generalium Ordinis Praedicatorum,
Bologna , Bibl. Univ. 1999, f. 69 ; A. Potthast, Regesta
Pontificum Romanorum , II, Berlino 1875, n. 24635, p.1971 ; Les
Registres de Boniface VIII , ed. G. Digard, M. Faucon, A, Thomas, R.
Fawtier, 4 voll., Paris 1884-1939 (ad indices s.v. Jacopus archiepiscopus
Januensis e Januensis archiepiscopus ) ; Les registres
de Nicolas IV , ed. E. Langlois, I, Paris 1886, n. 76, pp. 13-14, n. 142,
p. 23 ; Galvagni de la Flamma Cronica ordinis praedicatroum ab anno
1170 usque ad 1333 , ed. B. M. Reichert, in Mon. Ordinis Fratrum
Praed. Historica , II.1, Romae-Stuttgardiae 1897, p. 100 ; Litterae
Encyclicae Magistrorum Generalium ordinis Praedicatorum ab anno 1233 usque ad
annum 1376 , ed. B. M. Reichert, in Mon. Ordinis Fratrum Praed.
Historica , V, Romae-Stuttgardiae-Vindobonae 1900, pp. 148-149, 154,
156 ; Laurentii Pignon Catalogi et Chronica … , ed. G.
Meersseman, in Mon. Ordinis Fratrum Praed. Historica , XVIII, Romae
1936, p. 29, 65, 74 ; D. Puncuh, Liber privilegiorum Ecclesiae
Ianuensis , Genova 1962, n. 124 pp. 185-186 ; nn. 194-195, pp.
294-295.
Etudes
La liste présentée ici
est sélective en ce qui concerne les études les plus datées, pour lesquelles on
renvoie à Th. Kaeppeli – E. Panella, Scriptores Ordinis Fratrum
Praedicatorum , II, Roma 1975, pp. 348-369 (qui comprend les études
jusqu’à 1973) et IV, Roma 1993 pp. 139-141 (qui comprend les études jusqu’en
1991) et à La Légende dorée (Lyon, 1476). Edition critique de la Légende
dorée dans la revision de 1476 par Jean Batailier, d’après la traduction de
Jean de Vignay (1333-1348) de la Legenda aurea (c. 1261-1266) , ed. B.
Dunn-Lardeau, Paris 1997, pp. 1515-1557 (qui comprend les études jusqu’en
1996).
1925
F. Lanzoni, Le leggende di San Cassiano da Imola , in “Didaskleion,
III (1925), pp. 34-44
1935
E.C. Richardson, Material for a Life of Jacopo da Varagine , New York
1935
1936
A. Pagano, Etimologie medievali di Jacopo da Varazze , in Memorie
domenicane , LIII (1936), pp. 81-91
1942
A. Pagano, L’oratoria di Jacopo da Varazze , in Memorie
domenicane , LIX (1942), pp. 69-77, 108-112, 137-141
1946
A. Dondaine, Le dominicain français Jean de Mailly et la ‘Légende
dorée’ , in Archives d’histoire dominicaine , I (1946), pp.
53-102
1949
M. Grabmann, Die Schönheit Marias nach dem ‘Mariale’ des seligen
Jakob von Voragine O.P., Erzbischofs von Genua (+1298) , in Divus
Thomas , XXVII (1949), pp. 87-102
1951
P. Lorenzin, Mariologia Jacobi a Varagine , Roma 1951
1953
A. Dondaine, Saint Pierre Martyr , in Archivum Fratrum
Praedicatorum , XXIII (1953), pp. 66-162
1965
U. M. Carmarino, Giacomo da Varazze , in Bibliotheca
Sanctorum , VI, Roma 1965, coll. 422-25
B. de Gaiffier, Legénde dorée ou légende de plomb ? , in Analecta
Bollandiana , LXXXIII (1965), p. 350
1969
A. Mombrini, La ‘Legenda aurea’ di Jacopo da Varazze , in Memorie
domenicane , LXXXVI (1969), pp. 19-42
1970
S. G. Axters, Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta,
1224-1500 , Louvain 1970, pp. 160-171
1971
M. von Nagy – C. von Nagy, Die ‘Legenda aurea’ und ihr Verfasser
Jacobus de Voragine , Bern-München 1971
P. Raffin, Jacques de Voragine , in Dictionnaire de
Spiritualité, Ascétique et Mystique , Paris 1971, coll. 62-64
J. B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des
Mittelalters , III, Münster Westfalen 1971, pp. 221-283
1972
M. Görlach, The South English Legendary. Gilte Legende and Golden Legend ,
Braunschweig 1972
1973
B. de Gaiffier, L’ ‘Historia apocrypha’ dans la ‘Légende dorée’ ,
in Analecta Bollandiana , XCI (1973), pp. 265-272
1975
G. Huot-Girard, La justice immanente dans la ‘Légende dorée’ ,
in Épopées, légendes et miracles, Cahiers d’études médiévales , ed.
G. H. Allard – J. Ménard, I, Montréal-Paris 1975, pp. 135-147
C. J. Witlin, Las explicacions dels hagiònims en la ‘Legenda aurea’ i la
tradició medieval d’etimologies no-derivacionals , in Analecta sacra
Tarraconensia , XLVIII (1975), pp. 75-84
1976
G. Brunel, ‘ Vida de sant Frances’. Version en langue d’oc et en catalan
de la ‘Legenda aurea’. Essai de classement de manuscrits , in Revue
d’histoire des textes , VI (1976), pp. 219-265
M.-C. Pouchelle, Représentations du corps dans la ‘Légende dorée’ ,
in Ethnologie française , XVI (1976), pp. 293-308
1977
C. Walter, Prozess und Wahrheitsfindung in der ‘Legenda aurea’ , Kiel
1977
1978
J. Chierici, Il miracolo in Jacopo da Varazze, Gonzalo de Berceo e
Dante , in L’Alighieri , XIX (1978), pp. 18-27
R. Hamer, Three Lives from the Golden Legend , Heidelberg 1978
1979
L. J. Bataillon, Iacopo da Varazze e Tommaso d’Aquino , in Sapienza ,
XXXII (1979), pp. 22-29
W. Williams-Krapp, Die deutschen Übersetzungen der ‘Legenda aurea’ des
Jacobus de Voragine , in Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur , CI (1979), pp. 252-276
1980
C. Delcorno, Il racconto agiografico nella predicazione dei secoli
XIII-XIV , in Agiografia dell’Occidente cristiano, secoli
XIII-XIV , Atti dei Convegni dei Lincei, 48, Roma 1980, pp. 79-114 (rist.
con il titolo Agiografia e predicazione in ‘ Exemplum’ e
letteratura tra Medioevo e Rinascimento , Bologna 1989, pp. 7-77)
V. Marucci, Manoscritti e stampe antiche della ‘Legenda aurea’ di Jacopo
da Voragine volgarizzata , in Filologia e critica , V (1980),
pp. 30-50
1981
F. Barth, Legenden als Lehrdichtung. Beobachtungen zu den Märtyrerlegenden
in der ‘Legenda aurea’ , in Europäische Lehrdichtung ,
Festschriften W. Naumann, Darmstadt 1981, pp. 61-73
S. Reames, Saint Martin of Tours in the ‘Legenda aurea’ and Before ,
in Viator , XII (1981), pp. 131-164
1983
A. Boureau, Le prêcheur et les marchands. Ordre divin et désordres du
siècle dans la ‘Chronique de Gênes’ de Jacques de Voragine (1297) ,
in Médiévales , IV (1983), pp. 102-122
K. Kunze, Jacobus a (de) Voragine (Varagine), in Die deutsche
Literatur des Mittelalters : Verfasserlexicon , IV, Berlin-New York
1983, coll. 448-466
A.-J. Surdel, Les quatre éléments dans les légendes hagiographiques du
XIIIe siècle (‘Legenda aurea’, ‘Abbreviatio in gestis sanctorum’), in Les
quatre éléments dans la culture médiévale , ed. D. Buschinger, Göppingen
1983, pp. 49-62
A. Vidmanová, À propos de la diffusion de la ‘Légende dorée’ dans les pays
tchèques , in L’art au XIIIe siècle dans les pays tchèques ,
Prague 1983, pp. 599-619
1984
A. Boureau, La Legende dorée. Le système narratif de Jacques de Voragine
(+1298) , Paris 1984
B. Fleith, Hagiographisches Interesse im 15. Jahrhundert ? Erörtert
an einem Jahrhundert Rezeptionsgeschichte der ‘Legenda aurea’ , in Fifteenth
Century Studies , IX (1984), pp. 85-98
R. O’Gorman, Unrecorded Manuscript with Sermons of Jacobus de Voragine and
Discourses by Pierre aux Bœufs and Jean Petit , in Manuscripta ,
XXVIII (1984), pp. 138-144
P. Petitmengin (ed.), Pélagie la pénitente. Métamorphoses d’une
légende, Paris 1984, II, pp. 145-163
1985
E. Colledge , James of Voragine’s ‘Legenda sancti Augustini’ and its sources ,
in Augustiniana , XXXV (1985), pp. 281-314
B. Dunn-Lardeau – D. Coq, Fifteenth and Sixteenth Century Editions of the
‘Légende dorée’ , in Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance ,
XLVII (1985), pp. 87-101
J. Knape – K. Strobel, Zur Deutung von Geschichte in Antike und
Mittelalter. ‘Historia apocrypha’ der ‘Legenda aurea’ , Bamberg 1985
S. Reames, The ‘Legenda aurea’. A Reexamination of its Paradoxical
History , Madison (Wisconsin) 1985
1986
S. Bastianetto, Iacopo da Varazze , in Dizionario critico della
letteratura italiana , II, Torino 1986, pp. 478-480
B. Dunn-Lardeau, Étude autour d’une ‘Légende dorée’ , in Travaux
de linguistique et de littérature de l’Université de Strasbourg , XXIV
(1986), pp. 257-296
Bibliotheca Hagiographica Latina , n.s., ed. H. Fros, Bruxelles 1986, p.
189
‘ Legenda Aurea’. Sept siècles de diffusion, Actes du colloque sur la
‘Legenda aurea’ : texte latin et branches vernaculaires (Montréal, 11-12
mai 1983) , ed. B. Dunn-Lardeau, Montréal-Paris 1986
A.-J. Surdel, Temps humain et temps divin dans la ‘Legenda aurea’ et dans
les mystères dramatiques (XVe s.) , in Le temps et la durée dans la
littérature au Moyen Age e à la Renaissance , ed. Y. Bellenger, Paris
1986, pp. 85-102
1987
K. E. Geith, Die ‘Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum’ von Jean
de Mailly als Quelle des ‘Legenda aurea’ , in Analecta
Bollandiana , CV (1987), pp. 289-302
G. P. Maggioni, Il codice novarese di Jean de Mailly e la ‘Legenda aurea’.
Due errori del ms. LXXXVI di Novara comuni al testo di Jacopo da Varazze.
Problemi sulle fonti , in Novarien , XVII (1987), pp. 173-184
A. Vauchez, Liturgie et culture folklorique : les Rogations dans la
‘Légende dorée’ de Jacques de Voragine , in Les laïcs au Moyen Age.
Pratiques et expériences religieuses , Paris 1987, pp. 145-155
Jacopo da Varazze. Atti del I Convegno di Studi (Varazze 13-14 apr. 1985),
ed. G. Farris – B. T. Delfino, Cogoleto 1987
1988
G. Airaldi, Jacopo da Varagine tra santi e mercanti , Milano 1988
J. W. Dahmus, A Medieval Preacher and His Sources : Johannes Nider’s
Use of Jacobus de Voragine , in Archivum Fratrum Praedicatorum ,
LVIII (1988), pp. 121-176
P. Devos, Édition des fragments B, C, D (SS. Jean et Paul martyrs, Léon
pape, Pierre apôtre , in Analecta Bollandiana , CVI (1988), pp.
153-170
E. Spinelli, Frammenti agiografici in Beneventana. Note a margine della
‘Legenda aurea’ e della sua diffusione nell’Italia meridionale , in Analecta
Bollandiana , CVI (1988), pp. 143-151
1989
C. Casagrande –S. Vecchio, Cronache, morale, predicazione : Salimbene
da Parma e Iacopo da Varagine , in Studi medievali , 3 s., XXX
(1989), pp. 749-788
R. Hamer – V. Russell, A Critical Edition of Four Chapters from the
‘Légende dorée’ , in Medieval Studies LI (1989), pp. 130-204
1990
F. Dolbeau, Le dossier de Saint Dominique de Sora d’Alberic de Mont-Cassin
à Jacques de Voragine , in Mélanges de l’École français - Moyen
Age , CII (1990), pp. 7-78
B. Fleith, ‘ Legenda aurea’ : destination, propagation, utilisateurs.
L’histoire de la diffusion du légendier au XIIIe et au début du XIVe
siècle , in Raccolte di vite di santi dal XIII al XVII secolo ,
ed. S. Boesch Gajano, Brindisi 1990, pp. 41-48
J. Larmat, Les critères de la sainteté d’après la ‘Légende dorée’ ,
in Razo , X (1990), pp. 43-52
G. P. Maggioni, Aspetti originali della ‘Legenda aurea’ di Iacopo da
Varazze , in Medioevo e Rinascimento , IV (1990), pp. 143-201
Repertorium Fontium Medii Aevi , VI, Romae 1990, pp. 136-139
J. A. Ysern, La ‘Legenda aurea’ i el ‘Recull d’exemplis’ , in Estudis
de llengua i literatura catalanes , XXI (1990), pp. 37-48
1991
B. Fleith, Studien zur Überlieferungsgeschichte der lateinischen ‘Legenda
aurea’ , Bruxelles 1991
L. Gaffuri, Bartolomeo di Breganze predicatore e la ‘Legenda aurea’ ,
in Rivista di storia e letteratura religiosa , XXVII (1991), pp.
223-255
Lexicon des Mittelalters , V, München -Zurich, 1991, pp. 262
e1796-1801
H. Maddocks, Pictures for the Aristocrats : The Manuscripts of the
‘Légende dorée’ , in Medieval Texts and Images. Studies of
Manuscripts from the Middle Ages , ed. M. Manion – B. Muir,
Paris-Sydney 1991, pp. 1-23
1992
T. Baarde, The Etymology of the Name of the Evangelist Mark in the
‘Legenda aurea’ of Jacobus a Voragine , in Neederlands archief voor
kerkegeschiedenis , LXXII (1992), pp. 1-12
B. P. McGuire, A Saint’s Afterlife. Bernard in the Golden Legend and the
Other Medieval Collections , in Bernard de Clairvaux : Histoire,
mentalités, spiritualité , Paris 1992, pp. 179-211
1993
‘ Legenda aurea’ – ‘Légende dorée’ (XIIIe-XVe s.) , Actes du Coll.
intern. de Perpignan, ed. B. Dunn-Lardeau, in Le Moyen Âge français ,
XXXII (1993)
A. Boureau, L’événement sans fin. Récit et christianisme au Moyen
Age , Paris 1993, pp. 000-000
C. Campana, La tradizione veneziana della ‘Translatio sancti Nicolai’ nel
primo volgarizzamento italiano a stampa della ‘Legenda aurea’ di Jacopo da
Varazze , in Miscellanea Marciana , VII-IX (1992-1994), pp.
103-1115
S. Bertini Guidetti, Il mito di Genova in Iacopo da Varazze : tra
storia e satira , in XIV Congr. di Studi Umanistici ,
Sassoferrato 23-23 giugno 1993, in Studi umanistici piceni , XIV
(1994), pp. 63-69
1994
A. Boureau, Saint Bernard dans les légendiers dominicains , in Vies
et légendes de Saint Bernard de Clairvaux , ed. P. Arabeyre – J. Berlioz –
Ph. Pirrier, Cîteaux 1994, pp. 84-90
R. Gounelle, Sens et usage d’ ‘apocryphus’ dans la ‘Légende dorée’ ,
in Apocrypha , V (1994), pp. 189-210
G. P. Maggioni, Diverse redazioni della ‘Legenda aurea’. Particolarità e
problemi testuali , in La critica del testo mediolatino . Atti
del Convegno, Firenze 6-8 dicembre 1990, ed. C. Leonardi, Spoleto 1994, pp.
365-380
1995
B. Fleith – A. Wenzel, ‘ Legenda aurea’ , in Enzyklopädie des
Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden
Erzählforschung , VIII, Berlin – New York, 1995, pp. 846-855
G. P. Maggioni, Appelli al lettore e definizione di apocrifi nella
‘Legenda aurea’. A margine della legenda di Giuda Iscariota , in Medioevo
e Rinascimento , IX (1995), pp. 241-253
G. P. Maggioni, Dalla prima alla seconda redazione della ‘Legenda aurea’.
Particolarità e anomalie nella tradizione manoscritta delle compilazioni
medievali , in Filologia medievale , II (1995), pp. 259-277
G. P. Maggioni, Ricerche sulla composizione e sulla trasmissione della
‘Legenda aurea’ , Spoleto 1995
R. Rhein, Die ‘Legenda Aurea’ des Jacobus de Voragine : die
Entfaltung von Heiligkeit in ‘Historia’ und ‘Doctrina’ , Köln-Weimar, 1995
A. Winroth, ‘ Thomas interpretatur abyssus vel geminus’. The Etymologies
in the Golden Legend of Jacobus de Varagine , in Symbolae
Septentrionales. Latin Studies Presented to Jan Oeberg , Stockholm 1995,
pp. 113-135
1996
S. Bertini Guidetti, Enquête sur les techniques de compilation de Jacques
de Voragine , in Cahiers d’histoire , XVI (1996), pp. 5-24
P. Bourgain, Les sermons de Federico Visconti comparés aux écrits de Fra
Salimbene et Jacques de Voragine , in Mélanges de l’École française
de Rome - Moyen Âge, CXVIII (1996), pp. 243-257
B. Fleith, Die ‘Legenda aurea’ und ihre dominikanischen Bruderlegendare.
Aspekte der Quellenverhältnisse apokryphen Gedankenguts, in Apocrypha ,
VII (1996), pp. 167-191
T. Refice, Jacopo da Varazze , in Enciclopedia dell’arte
italiana , VII, Roma 1996, pp. 254-256
1997
S. Bertini Guidetti, Iacopo da Varagine e le ‘Ystorie antique’ :
quando il mito diventa ‘exemplum’ nella storia , in Posthomerica
I : tradizioni omeriche dall’Antichità al Rinascimento , Genova 1997,
pp. 139-157
A. Boureau, Vincent de Beauvais et les légendiers dominicains ,
in Vincent de Beauvais, frère prêcheur : un intellectuel et son
milieu au XIIIe siècle , Grâne 1997, pp. 113-126
M. D. Edward, The Handling of Narrative in the Cycle of St. Catherine
of Alexandria in the Oratory of St. George in Padua (c. 1379-1384) , Il
Santo , XXXVII (1997), pp. 147-163
G. Farris, L’anti-trinitarismo di Lucifero nei Sermoni di Jacopo da
Varazze e nel canto XXXIV dell’Inferno , Critica letteraria ,
XXV (19997), pp. 211-224
B. Fleith, The Patristic Sources of the ‘Legenda aurea’ : a Research
Report , in The Receptions of the Church Fathers in the West ,
ed. I. Backus, I, Leiden-New York-Köln 1997, pp. 231-287
L. Gaffuri, Paroles pour le clergé, paroles pour le peuple. Définition de
la foi et réfutation de l’hérésie dans deux sermonnaires du XIIIe siècle ,
in La parole du prédicateur. Ve-Xe siècle , ed. M. Lauwers – R.
M. Dessì, Nice 1997, pp. 343-362
Gonden Legende. Heiligenlevens en Heiligenverering in de Nederlanden , ed.
A. Mulder-Bakker – M. Carasso-Kok, Hilversum 1997
G. P. Maggioni, Storie malvagie e vite di santi. Storie apocrife, cattivi
e demoni nei leggendari condensati del XIII secolo , in Tra
edificazione e piacere della lettura : le vite dei santi in età
medievale , Atti del Convegno (Trento 22-23 ott. 1996), ed. A.
Degl’Innocenti – F. Ferrari, Trento 1997, pp. 131-143
1998
S. Bertini Guidetti, Contrastare la crisi della chiesa cattedrale :
Iacopo da Varagine e la costruzione di un’ideologia propagandistica ,
in Le vie del Mediterraneo. Uomini, idee, oggetti (secoli XI-XVI) , a
cura di G. Airaldi, Genova 1998, pp. 155-182
S. Bertini Guidetti, Potere e propaganda a Genova nel Duecento ,
Genova 1998
S. Bertini Guidetti, I ‘Sermones’ di Iacopo da Varazze. Il potere delle
immagini nel Duecento , Firenze 1998
S. Bertini Guidetti, Fonti e tecniche di compilazione nella ‘Chronica
civitatis Ianuensis’, di Iacopo da Varagine , in Gli umanesimi
medievali , Atti del Convegno di Firenze, 11-13 settembre 1993, Firenze
1998, pp. 17-36
D. J. Collins, A Life Reconstituted : Jacobus de Voragine, Erasmus of
Rotterdam and Their Lives of St. Jerome , in Medievalia et
Humanistica , XXV (1998), pp. 31-51
A. Ferreiro, Simon Magus and Simon Peter in a Baroque Altar Relief in the
Cathedral of Oviedo, Spain , Hagiographica , V (1998), pp.
141-148
M. Görlach, Studies in Middle English Saints’ Legends ,
Heidelberg 1998
La ‘Légende dorée’ de Jacques de Voragine : le livre qui fascinait le
Moyen Age , ed. B. Fleith et alii, Genève 1998
1999
E. Colomer Amat, El ‘Flos Sanctorum’ de Loyola y las distinctas ediciones
de la ‘Leyenda de los santos’. Contribución al catálogo de Juan Varela de
Salamanca , in Analecta sacra Tarraconensia , LXXII (1999), pp.
109-142
R. Schnell, Kostanz und Metamorphosen eines textes. Eine überlieferungs
und geschlechtergeschichlicheStudie zur volkspredichten Rezeption von Jacobus
de Voragine , in Frühmittelelterliche Studien , XXXIII (1999),
pp. 319-395
2000
M. Balzert, Ein Carmen sapphicum in der Legenda-Aurea-Appendix ,
in Hagiographie im Kontext. Wirkungsweisen und Möglichkeiten historischer
Auswertung, ed. D. R. Bauer - K. Herbers, Stuttgart, 2000, pp. 000-000
K. Jansen, The Making of the Magdalen : Preaching and Popular
Devotion in the later Middle Ages , Princeton 2000, pp. 000-000
2001
Il Paradiso e la terra. Iacopo da Varazze e il suo tempo , Atti del
Convegno Intern. di Studio, Varazze 24-26 sett. 1998, a cura di S. Bertini
Guidetti, Firenze 2001
De la saintété à l’hagiographie. Genèse et usage de la ‘ Légende dorée’ ,
ed. B. Fleith – F. Morenzoni, Genève 2001
P. Di Pietro Lombardi - M. Ricci – A. R. Venturi Barbolini, ‘ Legenda
aurea’ : iconografia religiosa nelle miniature della Biblioteca estense
universitaria , Modena 2001
D. D’Avray, Medieval Marriage Sermons : Mass Comunication in a
Culture without Print , Oxford 2001, pp. 000-000
2002
G. P. Maggioni, La trasmissione dei legendari abbreviati del XIII
secolo , in Filologia Mediolatina , IX (2002), pp. 87-107
2003
G. P. Maggioni, Parola taciute, parole ritrovate. I racconti agiografici
di Giovanni da Mailly, Bartolomeo da Trento e Iacopo da Varazze , in Le
riscritture agiografiche , Atti del V Convegno della SISMEL, Firenze 22-23
marzo 2002, Hagiographica , X (2003), pp. 00-00.
SOURCE : http://www.sermones.net/content/la-vie-et-les-oeuvres-de-jacques-de-voragine-op
Il
beato Jacopo riappacifica guelfi e ghibellini, gruppo ligneo, Chiesa
natività maria Casanova, Varazze, 1930
Also
known as
James of Varazze
James of Viraggio
James of Genoa
Giacomo….
Jacob….
Jacobus….
Jacopo….
Profile
Dominican in 1244 at
age 14. Taught theology and Bible
study. Prior of
his house in Genoa, Italy.
Provincial of Lombardy from 1267 to 1286 where
he was a noted preacher.
Chosen archbishop of Genoa in 1286,
but refused the position. Genoa was
placed under interdict for supporting a revolt against the King of Naples; Pope Nicholas
IV apppointed James to raised the interdict in 1288.
Again chosen archbishop of Genoa in 1292,
and this time he was ordered to accept.
He tried to reconcile the
warring Guelphs
and Ghibellines, was generous to the poor,
built and repaired churches, monasteries,
and hospitals.
He worked to insure clerical discipline,
and is reported to have translated the Bible into Italian,
though no copies have survived. Wrote the Legenda
Aurea Sanctorum (the Golden
Legend), a collection of scores of tales of the saints;
it has become an invaluable source for information on the middle ages.
Born
c.1226 at Varazze (modern
Voragine), diocese of Savona, Italy (near Genoa)
13 July 1298 in Genoa, Italy of
natural causes
11 May 1816 by Pope Pius
VII (cultus
confirmation)
Additional
Information
Catholic
Encyclopedia, by Michael T Ott
Saints
and Saintly Dominicans, by Blessed Hyacinthe-Marie
Cormier, O.P.
books
Our Sunday Visitor’s Encyclopedia of Saints
other
sites in english
Christian Classics Ethereal Library, by E C Richardson
images
sitios
en español
Martirologio Romano, 2001 edición
sites
en français
fonti
in italiano
MLA
Citation
“Blessed James of
Voragine“. CatholicSaints.Info. 14 January 2022. Web. 10 October 2024.
<https://catholicsaints.info/blessed-james-of-voragine/>
SOURCE : https://catholicsaints.info/blessed-james-of-voragine/
New
Catholic Dictionary – Blessed James of Viraggio
Article
Archbishop of Genoa,
born Viraggio (now Varezze), near Genoa, Italy,
c.1230; died Genoa, Italy,
1298. He became a Dominican in
1244 and his reputation for piety, learning, and zeal in the care of souls
spread rapidly. After several attempts to evade the episcopal dignity, he was
elected to the archepiscopal See of Genoa, 1292,
his episcopate falling in the period of dissension between the Guelphs and
Ghibellines, whom he sought in vain to reconcile. He is the author of a
collection of legendary lives of the saints, entitled the Golden Legend. His works also include a
chronicle of Genoa, a collection of 307 sermons, and a defense of the Dominican
Order. Beatified,
1816. Relics in San Maria di Castello, Genoa. Feast, 13
July.
MLA
Citation
“Blessed James of
Viraggio”. People of the Faith. CatholicSaints.Info. 4
December 2010.
Web. 10 October 2024. <http://catholicsaints.info/new-catholic-dictionary-blessed-james-of-viraggio/>
SOURCE : https://catholicsaints.info/new-catholic-dictionary-blessed-james-of-viraggio/
JACOBUS: The Latin
form of James (q.v.); see also JACOB.
JACOBUS DE VARAGINE,
GIACOMO DA VARAZZE, JACOPO DA VARAZZE (often called Jacob, or James, of
Viraggio) : Archbishop of Genoa; b. at Casanuova in Varazze (on the coast, 18
m. s.w. of Genoa) c.1228 (or 1230); d. in Genoa July 16 (?), 1298. He entered
the Dominican order in 1244, probably studied at Cologne, Paris, and Bologna,
became prior at Genoa (or Asti) about 1258, was provincial prior for Lombardy
1267-76, 1281-86, and archbishop of Genoa 1292-98. He fulfilled several
quasi-diplomatic missions and as archbishop exercised feudal authority over San
Remo and governed certain churches in the Levant. As archbishop he promoted
efforts for the reform of the clergy, intervened successfully to promote peace
between Guelph and Ghibelline, and transferred the government of San Remo to
the civil authority. He was beatified by Pius VII. in 1816, and is popularly
reverenced in Liguria as the promoter of peace.
Jacobus is best known for
his writings, especially the "Golden Legend," which was possibly the
most popular book of the Middle Ages. This work, known also as "Lives of the
Saints" and as Historia Lombardica, consists of readings from
the lives of the saints for the festivals of the church year. It was probably
written before 1260, and was very early translated into at least French,
German, English (by William Caxton, 1484?), Italian, and Dutch. Within about
fifty years after the invention of printing more than 100 editions of original
and translations had been printed. Besides the "Golden Legend"
Jacobus wrote several series of sermons "On the Saints," "On the
Blessed Virgin," etc., only less popular than the Legend, and also known
as "Golden" on account of their popularity. His "Chronicle of
Genoa" is a somewhat heterogeneous mass, but not without some historical
value. He is alleged also to have made the first translation of the Bible into
Italian and there are reasons for supposing that he wrote the "Game of
Chess," which, like the "Golden Legend," is best known in
English under the name of Caxton. Several other hitherto disputed or lost
writings, an "Art of Preaching," a "Summary of Vices and
Virtues," Sermones in visitationibus religiosoram, etc., have
recently been discovered or established as his.
E. C. RICHARDSON.
BIBLIOGRAPHY: For
editions of the works of Jacobus consult: Potthast, Wegweiser, pp,
634-35. An incomplete text of the Chronicle is in Muratori, Scriptores, ix.
5-56; the most convenient text of the Sermons is that of Antwerp, 1712, in 6
vols.; the standard edition of the Golden
Legend is by J. G. T.
Graesse, Leipsic, 1846, new ed., Wratislaw, 1890; the Eng. transl. of the
Golden Legend by Caxton, with introduction and notes by Eales, was published
London, 1888, and a sumptuous edition, ed. W. Morris and F. S. Ellis, 3 vols.,
ib. 1892. The prefaces to the many editions and translations contain
biographical and bibliographical material. The standard monographs are: P.
Anfossi, Memorie istoriche appartenenti alla vita del . . . Jacopo da
Voragine, Genoa; G. Spotorno, Notizie storico-critico del . . .
Giacomo da Varazze, Genoa, 1823; and V. M. Palazza, Vita del . . .
Giacomo da Varazze, Genoa, 1867. Consult also M. Waresquiel, Le
Bienheuerux Jacques de Voragine, Paris, 1902; J. C. Broussole, Préface
à la Légend dorsée, Paris, 1907. The Princeton Theological
Review for April, 1903, contains an article on the Golden Legend, and for
July, 1904, one on "Voragine as a preacher," Consult farther: J. Quétif
and J. Echard, Scriptores ordinis praedicatorum, i. 454-459, ii. 818,
Paris, 1719-21; ASB, Jan., i., pp. xix.-xx.; KL, vi.
1178-82.
SOURCE : https://www.ccel.org/s/schaff/encyc/encyc06/htm/iii.lv.xxv.htm
Unknown from
Padua, Giovanni Pietro Birago, Antonio Mario Sforza (illuminators). A leaf from
the "Golden Legend": Archangel Michael / Karta ze "Złotej
legendy": Archanioł Michał, circa 1480, ink and color on parchment,
25,5 x 17, National Library of Poland. Provenance:
1480: commissioned by Francesco Vendramini of Venice
1525: transferred to Krzysztof Szydłowiecki, Deputy Chancellor of the Crown
1790s: transferred to Tadeusz Czacki in Poryck
1818: transferred to Adam Jerzy Czartoryski in Puławy
XIXth
century: transferred to Library of the Zamoyski Estate
Blessed Jacopo de
Voragine
(Also DI VIRAGGIO).
Archbishop of Genoa and medieval hagiologist,
born at Viraggio (now Varazze), near Genoa,
about 1230; died 13 July, about 1298. In 1244 he entered the Order
of St. Dominic, and soon became famous for his piety,
learning, and zeal in
the care of souls.
His fame as a preacher spread throughout Italy,
and he was called upon to preach from the most celebrated pulpits of Lombardy.
After teaching Holy
Scripture and theology in
various houses of his order in Northern Italy,
he was elected provincial of Lombardy in
1267, holding this office until 1286, in which year he
become definitor of the Lombard province of Dominicans.
In the latter capacity he attended a chapter at Lucca in
1288, and another at Ferrara,
in 1290. In 1288 he was commissioned by Pope
Nicholas IV to free the Genoese from
the ban of the Church,
which they had incurred for assisting the Sicilians in
their revolt against the King of Naples.
When Archbishop Charles Bernard of Genoa died,
in 1286, the metropolitan chapter of Genoa proposed
Jacopo de Voragine as his successor. Upon his refusal to accept the
dignity, Obizzo Fieschi, the Patriarch of Antioch whom
the Saracens had
driven from the see,
was transferred to the archiepiscopal See of Genoa by Nicholas
IV in 1288.
When Obizzo Fieschi
died, in 1292, the chapter of Genoa unanimously elected Jacopo
de Voragine as his successor. He again endeavoured to evade the archiepiscopal dignity,
but was finally obliged to
yield to the combined prayers of
the clergy,
the Senate, and the people of Genoa. Nicholas
IV wished to consecrate him bishop personally,
and called him to Rome for
that purpose; but shortly after the arrival of de Voragine the pope died,
and the new bishop was consecrated at Rome during
the succeeding interregnum, on 13 April, 1292. The episcopate of
Jacopo de Voragine fell in a time when Genoa was
a scene of continuous warfare between
the Rampini and the Mascarati, the former of whom were Guelphs,
the latter Ghibellines.
The archbishop,
indeed, effected an apparent reconciliation between the two hostile parties in
1295; but the dissensions broke out anew, and all his efforts to restore peace
were useless. In 1292 he held a provincial synod at Genoa,
chiefly for the purpose of identifying the relics of St.
Syrus, one of the earliest bishops of Genoa (324?).
The cult of Jacopo de Voragine, which seems to have begun soon after his death,
was ratified by Pius
VII in 1816. The same pope permitted
the clergy of Genoa and Savona,
and the whole Order
of St. Dominic, to celebrate his feast as that of a saint.
Jacopo de Voragine is
best known as the author of a collection of legendary lives of
the saints,
which was entitled "Legenda Sanctorum" by the author, but soon became
universally known as "Legenda Aurea" (Golden Legend), because
the people of those times considered it worth its weight in gold. In some of
the earlier editions it is styled "Lombardica Historia", which title
gave rise to the false opinion
that this was a different work from the "Golden Legend". The title
"Lombardica Historia" originated in the fact that in
the life of Pope
Pelagius, which forms the second last chapter of the "Golden
Legend", is contained an abstract of the history of the Lombards down
to 1250 (Mon. Germ. Hist.: Script., XXIV, 167 sq.). In the preface to the
"Golden Legend" the author divides the ecclesiastical year
into four periods, which he compared to four epochs in the history of
the world, viz. a time of deviation, renovation, reconciliation,
and pilgrimage.
The body of the work, which contains 177 chapters (according to
others, 182), is divided into five sections, viz. from Advent to Christmas,
from Christmas to Septuagesima,
from Septuagesima to Easter,
from Easter to Octave of Pentecost,
and from the Octave of Pentecost to Advent.
If we are to judge the "Golden Legend" from
an historical standpoint, we must condemn it as entirely uncritical
and hence of no value, except in so far as it teaches us that the people of
those times were an extremely naive and thoroughly religious people,
permeated with an unshakable belief in God's
omnipotence and His fatherly care for those who lead
a saintly life.
If, on the other hand, we
view the "Golden Legend" as an artistically composed book
of devotion, we must admit that it is a complete success. It is admirably
adapted to enhance our love and
respect towards God,
to foster our devotion towards His saints,
and to animate us with a holy zeal to
follow their example. The chief object of Jacopo de Voragine and of other medieval hagiologists was
not to compose reliable biographies or to write scientific treatises
for the learned, but to write books of devotion that were adapted to
the simple manners of the common people. It is due to a wrong conception of the
purpose of the "Golden Legend" that Luis Vives (De causis
corruptarum artium, c. ii), Melchior
Canus (De locis theologicis, xi, 6), and others have
severely denounced it; and to a true conception
that the Bollandists (Acts
SS., January, I, 19) and many recent hagiologists have highly praised
it. That the work made a deep impression on the people is evident from its
immense popularity, and from the great influence it had on the prose and
poetic literature of many nations. It became the basis of
many passionals of the Middle
Ages and religious poems of later
times. Longfellow's "Golden Legend", which, with two other
poems, forms the trilogy entitled "Christus", owes its name and many
of its ideas to
the "Golden Legend" of de Voragine.
Bernard Guidonis (d.
1331), also a Dominican,
made a vain attempt to supplant it by a more reliable work of the
same character, which he entitled "Speculum Sanctorum". In 1500
as many as seventy-four Latin editions of the "Legenda
Aurea" had been published, not counting the three translations
into English, five French, eight Italian,
fourteen Low German, and three Bohemian.
The first printed edition was in Latin, and was produced at Basle in
1470. Many succeeding editions contain additions of the lives of later saints or
of feasts introduced after the thirteenth century. The
best Latin edition was prepared by Graesse (Dresden
and Leipzig, 1846, 1850, and Breslau, 1890). The
first English edition was printed by William
Caxton at London in
1483 from a version made about 1450. It was inscribed :
The Golden Legend.
Fynysshed at Westmere the twenty day of Novembre/ the yere of our Lord
M/CCCC/LXXXIII/. By me Wyllyam Caxton.
In this edition some of
the less credible legends of the original are omitted. The publication
was made at the instance of the Earl of Arundel, who agreed to take "a
reasonable number of copies", and to pay as an annuity "a buck in
summer and a doe in winter" (see Putnam, "Books and
their Makers in the Middle Ages", New York and London,
II, 1897, 118). Caxton's edition was re-edited and modernized
by Ellis (London and New York, 1900). The
first French version that appeared in print was made by Jean
Batallier, and printed at Lyons in
1476. A French translation,
made by Jean Belet de Vigny in the fourteenth century, was first
printed at Paris in
1488. Recent French editions were prepared by Brunet, signed M. G. B.
(Paris, 1843 and 1908); by de Wyzewa (Paris, 1902); and
by Roze (Paris, 1902). an Italian translation by Nicolas
Manerbi was printed in 1475, probably at Venice;
a Bohemian one
was printed at Pilsen between 1475 and 1479, and another at Prague in
1495; a Low German one at Delft in 1472, and at Gouda in 1478.
A German reproduction in poetry was made by Kralik (Munich, 1902).
Another important work of
Jacopo de Voragine is his so-called "Chronicon Genuense", a chronicle
of Genoa reaching
to 1296. Part of this chronicle, which is a valuable source of Genoese history,
was published by Muratori in "Rerum Italicarum Scriptores"
(Milan, 1723-51), IX, 5-56. Concerning it see Mannucci, "La
cronaca di Jacopo da Viraggio" (Geneva, 1904). He is also the author of a
collection of 307 sermons, "Sermones de sanctis, de tempore,
quadragesimales, de Beata Maria Virgine". They have been repeatedly
printed, both separately and collectively. The earliest edition of the
whole collection was printed in 1484, probably at Venice,
where they were published a second time in 1497 and repeatedly thereafter. His
remaining literary productions are "Defensorium contra impugnantes Fratres Praedicatores"
(Venice, 1504), which is a defence of the Dominicans against
some who accused them of not leading an Apostolic life;
"Summarium virtutum et vitiorum" (Basle, 1497), which is an epitome
of a work of the same title, written by William
Peraldus, a Dominican who
died about thirty years before Jacopo de Voragine. A theological work,
entitled "De operibus et opusculis Sancti Augustini", is also
generally ascribed to him, but its authenticity has not yet been
sufficiently established. It is known that he was a close student of St.
Augustine. Some, relying on the authority of Sixtus of Siena,
ascribe to him also an Italian translation of the Bible,
but no manuscript or
print of it has ever been found.
Ott,
Michael. "Blessed Jacopo de Voragine." The Catholic
Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton
Company, 1910. 13 Jul.
2017 <http://www.newadvent.org/cathen/08262b.htm>.
Transcription. This
article was transcribed for New Advent by David Joyce.
Ecclesiastical
approbation. Nihil Obstat. October 1, 1910. Remy Lafort, S.T.D.,
Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York.
Copyright © 2023 by Kevin Knight.
Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.
SOURCE : http://www.newadvent.org/cathen/08262b.htm
Jacopo
da Varazze, Leggenda aurea, incunabolo del 1482 con miniature, Collections of
the Museo della città, Livorno
Jacopo
da Varazze, Leggenda aurea, incunabolo del 1482 con miniature, Collections of
the Museo della città, Livorno
Blessed James of
Voragine, B.C.O.P.
also known as Giacomo da
Varazze
Memorial Day: July 13th
Profile
James of Voragine has
been beatified by the Church for the sanctity of his life. He lives in secular
history for quite a different reason-he was a creative genius of his age. His
so-called Golden Legends, which has enjoyed a circulation of nearly
seven centuries, is only one of several projects which in his time, as in ours,
are a tribute to the versatility of the man and the zeal of a saint.
Little is recorder of the
childhood of James. He entered the order, in Genoa, and soon was known both for
his virtue and for a singularly alert and practical mind. Tradition says that
James was the first to translate the Bible into Italian. Whether this is true
or not, it is ample evidence that he was a good scholar.
As Prior, provincial, and
later Arch-Bishop, James gained a reputation for strict observance, heroic
charity, and sound good sense. He was a builder where war had wrecked, a peace
maker where others sowed trouble. He must of had a contagious zeal, for the
wealthy gave to him as readily as the poor begged from him, and under his hand
ruined churches and hospitals were built again, the sick and poor were cared
for , and order was restored. He was a genius at getting things done; and ,
fortunately his whole heart was bent on doing for the glory of God.
Like others of his
calling and training, James was first of all a preacher. For those many who
could not read, one of the chief means of instruction was sermons which took
their key note from the feast of the day. The saints, the stories of their live
and examples of their virtues , became as much part of a Christians life as the
people around him. The collection of stories - later called The Golden
Legend - started as a series of sermons prepared by James for the various
festival of the saints. Since he preached in Italian, rather than in Latin, his
sermons had immense popular appeal, and they were rapidly copied by other
preachers into all the languages of Europe. The Golden Legend was
, next to the Bible, the most popular book of the middle ages.
James was rigorous in his
observance of the Dominican Rule, which is of itself enough to canonize him. He
had also the good sense to make use of changing trends to further the work of
God. Today he would be using the radio, the press, the movies, and television;
then he used what his century had to offer- sermons in the vernacular,
religious drama, and music. How much present day drama and music owed to him,
it would be impossible to say. There is an amusing story told of his efforts to
fight fire with fire. He organized a troop of jugglers and acrobats from the
student novices of San Eustorgio, in Milan, who were to mingle
entertainment with doctrine in an effort to combat the indecency of the secular
theater. This was one scheme which left no lasting effect on the order, but it
does serve to show that James was a man of his times, alert to the changing
needs of a fast moving world, and whole heartedly determined to win the world
to the truth of the One Holy Catholic Faith by any honest means that came to
hand.
Purity, poverty and
charity were the outstanding virtues of this man whom the Church has seemed fit
to enroll among Her blesseds. He will always be recognized in Dominican history
as a man of many and peculiar gifts, who consecrated his talents to God, and,
in trading with them , gained heaven.
Born: c.1230 at
Varezze (modern Voragine), diocese of Savona, Italy (near Genoa)
Died: July 13, 1298
Beatified: 1816 by
Pope Pius VII
Prayers/Commemorations
First Vespers:
Ant. Strengthened by holy
intercession, O James, Confessor of the Lord, those here present , that we who
are burdened the weight of our offenses. Maybe relieved by the glory of thy
blessedness, and may thy guidance attain eternal rewards.
V. Pray for us, Blessed
James.
R. That we may be made
worthy of the promises of Christ
Lauds:
Ant. Well done, good and
faithful servant, because thou hast been faithful in a few things, I will set
thee over many, saith the Lord.
V. The just man shall
blossom like the lily.
R. And shall flourish
forever the Lord.
Second Vespers:
Ant. I will liken him
unto a wise man, who built his house upon a rock.
V. Pray for us, Blessed
James.
R. That we may be made
worthy of the Promises of Christ.
Prayer
Let us Pray: O God,
who didst make Blessed James, Confessor and Bishop, a glorious preacher of the
truth and a peace maker, grant us, through his intercession, that we may
love peace and truth, and come at length to Thee in whom are perfect peace and
pure truth. Through Christ our Lord. Amen.
SOURCE :
http://www.willingshepherds.org/Dominican%20Saints%20May.html#Jmaes Voragine
Saints and
Saintly Dominicans – 13 July
Blessed James
of Voragine, Bishop, Confessor, O.P.
In the early years of his
religious life, Blessed James assiduously studied the Fathers of the Church,
particularly Saint Augustine; he also published the first Italian translation
of the Holy Scriptures. At the age of thirty-seven he was elected Provincial of
Lombardy, on account of his virtue and learning; later he became Archbishop of
Genoa. In the midst of the political and religious agitations of his time he
constantly preserved great interior peace so that his soul imaged forth the
happiness of heaven. This peace he communicated to others; so much so, that the
Church styles him, “a minister of reconciliation”; one word from his lips
brought about the cessation of civil wars and inveterate feuds. There still
exist several collections of his notes for sermons, of which one hundred and
fifty are devoted to Our Blessed Lady. “Not wishing,” he writes, “to allow my
soul to slumber in indolence and cowardly torpor during the short time that
remains to me here below, I intend to close these latter days by celebrating
the praises of God and His glorious Mother, and thus prepare myself for the
eternal years?’ His Golden Legend, as he is careful to remark, contains
incidents credited in his day, but which sometimes go beyond the bounds of
probability. The work as a whole, however, is calculated to give a high idea of
Christian perfection and of the wonders of God in His saints (1298).
Prayer
Blessed Pontiff, take
away from our age its selfishness, spirit of revolt and love of pleasure; then
shall we enjoy peace.
Examen
What causes you to love
peace of heart? Is it pride, vain imaginations, curiosity, fear of human
judgments or the trials of life?
– taken from the
book Saints
and Saintly Dominicans, by Blessed Hyacinthe-Marie
Cormier, O.P.
SOURCE : https://catholicsaints.info/saints-and-saintly-dominicans-13-july/
July 13: Bl. James of
Voragine, B., C., O.P., Commemoration
Today, in the 1962
Dominican Rite Calendar, we make a commemoration of Blesssed James of Voragine,
Bishop, Confessor, of the Order of Preachers. Since today is a ferial
day, the ferial office is prayed. A commemoration is made of Bl. James of
Voragine at Lauds only. The collect prayer for this holy bishop speaks of
his love for peace and truth. In these days where there is very little
peace, whether between nations, peoples, citizens of the same country, members
of Holy Mother Church, and even within families, due so often to a lack of
knowledge of, or regard for, Truth, may this holy Dominican bishop pray for us
and our deplorable times.
Blessed James is the author of the famous "Golden Legend", a medieval manuscript of saints’ lives that was extremely popular in the Middle Ages. From “Short Lives of the Dominican Saints” (London, Kegan Paul, Trench, and Trübner & Co., Ltd., 1901):
BLESSED JAMES was born in the little village of Voragine, also
called Varazzo, not far from Genoa. He entered the Order of Saint Dominic at
the early age of fourteen, and devoted himself to the acquisition alike of
learning and of sanctity, making marvelous progress in both. After teaching
theology in various places, he was sent to preach throughout Northern Italy.
Such was his eloquence and such the purity with which he spoke his mother
tongue, that he took his place at once in the foremost rank of Italian orators.
He was the first to translate the Bible into Italian; and he wrote several
works, in particular a large and valuable book of sermons, a treatise in praise
of our Blessed Lady, to whom he bore a tender devotion, and a collection of
Lives of the Saints, known as the "Golden Legend," which became
the most popular book of spiritual reading in the Middle Ages. It was
translated into various languages, and was perhaps more widely diffused than
any other work before the invention of printing.
He became Prior of the
Convent of Genoa, and when only thirty-seven was elected Provincial of
Lombardy. His appointment to this important post, whilst still so young,
created some surprise throughout the Order, but when the Friars became
witnesses of his benevolence and charity, and of the blessings which his wise
and saintly administration drew down upon the Houses committed to his charge,
this feeling of surprise was exchanged for one of admiration and gratitude, and
he continued to hold the office for the then unprecedented period of nineteen
years. In the year 1288, Pope Honorius IV entrusted to him the delicate task of
absolving the city of Genoa, in his name, from the censures and the interdict
which it had incurred. Blessed James discharged this mission with such prudence
and tact as to win all hearts, and not long afterwards the Cathedral Chapter
unanimously elected him as Archbishop.
Genoa was at this time in
a very distracted state, torn by the rival factions of the Guelphs and
Ghibellines, the scene of horrible murders and civil war. The saintly
Archbishop succeeded in re-establishing peace and order. He showed himself to
be truly the father of his people, sparing no labor on their behalf, and
stripping himself of everything in his boundless liberality to the poor. He
also bestowed munificent benefactions on the hospitals, convents, and churches
of his diocese. The Crusaders had brought back with them, after the capture of
Constantinople in 1203, a great quantity of holy relics. A portion of those
which had fallen to the share of Venice passed into the possession of the
Genoese, together with a considerable piece of the True Cross. The pious
Archbishop succeeded in obtaining them, and deposited them in the Dominican
Church in Genoa, under two tables which he plated with silver.
All through his life,
Blessed James had made it his study to acquire interior peace, and his soul had
become, according to the testimony of his contemporaries, a perfect mirror of
the happiness of heaven. After eight years spent in governing his flock with
such wisdom and success that most of the Bishops of Northern Italy took him for
their counselor and model, and adopted his statutes for the reformation of
their clergy, the saintly Archbishop of Genoa gently fell asleep in the Lord in
the July of the year 1298. His body was laid under the high altar of the Church
of Saint Dominic in Genoa, where it received the veneration of the faithful
until A.D. 1798, when it was translated to the Church of the Friars Preachers
at Santa Maria di Castello. A fresh and very solemn translation took place in
the year 1885. Blessed James was beatified by Pius VII., A.D. 1816.
Prayer
O God, you rendered your
blessed confessor and bishop, James, a glorious herald of truth and an
effective peacemaker; grant us, at his intercession, to love both peace and
truth, and to reach you in whom peace is most perfect, and truth most pure.
Through Our Lord...
SOURCE : https://breviariumsop.blogspot.com/2018/07/july-13-bl-james-of-voragine-b-c-op.html
Ottaviano
Nelli, Jacques de Voragine avec son ouvrage La Légende dorée entre les mains.
Ottaviano Nelli, Beato
Giacomo da Varazze assiste alla crocifissione di Gesù
Cristo (prima metà del XV secolo),
affresco; Foligno, Palazzo Trinci
Ottaviano Nelli (1375–), Fresco
"Crucifixion" (showing among others the archbishop Jacobus da Varagine with his book the Golden
Legend, in his hand), Chapel of the Trinci
Palace, Foligno, Italy
Beato Giacomo (Iacopo) da
Varazze Arcivescovo di Genova
Varazze, 1226/30 -
Genova, 13 luglio 1298
Nel 1244 entrò
nell’Ordine Domenicano a Genova, portandovi un’intelligenza eletta e un cuore
di santo e d’artista. Acquistò ben presto fama di santo e di dotto, ma sua
unica ambizione fu di porgere al maggior numero di anime il pane della celeste
dottrina. Ebbe il dono di conquistare i cuori, e le antiche cronache ci
affermano che fu uno dei più famosi e fruttuosi predicatori che avesse allora
l’Italia. Fu religioso perfetto, amante della Regola, per questo, due volte, fu
chiamato a reggere la Provincia di Lombardia. I Sommi Pontefici fecero gran
conto di lui e gli affidarono delicatissimi incarichi. Inviato da Papa Nicolò
IV a Genova per riconciliare la città, colpita da Interdetto, con la Santa
Sede, si comportò con tanta soddisfazione dei genovesi, che clero e popolo,
chiesero in grazia, nel 1292 di averlo come loro Arcivescovo, dignità che egli
già un’altra volta aveva rifiutato. Costretto dall’obbedienza ad
accettare, si dimostrò specchio di pastore. Le sue predilezioni furono per i
poveri. Compose la pace fra i cittadini, che da oltre cinquant’anni si
distruggevano con guerre fratricide. Nonostante le fatiche della predicazione,
e le molteplici cure dell’episcopato, trovò tempo per scrivere moltissime
opere, tra cui la più famosa e la più popolare è la “Leggenda aurea”, dove
narra la storia dei santi, seguendo l’anno liturgico di cui illustra le
maggiori festività. Fu definito capolavoro di pietà e di sapienza. Tradotto in
tutte le lingue, per secoli ha nutrito la fede d’intere popolazioni.
Etimologia: Giacomo = che
segue Dio, dall'ebraico
Emblema: Bastone
pastorale
Martirologio Romano: A
Genova, beato Giacomo da Varazze, vescovo, dell’Ordine dei Predicatori, che per
promuovere la vita cristiana nel popolo presentò nei suoi scritti esempi
numerosi di virtù.
Il Beato Jacopo nacque a
Varazze (frazione Casanova), da un’antica famiglia genovese, in un anno
compreso tra il 1226 e il 1230, probabilmente nel 1228. Accolto giovanissimo, a
soli quattordici anni, nel convento domenicano di Genova, fu ordinato sacerdote
e, per le eccellenti doti, destinato ad insegnare teologia e Sacra Scrittura in
diverse case dell’Ordine. A soli trentasette anni fu eletto priore e, due
anni dopo, superiore provinciale della Lombardia. A quel tempo la provincia del
nord Italia era unica e comprendeva oltre quaranta conventi in cui vivevano un
migliaio di frati. Jacopo rimase eccezionalmente in carica per quasi quindici
anni e fu sollevato solo per le sue ripetute richieste. Nel 1285 tornò un
semplice frate, l’anno dopo gli fu proposto di assumere la carica di vescovo
che non accettò. Ebbe però un incarico molto delicato: Genova era colpita da
interdetto papale per il sostegno dato durante la rivolta siciliana contro il
Regno di Napoli e Jacopo dovette mediare. Fu un successo, tanto che, su
richiesta della popolazione e del clero cittadino, Papa Niccolò IV nel 1292 lo
nominò arcivescovo. Accettò per obbedienza. Dopo la consacrazione avvenuta a
Roma, il beato diede inizio ad un’intensa attività pastorale. Indisse un sinodo
nel 1293 e si occupò della quanto mai necessaria riforma del clero. Fu molto attento
ai bisogni dei suoi fedeli, fece donazioni a ospedali e monasteri, restaurò
diverse chiese. Importante fu il ruolo di mediatore tra guelfi (i Rampini) e
ghibellini (i Mascherati), nel 1295 riuscì a riconciliarli, almeno
temporaneamente, dopo oltre cinquant’anni di lotta. Ebbe una grande venerazione
per le reliquie e fece un'accurata ricognizione di quelle di San Siro. Diceva
che le sacre spoglie erano state uno straordinario tempio dello Spirito Santo.
Erano gli anni in cui la Repubblica di Genova giunse a dominare buona parte del
Tirreno. Alle antiche casate di origine feudale si aggiungevano uomini d’affari
arricchiti con i commerci in Oriente. Il beato, nei lunghi anni del suo
prezioso ministero, entrò in contatto con protagonisti di grandi avvenimenti,
ma quotidianamente si trovò a confortare, spiritualmente e materialmente,
fedeli di ogni condizione economica. Jacopo fu un uomo di studio, preparò
sempre con diligenza i sermoni, alcuni dei quali sono giunti fino a noi.
Insegnava la teologia sapendo che i precetti, per essere compresi, devono
essere accompagnati da esempi. Studiò la Bibbia, i Padri della Chiesa, gli Atti
dei martiri e i leggendari dei santi. Si può affermare che l’agiografia sia
stata la sua grande passione. Scrisse tra il 1255 e il 1266 la “Leggenda Aurea”
o “Legenda Sanctorum”, attingendo anche da fonti orali, un santorale cadenzato
sull’anno liturgico, in cui sono narrate le vite dei santi ma anche le feste
cristologiche e mariane. Per secoli fu il libro più stampato dopo la bibbia,
educò molte generazioni, fu fonte d’ispirazione di predicatori e innumerevoli
artisti, come Pomarancio e il Carpaccio. Fu scritto in latino e in seguito
tradotto in volgare. Oggi possediamo più di 1.400 preziosi manoscritti, a
testimonianza della sua grande importanza e della sua enorme diffusione. Ebbe
oltre cento edizioni nel solo primo trentennio dalla invenzione della stampa,
la prima pubblicazione fu a Basilea nel 1470. Seguirono versioni in tedesco,
francese, inglese nel 1483. Nel 1530 le versioni erano già un centinaio. Era
stata pensata per il clero, ma non è giudicabile secondo gli odierni criteri
storici. I santi, seguendo l’anno liturgico, sono presentati come modelli
familiari. Sono narrate una grande varietà di vicende, dall’epoca delle
persecuzioni romane, che si concludevano con il martirio, al medioevo. Tra i
santi di cui il beato Jacopo scrisse troviamo: Orsola, Apollonia, Alessio,
Apollinare di Ravenna, Cosma e Damiano, Donato, Eustachio, Lorenzo, Petronilla,
Nereo e Achilleo, Giorgio, Margherita, Gervasio e Protasio, gli apostoli
Bartolomeo e Giacomo il Maggiore, Giuliano l’ospedaliere, Maria Maddalena,
Martino, Romolo e Siro vescovi di Genova e l’evangelista Marco. La Leggenda fu
una delle letture preferite da Santa Caterina da Genova e fu importante per la
conversione del beato Giovanni Colombini nel Trecento e di Ignazio di Loyola
due secoli dopo. Il fondatore della Compagnia di Gesù, convalescente, la lesse,
in un momento cruciale della sua vita, insieme alla “Vita di Cristo” di Cartesiano.
Jacopo scrisse inoltre la storia di Genova, intitolata “Chronica Civitatis
Ianuensis”, dalle origini fino al 1297, una difesa dell’Ordine domenicano e una
“Summa” delle virtù del frate lionese Guglielmo Peraldo. Stando a una
tradizione non accertata avrebbe anche fatto una delle prime traduzioni in
volgare della bibbia. Jacopo morì nella notte fra il 13 e il 14 luglio 1298,
aveva regolato con atti notarili l'intera amministrazione episcopale. Fu
sepolto nel coro di S. Domenico, le sue reliquie vennero poi poste nel 1582
sotto l'altare maggiore. Nel 1798 furono trasferite in S. Maria di Castello.
Oggi parte di esse è venerata nella chiesa del convento di San Domenico a
Varazze. Il culto fu approvato nel 1816 da Pio VII. Un’antica cappella, di
epoca incerta, sorge in posizione isolata su una collina nella frazione
Casanova di Varazze, dove si ritiene sorgesse la casa natale.
La cappella del Beato Jacopo da Varagine nella frazione di Casanova a Varazze, in provincia di Savona.
La cappella
del Beato Jacopo da Varagine nella frazione
di Casanova a Varazze,
in provincia di Savona.
PREGHIERA
Oh Dio, che facesti del
Beato Jacopo da Varazze
un esimio ricercatore
della verità
e un instancabile
operatore di pace,
per sua intercessione,
concedi a noi di amare la
pace e la verità
in modo da poter giungere
a te,
nel quale vi è pace somma
e verità pura, amen.
Autore: Daniele
Bolognini
Title page of the 1497 edition of the Sermones de sanctis showing the author as a preacher, National Library of Poland
Dopo la Bibbia, la Leggenda Aurea è stato il libro più diffuso e tradotto dal Medioevo al XVII secolo. L’autore di questa importante opera letteraria, che illustra la vita dei santi, è Jacopo De Fazio, nato in Liguria intorno al 1228 in provincia di Savona, a Varazze (da cui deriva il suo appellativo da Varazze). Di origini nobili, Jacopo dimostra grande intelligenza e attitudine verso la predicazione e la scrittura. Diventa frate domenicano e, per le sue qualità, viene designato ad insegnare teologia agli altri frati del suo Ordine e messo alla guida dei domenicani in Lombardia (che comprendeva anche la Liguria) con quaranta conventi e mille frati da seguire.
Inviato dal papa a Genova per sedare la guerra fratricida tra Guelfi (sostenitori del papa) e Ghibellini (sostenitori dell’imperatore), Jacopo si dimostra eccellente pacificatore. Amato da tutti, il popolo lo acclama e chiede che il papa lo nomini arcivescovo di Genova. Jacopo ubbidisce a malincuore poiché vorrebbe dedicarsi allo studio e alla scrittura. Tuttavia, dal 1292 svolge questo delicato compito con zelo accanto ai potenti, ma non dimentica i poveri, dando aiuto economico a chiese, ospedali, conventi.
Nel frattempo riesce, comunque, a scrivere alcuni importanti libri. Uno, soprattutto, diventa famoso, diffuso e, ancora oggi, tradotto in tutto il mondo: la Leggenda dei Santi diventata Leggenda Aurea (leggenda deriva dal latino e significa “storia da leggere”, mentre aurea significa “splendente come l’oro”, proprio a motivare l’importanza dell’opera). Per poter realizzare questo prezioso volume che contiene la vita dei santi (dai martiri caduti sotto le persecuzioni dell’Impero romano fino al Medioevo) l’arcivescovo raccoglie notizie sia studiando sui libri antichi, sia ascoltando i racconti dei suoi contemporanei, tramandati di secolo in secolo. Prima dell’avvento della stampa il libro è stato ricopiato a mano e tradotto dal latino al volgare e in varie lingue. Dopo l’avvento dei caratteri mobili, sono state pubblicate centinaia di edizioni. Jacopo da Varazze lavora a quest’opera per trent’anni, dagli anni Sessanta del XIII secolo, arricchendola e modificandola fino alla sua morte, avvenuta a Genova nel 1298. La Leggenda Aurea è stata molto utilizzata anche dagli artisti per raffigurare i santi e le loro gesta. Oggi le spoglie di Jacopo da Varazze riposano a Genova, nella Chiesa di Santa Maria di Castello. Alcune reliquie si trovano a Varazze, nella chiesa del Convento di San Domenico.
Autore: Mariella Lentini
SOURCE : http://www.santiebeati.it/Detailed/62400.html
Iacopo :
da Varazze, Legenda aurea (italiano). - Stampate in Venetia : per
Bartholomeo di Zani da Portese, nel MCCCCLXXXXIX adi V di decembre. - 240
c. ; a-z⁸, &⁸, [us]⁸[rum]⁸, A-D⁸ ; fol. - Dall'analisi
dell'esemplare sembra mancare la c. c8. Errori nella cartulazione manoscritta. Biblioteca Europea di
Informazione e Cultura
IACOPO da Varazze
di Carla Casagrande
Dizionario Biografico
degli Italiani - Volume 62 (2004)
La data di nascita di I.
risale probabilmente al 1228 o al 1229. Il luogo, come testimonia il toponimico
che gli viene attribuito nelle fonti, "Iacopus de Varagine", potrebbe
essere Varazze oppure, come appare più probabile, Genova, dove è attestata la
presenza di una famiglia originaria di Varazze, denominata "de
Varagine".
La formula "de
Voragine", con cui I. è talora designato in fonti anche antiche, è da
considerarsi una variante di "da Varagine"; del tutto fantasiosa
dunque l'idea, risalente al sec. XVI e divenuta poi tradizionale, che
"Voragine" venisse da vorago, a indicare l'abisso di dottrina di
cui I. dava prova nelle sue opere.
Le fonti relative alla
biografia di I. sono soprattutto le note autobiografiche presenti nelle sue
opere, alcuni documenti relativi alla storia dell'Ordine domenicano e una serie
di atti notarili che documentano l'attività amministrativa di I. come
arcivescovo di Genova. Su questa documentazione Giovanni Monleone, nello Studio
introduttivo all'edizione della Chronica civitatis Ianuensis, ha
ricostruito una biografia di I. che, oltre ad aver fatto giustizia degli
errori, delle imprecisioni e delle immaginarie ricostruzioni delle precedenti
biografie, talora segnate da intenti agiografici, non ha, a tutt'oggi, subito
variazioni o aggiunte di rilievo restando dunque un prezioso strumento a
disposizione degli studiosi di Iacopo da Varazze.
La prima data certa della
biografia di I., se si esclude il 1239, anno di un'eclisse solare che I.
racconta di aver visto nella sua infanzia (Chronica, p. 378), è il 1244 quando,
adolescente, come egli stesso dichiara (ibid., p. 382), entrò a far parte
dell'Ordine dei frati predicatori. Dopo questa data segue un lungo periodo di
silenzio interrotto ancora una volta dal racconto autobiografico di un fatto
portentoso, e cioè l'apparizione di una cometa, avvenuta nel 1264, che I.
scrive di aver visto e ammirato per quaranta giorni (ibid., pp. 390 s.). Non
sappiamo se la sua formazione di frate predicatore si sia svolta tutta
all'interno del convento genovese, dove abbia esercitato l'officio della
predicazione e come sia proceduta la sua carriera all'interno dell'Ordine: non
esiste infatti alcuna prova di suoi soggiorni di studio a Bologna e a Parigi,
né della sua nomina a lector e poi a magister theologiae e
poi ancora a priore del convento di Genova, come sostengono alcuni biografi.
Incerta, in quanto fondata sulla sola testimonianza della Cronica di
Girolamo Albertucci de' Borselli (sec. XV), è anche la sua nomina a priore del
convento di Asti che sarebbe avvenuta nel 1266 e che potrebbe essere confermata
indirettamente dalla presenza di un capitolo dedicato a s. Secondo, patrono
della città, nella Legenda aurea. Tuttavia possiamo supporre che I. abbia
assunto responsabilità di rilievo all'interno dell'Ordine se, come si sa per
certo, nel 1267, nel capitolo generale di Bologna, fu elevato all'officio di priore
dell'importante provincia di Lombardia, che all'epoca comprendeva tutta
l'Italia settentrionale, l'Emilia e il Piceno. I. mantenne questa carica per
dieci anni, partecipando ai capitoli provinciali e generali e risiedendo
probabilmente nel convento di Milano o in quello di Bologna, fino a quando al
capitolo generale di Bordeaux del 1277 fu absolutus dall'incarico.
Dopo qualche anno, nel capitolo provinciale di Bologna del 1281, fu nuovamente
nominato priore della provincia lombarda, carica che occupò fino al 1286.
Nel giorno di Pasqua del
1283, come racconta egli stesso nell'opuscolo Historia reliquiarum que
sunt in monasterio sororum Ss. Philippi et Iacobi de Ianua, I. fece trasportare
una preziosa reliquia, la testa di una delle vergini di s. Orsola, da Colonia
al convento delle suore domenicane di Genova dei Ss. Giacomo e Filippo, cui
anni prima, durante il suo precedente priorato, aveva donato un'altra reliquia,
un dito di s. Filippo, da lui stesso staccato dalla mano del santo che si
trovava nel convento domenicano di Venezia. In quell'occasione I., dopo la
solenne processione, tenne messa e predicò al popolo.
Dal 1283 al 1285 esercitò
funzioni di reggente dell'Ordine dopo la morte di Giovanni da Vercelli e prima
dell'elezione del nuovo maestro generale Munio de Zamora. Nel 1288, quando
ormai da due anni non era più priore della Lombardia, fu candidato alla carica
di arcivescovo di Genova, ma non ottenne, come gli altri tre candidati, la
maggioranza dei voti; papa Niccolò IV sospese la nomina e conferì la reggenza
dell'arcivescovado genovese a Opizzo Fieschi, affidando a I., il 18 maggio
dello stesso anno, il compito di assolvere in una cerimonia pubblica, che si
tenne nella chiesa di S. Domenico, i cittadini genovesi scomunicati per aver
avuto rapporti commerciali con i Siciliani, a loro volta scomunicati a causa
della guerra del Vespro. Nello stesso anno fu nominato diffinitor nel
capitolo generale di Lucca.
Nel 1290, in occasione
del capitolo generale di Ferrara, I., insieme con altri tre autorevoli frati,
ricevette una lettera dei cardinali romani nella quale veniva sollecitato a far
sì che il maestro generale Munio de Zamora, che per il suo rigore aveva
suscitato molta avversione all'interno dell'Ordine e della Curia romana, si
dimettesse. Le pressioni dei cardinali presso i frati riuniti nel capitolo non
ebbero alcun successo: non solo il maestro generale non si dimise ma venne
sostenuto da una pubblica dichiarazione, firmata anche da I., che ne esaltava
le virtù e ne approvava la politica. Secondo Albertucci de' Borselli e, dopo di
lui, secondo molti altri biografi, fu a causa dell'appoggio dato alla linea
rigorista di Munio de Zamora che I. avrebbe subito in quell'anno un tentativo
di omicidio da parte di confratelli che volevano gettarlo nel pozzo del
convento di Ferrara. Tentativo che, racconta ancora Albertucci de' Borselli, si
sarebbe ripetuto l'anno successivo, il 1291, a Milano, questa volta perché I.
aveva escluso dal capitolo provinciale frate Stefanardo, priore del convento
milanese.
Nel 1292 fu nominato da
papa Niccolò IV arcivescovo di Genova e, morto il pontefice il 4 aprile,
consacrato a Roma il 13 aprile dal cardinale Latino Malabranca, uno dei
firmatari della lettera nella quale I. veniva sollecitato a operare contro il
generale Munio de Zamora. Al governo della diocesi genovese I. dedicò gli
ultimi anni della sua vita: la sua azione fu rivolta dapprima alla
riorganizzazione legislativa del clero sotto l'autorità arcivescovile. A questo
scopo convocò un concilio provinciale, che si tenne nella cattedrale di S.
Lorenzo nel giugno del 1293, al quale parteciparono tutte le autorità
ecclesiastiche. Durante questo concilio fu compiuta, alla presenza dei
governanti e dei notabili della città e poi di tutto il popolo, una
ricognizione delle ossa di s. Siro, patrono di Genova, durante la quale
l'autenticità della reliquia fu solennemente e pubblicamente riconosciuta (Chronica,
pp. 405-408).
Intensa fu l'attività di
I. sul piano politico: nei primi mesi del 1295 promosse la pacificazione tra le
due fazioni della città, i mascherati (ghibellini) e i rampini (guelfi), e
celebrò la pace finalmente raggiunta in un'assemblea pubblica nella quale
predicò e intonò, insieme coi suoi ministri, lode a Dio; seguì quindi una
solenne processione per le vie della città guidata dallo stesso I. a cavallo
che si concluse con il conferimento del cingolo di miles al podestà
di Genova, il milanese Iacopo da Carcano (ibid., pp. 411 s.). Nello stesso
anno, in aprile, insieme con gli ambasciatori inviati dal Comune, compì un
viaggio a Roma, convocato da papa Bonifacio VIII che cercava di prolungare
l'armistizio tra Genova e Venezia.
I. descrive
dettagliatamente (ibid., pp. 102-109) questo episodio: ascrive alla necessità
di mantenere la concordia tra i cristiani e di favorire la riconquista della
Terrasanta l'interessamento del papa negli affari delle due città; ricorda il
lungo soggiorno di cento giorni presso la Curia romana, mostrando un certo
fastidio per l'indecisione del papa e, soprattutto, per le manovre dilatorie degli
ambasciatori veneti; riferisce della determinazione dei Genovesi che, dopo una
lunga attesa, decisero di andare allo scontro con Venezia allestendo, tra
l'entusiasmo popolare, una flotta che avrebbe dovuto affrontare i nemici in una
battaglia decisiva presso Messina; conclude ricordando che i Veneziani non si
presentarono all'appuntamento costringendo il comandante Oberto Doria a
ritornare a Genova senza aver combattuto, accolto però dalla città e dal
vescovo "cum immenso gaudio et triumpho" (ibid., p. 108).
Alla fine del 1295 I.
subì una sconfitta politica e una profonda delusione personale che lo portò a
scrivere le amare parole "cithara nostra cito versa est in luctum et
organum nostrum in voce flentium est mutatum": si ruppe infatti la pace
tra le fazioni cittadine, da lui voluta e da lui solennemente celebrata pochi
mesi prima; scoppiarono incidenti violenti durante i quali fu incendiata la
cattedrale di S. Lorenzo (ibid., pp. 412 s.). I danni furono così gravi che I.
chiese al papa un risarcimento che gli fu concesso il 12 giugno 1296.
Della sua attività
amministrativa, variamente documentata, vale la pena di ricordare la vendita,
avvenuta nel 1297, delle signorie di Ceriana e Sanremo a Oberto Doria e Giorgio
De Mari, che appartenevano entrambi a famiglie ghibelline, e alcuni atti
notarili, nei quali l'arcivescovo, poco prima di morire, dettò le sue ultime
volontà rispetto alla gestione dell'arcidiocesi e confermò il precedente testamento.
I. morì nella notte tra
il 13 e il 14 luglio 1298. Il suo corpo, prima sepolto nella chiesa di S.
Domenico del convento dei frati predicatori di Genova, fu trasferito, alla fine
del secolo XVIII, in un'altra chiesa domenicana, S. Maria di Castello, dove
tuttora si trova. In virtù della venerazione e del culto di cui fu fatto
oggetto per secoli, I. fu beatificato nel 1816 da papa Pio VII.
Importante per il ruolo
all'interno dell'Ordine e per la sua azione come arcivescovo di Genova, I. è
noto soprattutto per le sue opere, che ebbero grande diffusione ai suoi tempi e
molta fortuna anche nei secoli successivi. Lo stesso I., nell'ultimo capitolo
della Chronica, ne dà un elenco seguendo molto probabilmente l'ordine
cronologico di composizione: le Legende sanctorum (Legenda aurea),
tre raccolte di modelli di sermoni, i Sermones de omnibus sanctis, i Sermones
de omnibus Evangeliis dominicalibus, i Sermones de omnibus Evangeliis que
in singulis feriis in Quadragesima leguntur, quindi il Liber Marialis e
la Chronica civitatis Ianuensis. Sono esclusi da questo elenco alcuni
opuscoli di carattere agiografico ritenuti dalla critica opera di I.: la Legenda
seu Vita sancti Syri episcopi Ianuensis, la Historia translationis
reliquiarum sancti Iohannis Baptistae Ianuam, la Historia reliquiarum que
sunt in monasterio sororum Ss. Philippi et Iacobi de Ianua, il Tractatus
miraculorum reliquiarum sancti Florentii unito alla Historia
translationis reliquiarum eiusdem, la Passio sancti Cassiani.
In alcuni manoscritti dei
secoli XIV-XV viene attribuito a I. un Tractatus de libris a beato
Augustino editis, che secondo G.P. Maggioni, corrisponde alle inserzioni
dell'ultima redazione della Legenda aurea presenti nel capitolo De
sancto Augustino; il testo è stato studiato ed edito da J.A. McCormick (Iacobus
de Voragine, Tractatus de libris a beato Augustino ep. editis, edited from
manuscripts and unique printing, in Dissertation Abstracts, XXV [1965], p.
4132), che ne sostiene l'autenticità (per l'elenco dei manoscritti v. Kaeppeli,
II, n. 2165 p. 369).
La prima, e la più
famosa, delle opere di I. è nota come Legenda aurea, titolo vulgato che si
è consolidato nel tempo ma che non compare nei manoscritti più antichi che
riportano invece il titolo Legende sanctorum, lo stesso con cui I. designa
l'opera nel passo della Chronica ricordato più sopra. Anche gli altri
titoli con cui l'opera viene talora ricordata, Liber passionalis, Vitae o Flores o Speculumsanctorum, Historia
Lombardica o Longobardica (dal penultimo capitolo, dedicato a
papa Pelagio, in cui si narrano i principali eventi accaduti dall'arrivo dei
Longobardi in Italia fino al 1245) non appartengono alla tradizione più antica
del testo. L'opera si compone di racconti dedicati alle vite dei santi e alle
feste liturgiche (178 secondo l'ed. Maggioni, 182 secondo l'ed. Graesse)
disposti, e questo costituisce un'innovazione rispetto a opere dello stesso
genere, secondo l'ordine del calendario liturgico. Un breve prologo, cui segue
l'indice, dà conto della struttura del testo in cinque parti, che rimandano
alle cinque fasi del calendario liturgico, a loro volta corrispondenti alle
cinque fasi della storia della salvezza: l'Avvento (tempus renovationis), il
periodo che comprende Natale ed Epifania e arriva fino a settuagesima (tempus
reconciliationis et peregrinationis), il periodo che va da settuagesima alla
Passione del Cristo (tempus deviationis), quello che comincia con la Pasqua e
finisce con Pentecoste (tempusreconciliationis) e infine quello che va da
Pentecoste all'Avvento (tempus peregrinationis). I santi, la cui vita è oggetto
di narrazione, appartengono nella maggioranza dei casi ai primi secoli del
cristianesimo, ma non mancano santi più tardi: due del secolo XII, Bernardo di
Chiaravalle e Tommaso Becket, quattro del XIII, Domenico, Francesco, Pietro
martire, Elisabetta di Ungheria. L'opera appartiene al genere delle legendae
novae, compilazioni del XIII-XIV secolo in cui il materiale agiografico, che si
era accumulato fin dai primi secoli dell'Era cristiana, veniva raccolto in forma
condensata attraverso un lavoro di scelta e abbreviazione che privilegiava gli
aspetti essenziali e universali delle vite dei santi tralasciando quelli più
particolari e legati a culti locali. Queste compilazioni, che furono per lo più
opera di esponenti dell'Ordine dei frati predicatori, avevano innanzitutto lo
scopo di mettere a disposizione di quanti erano impegnati nell'azione pastorale
un materiale agiografico altrimenti troppo abbondante e disperso, e in seguito
anche di offrire alla lettura testi nello stesso tempo piacevoli ed edificanti.
Tali furono anche le intenzioni con cui fu compilata la più famosa delle legendae
novae, la Legenda aurea, scritta da I. a partire dal 1260 e
successivamente rielaborata, quando già ne circolavano le prime versioni, fino
a poco prima della morte, come ha dimostrato Giovanni Paolo Maggioni. Se in un
primo momento prevalse la volontà da parte di I. di confezionare uno strumento
utile alla predicazione, le successive rielaborazioni, con l'inserzione di
alcuni racconti in cui rispetto all'intento edificatorio prevale il gusto del
meraviglioso e del sensazionale, mostrano uno I. attento alle esigenze di un
pubblico di lettori certo devoti ma anche colti e interessati. Le fonti di cui
I. si serve per la compilazione del testo sono molteplici: la Sacra
Scrittura, i testi dei Padri e dei più autorevoli esponenti della tradizione
monastica e canonicale, le fonti agiografiche (a questo riguardo I. fa largo
uso, attraverso citazioni letterali o epitomi, delle precedenti legendae
novae compilate all'interno dell'Ordine domenicano, l'Abbreviatioin gestis
sanctorum di Giovanni da Mailly e il Liber epilogorum in gesta
sanctorum di Bartolomeo da Trento), fonti storiche, tra cui l'Historiascholastica di
Pietro Comestore, lo Speculum historiale di Vincenzo di Beauvais,
la Chronica di Martino Polono, testi per predicatori composti da
confratelli dell'Ordine, come il Tractatus de diversis materiis
praedicabilibus di Stefano di Borbone, testi teologici e filosofici, come
le Sententiae di Pietro Lombardo e il commento di Averroè al Liber
de anima di Aristotele, fonti liturgiche e giuridiche, come, ancora per
fare qualche esempio, il Corpus antiphonalium da un lato e la Collectio
canonum dall'altro, qualche raro autore profano, come Cicerone e Macrobio.
Molto probabilmente anche nella Legenda, come è stato dimostrato da
Bataillon a proposito dei sermonari, per i quali I. ha certamente utilizzato
la Catena aurea di Tommaso d'Aquino, le citazioni in molti casi
provengono non dalla fonte diretta ma da florilegia di auctores,
spesso appositamente compilati a uso dei predicatori.
La Legenda ebbe
un successo rapido (già nel 1275 si sa per certo che a Parigi veniva trasmessa
per pecia), duraturo ed esteso a tutta l'Europa come nessun altro testo in
epoca medievale, a parte la Bibbia; lo testimoniano il numero di
manoscritti rimasti, più di 1200 (per l'elenco cfr. Fleith, 1991), e le
numerose edizioni che si successero a partire dall'editio princeps di
Colonia 1470. A causa di questa straordinaria diffusione il testo della Legenda fu
in continua trasformazione. Già lo stesso I., come abbiamo prima segnalato, ne
aveva dato successive redazioni; a queste si aggiunsero le rielaborazioni
(abbreviazioni, inversione, eliminazione o aggiunta di capitoli) a opera dei
vari utenti dell'opera che intervennero sul testo adattandolo alle pratiche
cultuali locali e all'uso che ne veniva fatto nell'ambito della predicazione e
della devozione. L'edizione a cura di Theodor Graesse (Dresden 1846; rist.
anast. Dresden-Leipzig 1890 e Osnabrück 1969), basata su una delle prime
edizioni a stampa, quella di Dresda 1472, dà conto del testo vulgato
della Legenda che si è venuto costituendo nei due secoli della sua
massima diffusione; la più recente edizione curata da Giovanni Paolo Maggioni
(Firenze 1998, cui è seguita, nell'anno successivo, una seconda edizione
rivista dal curatore con allegato un Cd-rom del testo della Legenda, a
cura di L.G.G. Ricci) presenta l'ultima redazione d'autore dell'opera ed è
fondata su cinque manoscritti identificati, all'interno del corpus dei
70 manoscritti più antichi, come testimoni dell'ultima redazione compiuta da I.
sul testo.
Molti furono i
volgarizzamenti dell'opera in tutte le lingue europee (cfr. Lexikon des
Mittelalters, V, coll. 1796-1801). La più antica, già alla fine del secolo
XIII, come sembra, è una versione catalana (Vides de sants rosselloneses, a
cura di C.S. Maneikis - E.J. Neugaard, Barcelona 1977), le altre si collocano
invece tra la metà del XIV e il XV secolo: si conoscono tre versioni in
lingua d'oc (una di queste è edita: Die altokzitanische Version
B der "Legenda Aurea", Ms. Paris, Bibl. nat. Nouv. acq. fr. 6504, a
cura di M. Tausend, Tübingen 1995), undici traduzioni francesi, tra cui la più
importante è quella di Jean de Vignay che risale agli anni 1333-48 (La Légende
dorée [Lyon, 1476]. édition critique de la Légende dorée dans la révision de
1476 par Jean Batailier, d'après la traduction de Jean de Vignay [1333-1348] de
la Legenda aurea [c. 1261-1266], a cura di B. Dunn-Lardeau, Paris 1997), alcune
versioni inglesi, tra le quali quella di William Caxton nella seconda metà del
XV secolo, almeno una dozzina di versioni nelle lingue dell'area germanica, tra
le quali, particolarmente diffusa, quella alsaziana redatta verso il 1350 (Die
elsässische "Legenda aurea", I, Das Normalcorpus, a cura di
U. Williams - W. Williams-Krapp, Tübingen 1980; II, Die Sondergut, a cura
di K. Kunze, ibid. 1983), oltre a versioni in olandese, danese, svedese,
islandese, ceco, polacco. Non sono molti né molto precoci i volgarizzamenti
italiani: il primo è un volgarizzamento toscano della fine del Trecento (edito
a cura di A. Levasti, Firenze 1924-26). Nei volgarizzamenti, così come accadeva
nella tradizione latina, il testo della Legenda aurea subì continue
trasformazioni, abbreviazioni, inversioni dell'indice, inserimenti di nuovi
capitoli, attraverso i quali l'opera veniva adattata ai diversi contesti
sociali e geografici in cui venne a trovarsi e ai diversi usi che ne furono
fatti. Prevale, tra i volgarizzamenti, l'uso dell'opera come testo di lettura,
una lettura che talora privilegia il piacere del racconto, come avviene
soprattutto tra i laici, e talora invece insiste sugli aspetti devozionali ed
edificanti del testo, come avviene soprattutto nelle comunità religiose
femminili, dove l'opera è particolarmente diffusa.
Va infine segnalata
l'importanza che la Legenda assunse in ambito artistico, costituendo
un inesauribile repertorio di temi cui attingere nella rappresentazione delle
vite dei santi e favorendo un rinnovamento dell'iconografia agiografica con una
rappresentazione della santità nella quale tendono a prevalere elementi
narrativi, come le scene dei miracoli e dei martirî. Inoltre sono numerosi i
manoscritti e le edizioni del testo latino e, soprattutto, dei volgarizzamenti
che presentano miniature, particolarmente preziose quando l'opera si rivolge ad
ambienti nobiliari o altoborghesi, dove vengono rappresentate le figure dei
santi o gli episodi salienti delle loro vite.
Il successo della Legenda non
termina con il Medioevo. Certo il giudizio negativo di umanisti e riformati
contribuì al suo declino come testo religioso sia nella predicazione sia nella
devozione privata. Resta però il piacere della lettura che questo testo
continua a dare e che ne garantisce la tradizione anche contemporanea in opere
teatrali, musicali, figurative e in traduzioni in tutte le principali lingue
moderne. Ricordiamo per l'Italia la traduzione integrale, condotta sul testo
dell'edizione Graesse, di Alessandro e Lucetta Vitale Brovarone (Torino 1995).
I. scrisse tre sermonari,
i Sermones de sanctis et festis, i Sermones de tempore, i Sermones
quadragesimales, il cui scopo è di mettere a disposizione dei predicatori
modelli di sermoni da utilizzare nelle varie occasioni. Ogni sermone è
sviluppato secondo la tecnica del sermomodernus: da un thema iniziale,
sempre costituito da un passo scritturale, prende corpo una divisione che
individua le parti del sermone, che sono in genere tre, ma il numero può
variare a seconda dei casi da due a otto; ogni parte è poi soggetta a
specifiche e più o meno estese divisioni, all'interno delle quali trovano posto
passi scritturali, citazioni di auctoritates, metafore, etimologie,
inserti dottrinali, agiografici, liturgici. Se la tecnica è la stessa in tutti
i sermonari, tuttavia nel De sanctis i modelli appaiono più
schematici, mentre nel De tempore e poi, in modo ancora più
accentuato, nel Quadragesimales gli schemi si fanno più articolati e
più ricchi di contenuti. I modelli di sermoni di I. sono caratterizzati, oltre
che da una certa schematicità, come si è detto, da moltissime citazioni
scritturali, dall'assenza del prothema, dall'uso parco di auctores profani,
dalla scarsa ed episodica presenza di exempla, dal ricorso costante al
linguaggio figurato, dall'uso continuo e pervasivo della distinctio, cui
spesso è affidata la divisio del sermone e le divisioni interne delle
singole parti. Le fonti, spesso citate indirettamente grazie ad appositi florilegia,
sono quelle già utilizzate nella compilazione della Legenda aurea: la
letteratura patristica e monastica, i testi per la predicazione elaborati in
ambito domenicano, qualche opera di carattere storico e qualche autore profano.
Sulla data di composizione non ci sono certezze. Possiamo a ragione ritenere
che l'ordine di composizione dei tre sermonari sia l'ordine con cui I. li
elenca nella Chronica, e cioè prima De sanctis, poi De tempore e
infine i Sermones quadragesimales; e poiché il primo sermonario, il De
sanctis, è stato composto dopo la stesura della Legenda aurea, come si
legge nel prologo presente in alcuni manoscritti, e l'ultimo, il Quadragesimales,
potrebbe essere stato portato a termine nel 1286, come appare nel colophon dei
manoscritti di area inglese ("expliciunt sermones fratris Ianuensis
ordinis praedicatorum compilati anno Domini MCCLXXXVI"), si può supporre
che nell'insieme le tre raccolte siano state scritte dopo il 1267, cioè dopo la
prima redazione della Legenda, o forse dopo il 1277, cioè dopo la fine del
primo provincialato, come molti biografi sono portati a credere, e non oltre il
1286. Le tre raccolte conobbero un larghissimo successo, come testimonia il
grande numero di manoscritti rimasti; se si sommano le copie dei manoscritti
dei tre sermonari, I. è senza dubbio il predicatore medievale di cui ci sono
rimaste più testimonianze (più di 1120 manoscritti). Anche per questo, oltre
che per la rilevanza culturale del loro autore, i sermonari di I. sono stati
scelti da un gruppo di ricercatori europei, coordinati da Nicole Bériou, come
oggetto del primo Thesaurus sermonum su base elettronica. Grazie
all'immissione su Cd-rom del testo dei sermoni di I. e a un opportuno
trattamento di classificazione analitica, viene messo a disposizione degli
studiosi uno strumento che consente di interrogare questi testi da vari punti
di vista. Il Thesaurus sermonum Iacobi de Voragine è utilizzabile in
rete all'indirizzo: www.sermones.net.
I Sermones de
omnibus sanctis et festis comprendono 305 modelli di sermoni dedicati ai
santi e alle feste liturgiche. A ogni santo o festa sono dedicati da due a nove
modelli di sermoni. Nella Chronica I. dichiara di aver scritto due
volumi di questi sermoni, uno "multum diffusum", che è quello che ci
pervenuto, l'altro "magis breve et angustum", di cui non si ha
notizia. La raccolta dipende in larga misura dalla Legenda aurea, da cui
riprende molti brani in forma compendiata e moralizzata oltre alla serie dei
santi e delle feste, che sono elencati secondo l'ordine del calendario
ecclesiastico già adottato nella Legenda, se pure in numero ridotto: dei
178 capitoli della Legenda, più di cento non vengono ripresi nei Sermones,
per lo più quelli dedicati a santi minori dei primi secoli, martiri e monaci.
La composizione di questa raccolta è dovuta, come dichiara lo stesso I. nel
prologo, alle richieste dei confratelli in seguito alla compilazione
della Legenda aurea: il testo appare dunque come una sorta di
dimostrazione, compiuta dallo stesso autore, dei modi in cui il materiale
agiografico raccolto nella Legenda poteva essere utilizzato nella
predicazione. Il successo della raccolta è testimoniato da più di 300
manoscritti e dalle edizioni che si susseguono ininterrottamente dal XV al XIX
secolo a partire dall'editioprinceps di Colonia 1478 (per l'elenco dei
manoscritti, cfr. Schneyer, pp. 266-268; Kaeppeli, II, n. 2155 pp. 359-361; IV,
p. 141).
La seconda raccolta,
conosciuta sotto vari titoli (Sermones de omnibus Evangeliis domenicalibus,
secondo l'indicazione dello stesso I., oppure Sermones de tempore per
annum, Sermones dominicales, Sermones festivales), comprende 160
modelli di sermoni, tre per ogni Vangelo della domenica. Anche quest'opera è
stata scritta, come dichiara I. nel prologo, su sollecitazione dei confratelli
("importuna fratrum instantia") e dedicata alla Trinità, alla Vergine
Maria e a s. Domenico, alla cui intercessione ci si raccomanda per il buon
esito dell'opera. Anche per questa raccolta si contano moltissimi manoscritti,
più di 350, e numerose edizioni che seguono la princeps di Colonia
1467-69 (vedi Schneyer, pp. 233-235; Kaeppeli, II, n. 2156 pp. 361-364; IV, p.
141). A conferma della secolare fortuna della raccolta segnaliamo una
traduzione italiana edita a Milano presso Fabbiani nel 1913-14 con il
titolo Sermoni domenicali.
I Sermones
quadragesimales comprendono modelli di sermoni predicabili nel periodo
quaresimale per un totale di 96 sermoni (due per ogni feria). Di questa
raccolta sarà presto disponibile l'edizione per cura di G.P. Maggioni (in corso
di stampa), nata all'interno del gruppo impegnato nella costruzione del Thesaurus
sermonum Iacobi con lo scopo di mettere a disposizione dei ricercatori un
testo più affidabile rispetto a quello dell'edizione seicentesca curata da
Rodolph Clutius (Magonza 1616) su cui il gruppo ha inizialmente cominciato a
lavorare. L'edizione Maggioni è basata su sei testimoni delle principali aree
di diffusione del testo (area italiana, germanica e britannica): Firenze,
Biblioteca Medicea Laurenziana, Acq. e doni 344; Graz,
Universitätsbibliothek, 1472; Londra, Lambeth Palace Library, 23; Monaco,
Bayerische Staatsbibliothek, Clm, 18850; Todi, Biblioteca comunale, Mss.,
142; Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.th., f. 54. I manoscritti
appartengono tutti al secolo XIII tranne il testimone inglese, risalente agli
ultimi decenni del secolo XIV, il più antico della famiglia insulare, l'unica
caratterizzata dalla datazione 1286, presente negli explicit. L'edizione,
presentata dal curatore "come una sorta di prolegomena, come uno
studio preliminare che, per aver identificato alcune dinamiche della tradizione
e alcune particolarità della trasmissione del testo, può servire come base per
ulteriori approfondimenti che possono portare a loro volta ad una ricostruzione
testuale più sicura", costituisce tuttavia un notevole avanzamento
rispetto alle precedenti edizioni e consente di giungere ad alcune conclusioni:
la conferma che I. si sia servito di florilegia per la citazione
delle auctoritates, l'ipotesi, altamente probabile, che il testo sia
frutto di un'unica redazione, la certezza che i due sermoni finali presenti in
molte edizioni, il Sermo de Passione Domini e il Sermo in
planctu beatae Virginis Mariae, non appartengono alla raccolta originale.
Questo dovrebbe finalmente risolvere in senso negativo la questione della loro
autenticità. Come le altre raccolte, anche i Sermones quadragesimales ebbero
uno straordinario successo, testimoniato da più di 300 manoscritti e numerose
edizioni dal XV fino al XIX secolo, seguite alla princeps di Brescia
1483. Per l'elenco dei manoscritti vedi l'Appendice all'ed. Maggioni che
riprende e integra gli elenchi di Schneyer (pp. 244-246) e Kaeppeli (II, n.
2157 pp. 364-367; IV, p. 141).
Ai tre sermonari fin qui
analizzati viene tradizionalmente affiancato il Liber Marialis, per molto
tempo considerato anch'esso una raccolta di sermoni, come testimonia, per
esempio, il titolo Sermones aurei de Maria Virgine Dei Matre, con cui
compare nell'edizione Venezia 1590, e la recente inclusione nel Repertorium dei
sermoni dello Schneyer. In realtà, il Liber Marialis, pur essendo
anch'esso un testo composto a uso dei predicatori, non è una raccolta di
sermoni (I., nel prologo, lo definisce un opuscolo che raccoglie le lodi in
onore della Vergine), ma una raccolta in ordine alfabetico di caratteristiche,
funzioni, immagini, virtù tradizionalmente attribuite alla Vergine. I termini
elencati sono 160, da Abstinentia a Vulnerata, passando
per Ancilla, Aurora, Conceptio, Domus, Fons, Gaudium, Humilitas, Luna, Mater, Palma, Regina, Salutatio, Stella, Templum,
tanto per fare qualche esempio; ognuno di essi costituisce il punto di partenza
di una schematica trattazione che assomiglia nella struttura e nei contenuti a
quella dei sermoni, costruita a partire da una distinzione in più punti, nei
quali trovano posto passi scritturali, citazioni da auctores, altre
distinzioni, metafore. La data di composizione dell'opera deve essere collocata
tra il 1292, anno in cui I. viene nominato arcivescovo, e il 1298, anno della
morte. Lo stesso I., nel prologo, dichiara infatti di aver composto l'opera in
età senile, quando era "in episcopali speculo constitutus" e quando,
ormai prossimo alla morte, sentiva il bisogno di affidarsi alla tutela della
Vergine. Se pure in misura minore rispetto alle altre opere, anche il Liber
Marialis conobbe una certa fortuna nel Medioevo e nei secoli successivi.
Si contano una settantina di manoscritti e, a partire da quella di Amburgo
1491, molte altre edizioni dal XV al XIX secolo (vedi Schneyer, p. 283;
Kaeppeli, II, n. 2158 pp. 367 s.). È segnalata anche una traduzione in lingua
fiamminga del secolo XV (Axters, pp. 163-165). Attualmente sta lavorando alla
traduzione in lingua italiana padre Valerio Ferrua.
La Chronica
civitatis Ianuensis ab origine urbis usque ad annum 1297 è l'ultima opera
di I., scritta tra il 1295, o tra l'inizio del 1296, come ritiene Stefania
Bertini Guidetti, e il 1298, anno della morte, cioè durante gli ultimi anni del
suo mandato arcivescovile a Genova. Il testo si divide in dodici parti: le
prime cinque trattano della fondazione della città, delle prime fasi della sua
storia, delle origini del nome, della conversione al cristianesimo e del suo
progressivo sviluppo fino all'anno 1294; seguono quattro parti che
costituiscono una sorta di trattato politico sulla natura e sulla tipologia del
governo secolare e sui modelli del rector e del civis cristiano;
concludono l'opera tre parti dedicate, la prima alla trasformazione di Genova
da sede vescovile a sede arcivescovile, le altre due alla rassegna in ordine
temporale dei vescovi e degli arcivescovi e dei principali avvenimenti accaduti
a Genova e nel mondo durante il loro mandato. La narrazione si conclude con
l'autopresentazione di I. come arcivescovo di Genova, una sorta di piccola
autobiografia, con tanto di elenco delle proprie opere, cui abbiamo fatto più
volte riferimento, e con il racconto fino al 1297 degli eventi relativi agli
anni del suo mandato in città. Come si vede, si tratta dunque di un testo in
cui si alternano registri discorsivi propri di generi letterari diversi:
l'encomio delle laudescivitatum, la narrazione delle cronache universali,
il resoconto degli avvenimenti secondo i moduli della storia annalistica, il
discorso dottrinale e normativo degli specula. Questa molteplicità di
generi risponde ai diversi obiettivi cui l'opera tende. È evidente innanzitutto
l'intento immediatamente politico di sottolineare l'importanza del potere
vescovile nelle dinamiche cittadine: I. enfatizza a più riprese il ruolo del
vescovo nella storia genovese scandendo gli avvenimenti cittadini secondo la
successione dei vescovi e degli arcivescovi e legando la nascita e lo sviluppo
della città alla figura dei suoi vescovi. Lo stretto legame tra storia
cittadina e azione vescovile è parte di una più complessiva concezione della
storia, di matrice agostiniana, nella quale gli eventi umani acquistano un
senso solo se rientrano nei piani di Dio, divenendo tappe di un progressivo
avvicinamento alla salvezza eterna; concezione che porta I. a mettere in
evidenza l'intervento nella storia di Dio, dei suoi angeli e dei suoi ministri,
a considerare alcuni fatti come conferme o prefigurazioni dei piani divini, a
leggere gli eventi in senso morale come insegnamenti di Dio agli uomini. Questa
concezione della storia è solidale e conseguente all'intento generale
dell'opera, scritta, come dice esplicitamente I. nel prologo, "ad
instructionem et hedificationem". Per conseguire questo scopo, I. non si
limita ad alternare il racconto degli eventi con considerazioni di carattere dottrinale
e morale, ma dedica la parte centrale del testo all'esposizione di un vero e
proprio speculum civitatis in cui, all'interno di un discorso che non
si rivolge più solo ai Genovesi ma che acquista valore universale, si
analizzano e si valutano le diverse forme del governo secolare, si mostrano le
qualità del buon rector e dei suoi consiliarii, si indicano i
doveri del buon cittadino nei suoi rapporti con i governanti, la moglie, i
figli e i servi. L'intento didattico ed edificatorio dell'opera, evidente nella
parte centrale ma presente anche nelle parti narrative, la rende molto vicina
ai testi per la predicazione: non a caso I. vi inserisce lunghi brani che
vengono sia dalla Legenda aurea sia dai sermonari, e inoltre il testo
è stato utilizzato come supporto per la predicazione, come dimostra la presenza
nella tradizione manoscritta di indici tematici alfabetici, tipico strumento di
consultazione per predicatori. Anche le fonti della Chronica sono in
larga parte comuni con le opere per la predicazione: accanto a fonti storiche
specifiche, come gli Annali di Caffaro, relativi alla storia di
Genova, ritroviamo infatti quell'insieme variegato di auctores già
utilizzato per la compilazione della Legenda e dei sermonari. Da
segnalare anche l'utilizzo del De regno di Tommaso d'Aquino, in
particolare riguardo all'analisi delle diverse forme di governo, ferma restando
la distanza tra la concezione politica di I. da quella del teologo domenicano.
La Chronica ebbe, se pure in misura minore rispetto alle altre opere
di I., una certa fortuna nel Medioevo e nei secoli successivi: si contano 44
manoscritti (vedi Monleone, I, pp. 351-509 con l'integrazione di Kaeppeli, II,
p. 368) e un'edizione parziale in L.A. Muratori, Rer. Ital. Script., IX,
Mediolani 1726, coll. 1-56. Va segnalato che la parte finale del testo, quella
relativa alle biografie dei vescovi e degli arcivescovi genovesi, circolò
autonomamente e venne erroneamente considerata un'opera autonoma di Iacopo. Nel
1941 Giovanni Monleone diede un'edizione critica della Chronica nell'ambito
delle Fonti per la storia d'Italia [Medioevo], Roma 1941, premettendo
al testo uno Studio introduttivo sulla vita di I. e le sue opere.
L'edizione Monleone, oltre a mettere a disposizione una versione criticamente
affidabile della Chronica, ha il merito di aver ribadito il carattere del
tutto peculiare dell'opera di I. all'interno del genere cronachistico
sottraendola ai duri giudizi sul suo valore di opera storica che l'hanno
accompagnata nei secoli, da Coluccio Salutati a Ludovico Antonio Muratori,
tanto per citare i due nomi più conosciuti. Recentemente (Genova 1995) Stefania
Bertini Guidetti ha fornito una traduzione integrale della Chronica in
lingua italiana, preceduta da un riesame critico dell'opera in rapporto con la
storia di Genova e l'azione pastorale e politica dei frati predicatori.
I. scrisse inoltre cinque
opuscoli di carattere agiografico che sono tradizionalmente ritenuti autentici.
Alcuni di essi sono ricordati dallo stesso I. in vari passaggi della Chronica,
altri gli vengono attribuiti nei manoscritti e risultano per lo stile molto
vicini alla Legenda aurea. Tre riguardano santi e reliquie legati alla
storia di Genova.
La Legenda seu Vita
sancti Syri episcopi Ianuensis fu scritta nel 1293, nell'occasione,
ricordata sopra, della ricognizione delle reliquie del santo promossa dallo
stesso Iacopo. L'opuscolo, che viene presentato nella Chronica (pp.
248 s.) come un'integrazione a un'antica leggenda, corrisponde al capitolo
dedicato a s. Siro che I. inserì nella Legenda aurea in una delle sue
ultime revisioni editoriali (Maggioni, Ricerche, p. 15). Il testo è stato
pubblicato nel 1874 da Vincenzo Promis come opera autonoma in Leggenda e
inni di s. Siro vescovo di Genova, in Atti della Società ligure di storia
patria, X (1874), pp. 357-383.
L'Historiatranslationis
reliquiarum sancti Iohannis Baptistae Ianuam racconta in forma di solenne
discorso ai Genovesi le vicende delle reliquie del Battista dalla morte alla
sepoltura a Mira fino all'arrivo a Genova nel 1099. L'autenticità dell'opera è
garantita dallo stesso I., che, raccontando nella Chronica la storia
delle reliquie, afferma di aver scritto a questo proposito "historiam et
ymnos" (p. 304). La composizione è molto probabilmente contemporanea a
quella della Chronica, quindi tra il 1296 e il 1298. Se degli inni non è
rimasta traccia, l'Historia è pubblicata a cura di A. Vigna e L.T.
Belgrano in Due opuscoli di J. da Varagine, in Atti della Società
ligure di storia patria, X (1874), pp. 480-491.
L'Historia reliquiarum
que sunt in monasterio Ss. Philippi et Iacobi de Ianua descrive in undici
brevi capitoli la storia e le virtù delle reliquie conservate nel convento
domenicano femminile di Genova. Lo stesso I., come si racconta nel testo e come
è stato ricordato sopra, aveva contribuito ad assegnare al convento genovese
alcune di queste preziose reliquie. L'opera è stata probabilmente composta tra
il 1286 e il 1292, nel periodo in cui I. non era più priore provinciale di
Lombardia e non era ancora arcivescovo di Genova. Nell'incipit del testo
si legge infatti "Incipit historia reliquiarum […] compilata per fratrem
Jacobum de Varagine quondam priorem provincialem fratrum predicatorum in
Lombardia". L'edizione è a cura di A. Vigna e L.T. Belgrano in Due
opuscoli di J. da Varagine, cit., pp. 465-479.
Il Tractatus
miraculorum reliquiarum sancti Florentii e l'Historia translationis
reliquiarum eiusdem sono contenute in un manoscritto del secolo XV privo
di segnatura conservato presso l'Archivio parrocchiale di Fiorenzuola d'Arda,
(cc. 33r-53v), dove sono precedute da una lettera dedicatoria rivolta da I. a
Bonifacio di Cerdego, arciprete di Fiorenzuola, che ne aveva fatto richiesta.
L'attribuzione a I. sarebbe confermata dallo stile delle due operine, molto
vicino a quello della Legenda aurea. Si ritiene siano state composte tra
il 1281 e il 1285, durante il secondo provincialato di Iacopo. La traduzione
italiana è in G. Bonnefoy, S. Fiorenzo vescovo di Orange, Roma 1945, pp.
108-126. Per la bibliografia sul manoscritto e sull'opera cfr. Kaeppeli, II, p.
369.
La Passio sancti
Cassiani è stata scritta da I. nel 1282 su richiesta del vescovo di Imola,
Sinibaldo de' Milotti, che aveva consacrato nel 1271 la nuova cattedrale della
città a s. Cassiano. Al testo, che per l'uso delle fonti, in particolare il
leggendario di Bartolomeo da Trento, ricorda lo stile della Legenda aurea,
è premessa una lettera, datata Bologna 18 giugno 1282, nella quale I. scrive al
vescovo di aver compilato la leggenda del martire "diligenti studio"
(Lanzoni, pp. 34 s. e Bibliotheca hagiographica Latina, 1635b-c).
Fonti e Bibl.: Bologna,
Biblioteca universitaria, 1999: Hieronymus de Bursellis, Cronica
magistrorum generalium Ordinis praedicatorum; A. Potthast, Regesta
pontificum Romanorum, II, Berolini 1875, n. 24635 p. 1971; Les registres
de Boniface VIII, a cura di G. Digard et al., I-IV, Paris 1884-1939, ad
indices, s.v. Jacopus archiepiscopus Januensis e Januensis
archiepiscopus; Les registres de Nicolas IV, a cura di E. Langlois, I,
Paris 1886, nn. 76 pp. 13 s., 142 p. 23; G. Fiamma, Chronica Ordinis
praedicatorum ab anno 1170 usque ad annum 1333, a cura di B.M. Reichert,
in Monumenta Ordinis fratrum praedicatorum historica, II, 1,
Romae-Stuttgardiae 1897, p. 100; Litterae encyclicae magistrorum
generalium Ordinis praedicatorum ab anno 1233 usque ad annum 1376, a cura di
B.M. Reichert, ibid., V, Romae-Stuttgardiae-Vindobonae 1900, pp. 148 s.,
154, 156; L. Pignon, Catalogi et chronica…, a cura di G. Meersseman, ibid.,
XVIII, Romae 1936, pp. 29, 65, 74; D. Puncuh, Liber privilegiorum
Ecclesiae Ianuensis, Genova 1962, nn. 124 pp. 185 s., 194 s. pp. 294 s. La
bibliografia critica su I. e sulle sue opere è vastissima: si propone qui una
bibliografia selettiva soprattutto per quanto riguarda gli studi più datati
rinviando per un panorama più completo a T. Kaeppeli, Scriptores Ordinis
praedicatorum Medii Aevi, II, Romae 1975, pp. 348-369 (che comprende studi fino
al 1973); IV, a cura di E. Panella, ibid. 1993, pp. 139-141 (che comprende
studi fino al 1991, e a La Légende dorée (Lyon, 1476). Édition critique…,
cit., a cura di B. Dunn-Lardeau, Paris 1997, che, alle pp. 1515-1557, presenta
un'amplissima bibliografia su I. e sulle sue opere, in particolare la Legenda
aurea, dove sono compresi studi fino al 1996. F. Lanzoni, Le leggende di
s. Cassiano da Imola, in Didaskaleion, III (1925), pp. 34-44; E.C.
Richardson, Material for a life of J. da Varagine, New York 1935; A.
Pagano, Etimologie medievali di J. da V., in Memorie domenicane, LIII
(1936), pp. 81-91; Id., L'oratoriadi J. da V., ibid., LIX (1942), pp.
69-77, 108-112, 137-141; A. Dondaine, Le dominicain français Jean de
Mailly et la "Légende dorée", in Archives d'histoire
dominicaine, I (1946), pp. 53-102; M. Grabmann, Die Schönheit Marias nach
dem "Mariale" des seligen Jakobs von Voragine O.P., Erzbischofs von
Genua (†1298), in Divus Thomas, XXVII (1949), pp. 87-102; P.
Lorenzin, Mariologia Jacobi a Varagine, Roma 1951; A. Dondaine, St
Pierre Martyr, in Archivum fratrum praedicatorum, XXIII (1953), pp.
66-162; B. de Gaiffier, Legénde dorée ou légende de plomb?, in Analecta
Bollandiana, LXXXIII (1965), p. 350; A. Mombrini, La "Legenda
aurea" di J. da V., in Memorie domenicane, LXXXVI (1969), pp. 19-42;
S.G. Axters, Bibliotheca Dominicana Neerlandica manuscripta, 1224-1500,
Louvain 1970, pp. 160-171; M. von Nagy - C. von Nagy, Die "Legenda
aurea" und ihr Verfasser Jacobus de Voragine, Bern-München 1971; J.B.
Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters, III,
Münster-Westfalen 1971, pp. 221-283; M. Görlach, The South English
legendary. Gilte legende and golden legend, Braunschweig 1972; B. de
Gaiffier, L'"Historia apocrypha" dans la "Légende
dorée", in Analecta Bollandiana, XCI (1973), pp. 265-272; G.
Huot-Girard, La justice immanente dans la "Légende dorée", in Épopées,
légendes et miracles, Cahiers d'études médiévales, a cura di G.H. Allard - J.
Ménard, I, Montréal-Paris 1975, pp. 135-147; C.J. Witlin, Las explicacions
dels hagiònims en la "Legenda aurea" i la tradició medieval
d'etimologies no-derivacionals, in Analecta sacra Tarraconensia, XLVIII
(1975), pp. 75-84; G. Brunel, "Vida de s. Frances". Version en langue
d'oc et en catalan de la "Legenda aurea". Essai de classement de
manuscrits, in Revue d'histoire des textes, VI (1976), pp. 219-265; M.-C.
Pouchelle, Représentations du corps dans la "Légende
dorée", in Ethnologie française, XVI (1976), pp. 293-308; C.
Walter, Prozess und Wahrheitsfindung in der "Legenda
aurea", Kiel 1977; J. Chierici, Il miracolo in J. da V., Gonzalo
de Berceo e Dante, in L'Alighieri, XIX (1978), pp. 18-27; R. Hamer, Three
lives from the Golden legend, Heidelberg 1978; L.J. Bataillon, I. da V. e
Tommaso d'Aquino, in Sapienza, XXXII (1979), pp. 22-29; W.
Williams-Krapp, Die deutschen Übersetzungen der "Legenda aurea"
des Jacobus de Voragine, in Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur, CI (1979), pp. 252-276; C. Delcorno, Il racconto
agiografico nella predicazione dei secoli XIII-XIV, in Agiografia
dell'Occidente cristiano, secoli XIII-XIV, Atti dei Convegni dei Lincei, XLVIII,
Roma 1980, pp. 79-114; V. Marucci, Manoscritti e stampe antiche della
"Legenda aurea" di J. da Voragine volgarizzata, in Filologia e
critica, V (1980), pp. 30-50; F. Barth, Legenden als Lehrdichtung.
Beobachtungen zu den Märtyrerlegenden in der "Legenda aurea", in Europäische
Lehrdichtung, Festschr. für W. Naumann zum 70. Geburtstag, Darmstadt 1981,
pp. 61-73; S. Reames, St. Martin of Tours in the "Legenda aurea"
and before, in Viator, XII (1981), pp. 131-164; A. Boureau, Le
prêcheur et les marchands. Ordre divin et désordres du siècle dans la
"Chronique de Gênes" de Jacques de Voragine (1297), in Médiévales,
IV (1983), pp. 102-122; K. Kunze, Jacobus a (de) Voragine (Varagine),
in Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon, IV,
Berlin-New York 1983, coll. 448-466; A.-J. Surdel, Les quatre éléments
dans les légendes hagiographiques du XIIIe siècle ("Legenda
aurea", "Abbreviatio in gestis sanctorum"), in Les quatre
éléments dans la culture médiévale, a cura di D. Buschinger, Göppingen 1983,
pp. 49-62; A. Vidmanová, À propos de la diffusion de la "Légende
dorée" dans les pays tchèques, in L'art au XIIIe siècle dans les
pays tchèques, Prague 1983, pp. 599-619; A. Boureau, La Légende dorée. Le
système narratif de Jacques de Voragine († 1298), Paris 1984; B. Fleith, Hagiographisches
Interesse im 15. Jahrhundert? Erörtert an einem Jahrhundert
Rezeptionsgeschichte der "Legenda aurea", in Fifteenth
Century Studies, IX (1984), pp. 85-98; R. O'Gorman, Unrecorded manuscript
with sermons of Jacobus de Voragine and discourses by Pierre aux Bœufs and Jean
Petit, in Manuscripta, XXVIII (1984), pp. 138-144; Pélagie la
pénitente. Métamorphoses d'une légende, a cura di P. Petitmengin, II, Paris
1984, pp. 145-163; E. Colledge, James of Voragine's "Legenda s. Augustini"
and its sources, in Augustiniana, XXXV (1985), pp. 281-314; B.
Dunn-Lardeau - D. Coq, Fifteenth and sixteenth century editions of the
"Légende dorée", in Bibliothèque d'humanisme et Renaissance,
XLVII (1985), pp. 87-101; J. Knape - K. Strobel, Zur Deutung von
Geschichte in Antike und Mittelalter. "Historia apocrypha" der
"Legenda aurea", Bamberg 1985; S. Reames, The "Legenda
aurea". A reexamination of its paradoxical history, Madison, WI, 1985; B.
Dunn-Lardeau, Étude autour d'une "Légende dorée", in Travaux
de linguistique et de littérature de l'Université de Strasbourg, XXIV (1986),
pp. 257-296; Bibliotheca hagiographica Latina, n.s., a cura di H. Fros,
Bruxelles 1986, p. 189; "Legenda aurea". Sept siècles de diffusion.
Actes du Colloque sur la "Legenda aurea": texte latin et branches
vernaculaires. Montréal… 1983, a cura di B. Dunn-Lardeau, Montréal-Paris 1986;
A.-J. Surdel, Temps humain et temps divin dans la "Legenda
aurea" et dans les mystères dramatiques (XVe s.), in Le temps et
la durée dans la littérature au Moyen Âge et à la Renaissance. Actes du
Colloque…, Reims… 1984, a cura di Y. Bellenger, Paris 1986, pp. 85-102; K.E.
Geith, Die "Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum" von
Jean de Mailly als Quelle des "Legenda aurea", in Analecta
Bollandiana, CV (1987), pp. 289-302; G.P. Maggioni, Il codice novarese di
Jean de Mailly e la "Legenda aurea". Due errori del ms. LXXXVI di
Novara comuni al testo di J. da V. Problemi sulle fonti, in Novarien, XVII
(1987), pp. 173-184; A. Vauchez, Liturgie et culture folklorique: les
rogations dans la "Légende dorée" de Jacques de Voragine, in Les
laïcs au Moyen Âge. Pratiques et expériences religieuses, Paris 1987, pp.
145-155; J. da Varazze. Atti del I Convegno di studi, Varazze… 1985, a
cura di G. Farris - B.T. Delfino, Cogoleto 1987; G. Airaldi, J. da
Varagine tra santi e mercanti, Milano 1988; J.W. Dahmus, A Medieval
preacher and his sources: Johannes Nider's use of Jacobus de Voragine, in Archivum
fratrum praedicatorum, LVIII (1988), pp. 121-176; P. Devos, Édition des
fragments B, C, D (Saints Jean et Paul martyrs, Léon pape, Pierre apôtre),
in Analecta Bollandiana, CVI (1988), pp. 153-170; E. Spinelli, Frammenti
agiografici in Beneventana. Note a margine della "Legenda aurea" e
della sua diffusione nell'Italia meridionale, ibid., CVI (1988), pp.
143-151; C. Casagrande - S. Vecchio, Cronache, morale, predicazione:
Salimbene da Parma e I. da Varagine, in Studi medievali, s. 3, XXX (1989),
pp. 749-788; R. Hamer - V. Russell, A critical edition of four chapters
from the "Légende dorée", in Medieval Studies, LI (1989),
pp. 130-204; F. Dolbeau, Le dossier de Saint Dominique de Sora d'Alberic
de Mont-Cassin à Jacques de Voragine, in Mélanges de l'École française de
Rome - Moyen Âge, CII (1990), pp. 7-78; B. Fleith, "Legenda aurea":
destination, propagation, utilisateurs. L'histoire de la diffusion du légendier
au XIIIe et au début du XIVe siècle, in Raccolte di vite di
santi dal XIII al XVII secolo, a cura di S. Boesch Gajano, Brindisi 1990, pp.
41-48; J. Larmat, Les critères de la sainteté d'après la "Légende
dorée", in Razo, X (1990), pp. 43-52; G.P. Maggioni, Aspetti
originali della "Legenda aurea" di I. da V., in Medioevo e
Rinascimento, IV (1990), pp. 143-201; J.A. Ysern, La "Legenda
aurea" i el "Recull d'exemplis", in Estudis de llengua
i literatura catalanes, XXI (1990), pp. 37-48; B. Fleith, Studien zur
Überlieferungsgeschichte der lateinischen "Legenda aurea", Bruxelles
1991; L. Gaffuri, Bartolomeo di Breganze predicatore e la "Legenda
aurea", in Riv. di storia e letteratura religiosa, XXVII (1991),
pp. 223-255; H. Maddocks, Pictures for the aristocrats: the manuscripts of
the "Légende dorée", in Medieval texts and images. Studies
of manuscripts from the Middle Ages, a cura di M. Manion - B. Muir, Paris-Sydney
1991, pp. 1-23; T. Baarde, The etymology of the name of the evangelist
Mark in the "Legenda aurea" of Jacobus a Voragine, in Neederlands
Archief voor kerkegeschiedenis, LXXII (1992), pp. 1-12; B.P. McGuire, A
saint's afterlife. Bernard in the Golden legend and the other Medieval
collections, in Bernard de Clairvaux: Histoire, mentalités, spiritualité,
Paris 1992, pp. 179-211; C. Campana, La tradizione veneziana della
"Translatio sancti Nicolai" nel primo volgarizzamento italiano a
stampa della "Legenda aurea" di J. da V., in Miscellanea
Marciana, VII-IX (1992-94), pp. 103-115; "Legenda aurea" -
"Légende dorée" (XIIIe-XVe s.). Actes du Colloque
international de Perpignan, a cura di B. Dunn-Lardeau, in Le Moyen Âge
français, XXXII (1993); A. Boureau, L'événement sans fin. Récit et
christianisme au Moyen Âge, Paris 1993; S. Bertini Guidetti, Il mito di
Genova in I. da V.: tra storia e satira, in XIV Congr. di studi
umanistici, Sassoferrato… 1993, in Studi umanistici piceni, XIV (1994),
pp. 63-69; A. Boureau, Saint Bernard dans les légendiers dominicains,
in Vies et légendes de Saint Bernard de Clairvaux, a cura di P. Arabeyre -
J. Berlioz - Ph. Pirrier, Cîteaux 1994, pp. 84-90; R. Gounelle, Sens et
usage d'"apocryphus" dans la "Légende dorée", in Apocrypha,
V (1994), pp. 189-210; G.P. Maggioni, Diverse redazioni della
"Legenda aurea". Particolarità e problemi testuali, in La
critica del testo mediolatino. Atti del Convegno, Firenze… 1990, a cura di C.
Leonardi, Spoleto 1994, pp. 365-380; Id., Appelli al lettore e definizione
di apocrifi nella "Legenda aurea". A margine della leggenda di Giuda
Iscariota, in Medioevo e Rinascimento, IX (1995), pp. 241-253; Id., Dalla
prima alla seconda redazione della "Legenda aurea". Particolarità e
anomalie nella tradizione manoscritta delle compilazioni medievali, in Filologia
medievale, II (1995), pp. 259-277; Id., Ricerche sulla composizione e
sulla trasmissione della "Legenda aurea", Spoleto 1995; R.
Rhein, Die "Legenda Aurea" des Jacobus de Voragine: die
Entfaltung von Heiligkeit in "Historia" und
"Doctrina", Köln-Weimar 1995; A. Winroth, "Thomas
interpretatur abyssus vel geminus". The etymologies in the Golden legend
of Jacobus de Varagine, in Symbolae Septentrionales. Latin studies
presented to Jan Oeberg, Stockholm 1995, pp. 113-135; S. Bertini
Guidetti, Enquête sur les techniques de compilation de Jacques de Voragine,
in Cahiers d'histoire, XVI (1996), pp. 5-24; P. Bourgain, Les sermons
de Federico Visconti comparés aux écrits de fra Salimbene et Jacques de
Voragine, in Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge, CXVIII
(1996), pp. 243-257; B. Fleith, Die "Legenda aurea" und ihre
dominikanischen Bruderlegendare. Aspekte der Quellenverhältnisse apokryphen
Gedankenguts, in Apocrypha, VII (1996), pp. 167-191; S. Bertini
Guidetti, I. da Varagine e le "Ystorie antique": quando il mito
diventa "exemplum" nella storia, in Posthomerica I: tradizioni
omeriche dall'antichità al Rinascimento, Genova 1997, pp. 139-157; A.
Boureau, Vincent de Beauvais et les légendiers dominicains, in Vincent
de Beauvais, frère prêcheur: un intellectuel et son milieu au XIIIe siècle,
Grâne 1997, pp. 113-126; M.D. Edward, The handling of narrative in the
cycle of St. Catherine of Alexandria in the oratory of St. George in Padua (c.
1379-1384), in Il Santo, XXXVII (1997), pp. 147-163; G. Farris, L'anti-trinitarismo
di Lucifero nei sermoni di J. da V. e nel canto XXXIV dell'Inferno, in Critica
letteraria, XXV (1997), pp. 211-224; B. Fleith, The patristic sources of
the "Legenda aurea": a research report, in The reception of the
Church Fathers in the West, a cura di I. Backus, I, Leiden-New York-Köln 1997,
pp. 231-287; L. Gaffuri, Paroles pour le clergé, paroles pour le peuple.
Définition de la foi et réfutation de l'hérésie dans deux sermonnaires du XIIIe siècle,
in La parole du prédicateur. Ve-Xe siècle, a cura di M. Lauwers -
R.M. Dessì, Nice 1997, pp. 343-362; Gonden Legende. Heiligenlevens en
Heiligenverering in de Nederlanden, a cura di A. Mulder-Bakker - M.
Carasso-Kok, Hilversum 1997; G.P. Maggioni, Storie malvagie e vite di
santi. Storie apocrife, cattivi e demoni nei leggendari condensati del XIII
secolo, in Tra edificazione e piacere della lettura: le vite dei santi in
età medievale. Atti del Convegno… 1996, a cura di A. Degl'Innocenti - F. Ferrari,
Trento 1997, pp. 131-143; S. Bertini Guidetti, Contrastare la crisi della
chiesa cattedrale: I. da Varagine e la costruzione di un'ideologia
propagandistica, in Le vie del Mediterraneo. Uomini, idee, oggetti (secoli
XI-XVI), a cura di G. Airaldi, Genova 1998, pp. 155-182; Id., Potere e
propaganda a Genova nel Duecento, Genova 1998; Id., I "Sermones"
di I. da V. Il potere delle immagini nel Duecento, Firenze 1998; Id., Fonti
e tecniche di compilazione nella "Chronica civitatis Ianuensis", di
I. da Varagine, in Gli umanesimi medievali. Atti del Convegno… 1993,
Firenze 1998, pp. 17-36; D.J. Collins, A life reconstituted: Jacobus de
Voragine, Erasmus of Rotterdam and their lives of st. Jerome, in Medievalia
et humanistica, XXV (1998), pp. 31-51; A. Ferreiro, Simon Magus and Simon
Peter in a baroque altar relief in the cathedral of Oviedo, Spain, in Hagiographica,
V (1998), pp. 141-148; La "Légende dorée" de Jacques de
Voragine: le livre qui fascinait le Moyen Âge, a cura di B. Fleith et al.,
Genève 1998; E. Colomer Amat, El "Flos sanctorum" de Loyola y
las distinctas ediciones de la "Leyenda de los santos". Contribución
al catálogo de Juan Varela de Salamanca, in Analecta sacra Tarraconensia,
LXXII (1999), pp. 109-142; R. Schnell, Konstanz und Metamorphosen eines
Textes. Eine überlieferungs- und geschlechtergeschichtliche Studie zur
volksprachlichen Rezeption von Jacobus' de Voragine, in Frühmittelalterliche
Studien, XXXIII (1999), pp. 319-395; M. Balzert, Ein Carmen sapphicum in
der Legenda-aurea-Appendix, in Hagiographie im Kontext. Wirkungsweisen und
Möglichkeiten historischer Auswertung, a cura di D.R. Bauer - K. Herbers,
Stuttgart 2000, pp. 201-240; Il paradiso e la terra. I. da V. e il suo
tempo. Atti del Convegno intern. di studio, Varazze… 1998, a cura di S. Bertini
Guidetti, Firenze 2001; De la saintété à l'hagiographie. Genèse et usage
de la "Légende dorée", a cura di B. Fleith - F. Morenzoni,
Genève 2001; P. Di Pietro Lombardi - M. Ricci - A.R. Venturi Barbolini, "Legenda
aurea". Iconografia religiosa nelle miniature della Biblioteca Estense
universitaria, Modena 2001; G.P. Maggioni, La trasmissione dei legendari
abbreviati del XIII secolo, in Filologia mediolatina, IX (2002), pp.
87-107; Id., Parole taciute, parole ritrovate. I racconti agiografici di
Giovanni da Mailly, Bartolomeo da Trento e I. da V., in Le riscritture
agiografiche. Atti del V Convegno della SISMEL, Firenze… 2002, in Hagiographica,
X (2003), in corso di stampa; Bibliotheca sanctorum, VI, coll.
422-425; Dict. de spiritualité, ascétique et mystique, coll. 62-64; Diz.
critico della letteratura italiana, II, pp. 478-480; Repertorium fontium
hist. Medii Aevi, VI, pp. 136-139; Lexikon des Mittelalters, V, coll. 262,
1796-1801; Enc. dell'arte medievale, VII, pp. 254-256.© Istituto della Enciclopedia
Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata
SOURCE : https://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-da-varazze_%28Dizionario-Biografico%29/
Jacopo da Varazze, Sermones dominicales, 1290-1310 ca. Biblioteca Medicea Laurenziana, Bologna
Jacopo
da Varazze, Sermones dominicales, 1290-1310 ca. Biblioteca Medicea
Laurenziana, Bologna
Iacopo da Varazze
Carla CASAGRANDE
La vita
Iacopo da Varazze è nato
tra 1228 e il 1229 a Varazze oppure, più probabilmente, a Genova, dove è
attestata la presenza di una famiglia originaria di Varazze, denominata “de
Varagine”. La formula “de Voragine” con cui viene talora designato in fonti
anche antiche è una variante di “da Varagine”. Fantasiosa dunque, anche se in
un certo modo veritiera, l’idea, risalente al secolo XVI e divenuta poi
tradizionale, che “Voragine” venisse da “vorago”, a indicare l’abisso di
dottrina di cui Iacopo ha dato prova nelle sue opere.
E’ lo stesso Iacopo a
fornirci, in una rapida autobiografia contenuta in una delle sue opere,
la Chronica civitatis Ianuensis , le prime date certe della sua vita:
il 1239, quando nella sua infanzia gli capitò di assistere a un’eclisse solare,
il 1244, quando, adolescente, entrò a far parte dell’Ordine dei frati
predicatori, e il 1264, quando ebbe modo di ammirare per quaranta giorni un
altro fatto portentoso, e cioè l’apparizione di una cometa . Non si ha invece
alcuna notizia certa né sulla sua formazione di frate predicatore né sulla sua
predicazione; come pure nulla si sa della sua carriera all’interno dell’Ordine:
non esiste infatti alcuna prova di eventuali soggiorni di studio a Bologna e a
Parigi, né delle sue nomine a lector , a magister
theologiae , a priore del convento di Genova e poi di quello di Asti, come
sostengono alcuni biografi antichi. Tuttavia si può supporre che Iacopo avesse
assunto responsabilità di rilievo all’interno dell’Ordine prima del 1267, data
in cui viene elevato, nel Capitolo Generale di Bologna, all’officio di priore
dell’importante provincia di Lombardia, che all’epoca comprendeva tutta
l’Italia settentrionale, l’Emilia e il Piceno. Mantiene questa carica per dieci
anni, partecipando ai capitoli provinciali e generali dell’Ordine e risiedendo
probabilmente nel convento di Milano o in quello di Bologna, fino a quando al
capitolo generale di Bordeaux del 1277 è absolutus dall’incarico.
Dopo qualche anno, nel capitolo provinciale di Bologna del 1281, viene nuovamente
nominato priore della provincia lombarda, carica che occuperà per altri cinque
anni, fino al 1286. Dal 1283 al 1285 esercita funzioni di reggente dell’Ordine
dopo la morte di Giovanni da Vercelli e prima dell’elezione del nuovo maestro
generale Munio de Zamora.
Nel frattempo continua a
mantenere forti legami con la città di Genova. Nel giorno di Pasqua del 1283,
come racconta egli stesso nell’opuscolo Historia reliquiarum que sunt in
monasterio sororum Sanctorum Philippi et Iacobi , fece trasportare una preziosa
reliquia, la testa di una delle vergini di Sant’Orsola, da Colonia al convento
delle suore domenicane di Genova dei santi Giacomo e Filippo; si tratta dello
stesso convento al quale anni prima, durante il precedente priorato, aveva
donato un’altra reliquia, il dito di san Filippo, da lui stesso staccato dalla
mano del santo conservata nel convento di Venezia. In quell’occasione, Iacopo,
dopo la solenne processione, tenne messa e predicò al popolo. Nel 1288, quando
ormai da due anni non era più priore della Lombardia, fu candidato alla carica
di arcivescovo di Genova, ma non ottenne, come gli altri tre candidati, la
maggioranza dei voti; il papa Nicolò IV sospese la nomina affidando però a
Iacopo, il 18 maggio dello stesso anno, il compito di assolvere in una
cerimonia pubblica, che si tenne nella chiesa di san Domenico, i cittadini
genovesi scomunicati per aver avuto rapporti commerciali con i siciliani, a
loro volta scomunicati a causa della guerra del Vespro. Nello stesso anno viene
nominato diffinitor nel capitolo generale di Lucca.
Nel 1290, in occasione
del capitolo generale di Ferrara, Iacopo, resistette alle pressioni dei
cardinali romani che in una lettera chiedevano le dimissioni del maestro
generale Munio de Zamora, inviso per il suo rigorismo all’interno dell’Ordine e
della Curia romana. La lettera non sortì alcun effetto: non solo il maestro
generale non si dimise ma venne sostenuto da una pubblica dichiarazione,
firmata anche da Iacopo, che ne esaltava le virtù e ne approvava la politica. Secondo
la ricostruzione di Gerolamo Borselli (sec. XV) e, dopo di lui, di altri
antichi biografi, sarebbe proprio a causa dell’appoggio dato alla linea
rigorista di Munio de Zamora che Iacopo avrebbe subito in quell’anno un
tentativo di omicidio da parte di confratelli che volevano gettarlo nel pozzo
del convento di Ferrara. Tentativo che, racconta ancora Borselli, si sarebbe
ripetuto l’anno successivo, il 1291, a Milano, questa volta perché Iacopo aveva
escluso dal capitolo provinciale frate Stefanardo, priore del convento
milanese. Niente conferma la veridicità dei due episodi.
Nel 1292 viene nominato
dal papa Nicolò IV arcivescovo di Genova. Al governo della diocesi genovese
Iacopo dedica gli ultimi sei anni della sua vita, dal 1292 al 1298, anno della
morte. La sua azione è rivolta dapprima alla riorganizzazione legislativa del
clero sotto l’autorità arcivescovile. A questo scopo convoca un concilio
provinciale, che si tiene nella cattedrale di San Lorenzo nel giugno del 1293,
durante il quale, come racconta lo stesso Iacopo nella cronaca di Genova, viene
compiuta, alla presenza dei governanti e dei notabili e poi di tutto il popolo,
una ricognizione delle ossa di San Siro, patrono della città, che conferma
solennemente l’autenticità della reliquia.
Intensa è l’attività di
Iacopo sul piano politico, della quale egli stesso offre un ampio resoconto
nella Cronaca di Genova . Nel 1295, nei primi mesi dell’anno,
promuove la pacificazione tra le fazioni della città e celebra la pace
finalmente raggiunta in un’assemblea pubblica nella quale predica e intona,
insieme ai suoi ministri, lode a Dio; segue quindi una solenne processione per
le vie della città guidata dallo stesso Iacopo a cavallo che si conclude con il
conferimento del cingolo di miles al podestà di Genova, il milanese
Iacopo da Carcano. Nello stesso anno, in aprile, insieme agli ambasciatori
inviati dal Comune, compie un viaggio a Roma, convocato dal papa Bonifacio VIII
che cercava di prolungare l’armistizio tra Genova e Venezia. Il soggiorno
presso la Curia romana si prolunga per un centinaio di giorni e Iacopo non
manca di mostrare un certo fastidio per l’indecisione del papa e soprattutto
per le manovre dilatorie degli ambasciatori veneti. A questo punto i Genovesi,
dopo la lunga attesa, decidono di andare allo scontro con Venezia allestendo,
tra l’entusiasmo popolare, una flotta, che avrebbe dovuto affrontare i nemici
in una battaglia decisiva presso Messina alla quale però i veneziani non si
presentarono costringendo il comandante Oberto Doria a ritornare a Genova senza
aver combattuto, accolto però in trionfo dalla città e dal suo vescovo. Alla
fine del 1295 Iacopo subisce una sconfitta politica e una profonda delusione
personale: si rompe infatti la pace tra le fazioni cittadine, da lui voluta e da
lui solennemente celebrata pochi mesi prima; scoppiano incidenti violenti
durante i quali viene incendiata la Cattedrale di san Lorenzo il cui tetto
viene totalmente bruciato. I danni sono così gravi che Iacopo chiede al papa un
risarcimento che gli viene concesso il 12 giugno del 1296.
Iacopo muore nella notte
tra il 13 e il 14 luglio del 1298. Il suo corpo, prima sepolto nella chiesa di
San Domenico del convento dei frati predicatori di Genova fu, alla fine del
secolo XVIII, trasferito in un’altra chiesa domenicana, Santa Maria di
Castello, dove tuttora si trova. In virtù della venerazione e del culto di cui
fu fatto oggetto per secoli, Iacopo venne beatificato nel 1816 da papa Pio VII.
Le opere
Importante per il ruolo
all’interno dell’Ordine dei frati predicatori e per la sua azione come
arcivescovo di Genova, Iacopo da Varazze è noto soprattutto per le sue opere
che qui elenchiamo nell’ordine in cui lo stesso Iacopo le cita nell’ultimo
capitolo della Chronica civitatis Ianuensis : le Legende
Sanctorum ( Legenda Aurea ), tre raccolte di modelli di sermoni,
i Sermones de omnibus sanctis , i Sermones de omnibus Evangeliis
dominicalibus , i Sermones de omnibus Evangeliis que in singulis
feriis in Quadragesima leguntur , il Liber Marialis e la Chronica
civitatis Ianuensis . Sono esclusi da questo elenco ‘autobiografico’
alcuni opuscoli di carattere agiografico ritenuti autentici dalla critica:
la Legenda seu vita sancti Syri episcopi Ianuensis , la Historia
translationis reliquiarum Sancti Iohannis Baptistae Ianuam , la Historia
reliquiarum que sunt in monasterio sororum SS. Philippi et Iacobi de
Ianua , il Tractatus miraculorum reliquiarum Sancti Florentii.
Historia translationis reliquiarum eiusdem , la Passio Sancti
Cassiani . Incerta è invece l’attribuzione a Iacopo del Tractatus de
libris a Beato Augustino editis che in alcuni manoscritti dei secoli
XIV-XV gli viene attribuito (Jacobi di Voragine Tractatus de libris b.
Augustini ep. editis , ed. by J. A. McCormick from Manuscripts and Unique
Printing, Dissertation Abstract 25, 1964-65).
Legenda aurea
Si tratta della prima e
della più famosa opera di Iacopo da Varazze. Il titolo di Legenda
aurea , con il quale viene tradizionalmente trasmessa, non compare nei
manoscritti più antichi che riportano invece il titolo Legende
sanctorum , lo stesso con cui Iacopo designa l’opera nel passo della Chronica ricordato
più sopra. Anche gli altri titoli, con cui l’opera viene ricordata, Liber
passionalis , Vitae o Flores o Speculum sanctorum , Historia
Lombardica o Longobardica (dal penultimo capitolo, dedicato a
papa Pelagio, in cui si narrano i principali eventi accaduti dall’arrivo dei
Longobardi in Italia fino al 1245) non appartengono alla tradizione più antica
del testo. L’opera si compone di racconti dedicati alle vite dei santi e alle
feste liturgiche (178 secondo l’ed. Maggioni, 182 secondo l’ed. Graesse)
disposti, e questo costituisce un’innovazione rispetto ad opere dello stesso
genere, secondo l’ordine del calendario liturgico. I santi, di cui si racconta
la vita, appartengono tutti ai primi secoli del cristianesimo, tranne sei santi
“moderni”: due del secolo XII, Bernardo di Clairvaux e Tommaso Beckett, quattro
del XIII, Domenico, Francesco, Pietro martire, Elisabetta di Ungheria. L’opera
appartiene al genere delle legendae novae , compilazioni approntate
tra XIII e XIV secolo per lo più da esponenti dell’Ordine dei frati
predicatori, nelle quali, con il duplice intento di mettere a disposizione dei
predicatori un materiale altrimenti troppo abbondante e disperso e di offrire
alla lettura testi che fossero nello stesso tempo piacevoli ed edificanti,
venivano raccolti e condensati i racconti agiografici, che si erano accumulati
in gran numero fin dai primi secoli dell’era cristiana.
La Legenda
aurea fu scritta da Iacopo a partire dal 1260 e poi da lui successivamente
rielaborata, quando già ne circolavano le prime versioni, fino a poco prima
della morte, come ha dimostrato Giovanni Paolo Maggioni nella sua edizione
dell’opera. Nella prima redazione prevale la volontà da parte di Iacopo di
predisporre uno strumento utile alla predicazione; successivamente l’inserzione
di alcuni racconti, in cui rispetto all’intento edificatorio prevale il gusto
del meraviglioso e del sensazionale, mostra da parte di Iacopo la volontà di
tenere conto delle esigenze di un pubblico di lettori certo devoti ma anche
colti e interessati. Le fonti della Legenda aurea sono molteplici: la
Sacra Scrittura, i testi dei Padri e dei più autorevoli esponenti della
tradizione monastica, le fonti agiografiche (in particolare le precedenti legendae
novae compilate all’interno dell’ordine domenicano, l’ Abbreviatio in
gestis sanctorum di Giovanni da Mailly e il Liber epilogorum in gesta
sanctorum di Bartolomeo da Trento), fonti storiche, tra cui l’ Historia scholastica di
Pietro Comestore, lo Speculum historiale di Vincenzo di Beauvais,
la Chronica di Martino Polono, testi per predicatori composti da
confratelli dell’ordine, come il Tractatus de diversis materiis
praedicabilibus di Stefano di Borbone, ed anche testi teologici,
filosofici, giuridici, oltre a qualche raro autore profano.
La Legenda ebbe
un successo rapido, duraturo ed esteso a tutta l’Europa come nessun altro testo
in epoca medievale, a parte la Bibbia . Lo testimonia il grande
numero di manoscritti rimasti, più di 1200, le numerose edizioni che si
succedono a partire dall’ editio princeps di Colonia 1470, i molti
volgarizzamenti in tutte le principali lingue europee che si succedono a
partire dalla fine del secolo XIII (vedi Lexicon des Mittelalters ,
V, 1991, coll. 1796-1801). Notevole fu anche l’influenza che l’opera esercitò
in ambito artistico costituendo un inesauribile repertorio per la
rappresentazione delle vite dei santi. A causa di questa straordinaria
diffusione la Legenda fu un’opera in continua trasformazione da parte
dei suoi vari utenti che intervennero sul testo adattandolo alle varie pratiche
cultuali locali e all’uso che di volta in volta ne veniva fatto nell’ambito
della predicazione e della devozione. L’edizione a cura di Theodor Graesse (Dresden
1846, rist. anast. dell’ediz Dresden-Leipzig 1890, Osnabrück 1969), basata su
una delle prime edizioni a stampa, quella di Dresda 1472, dà conto del testo
vulgato della Legenda che si è venuto costituendo nei due secoli
della sua massima diffusione; la più recente edizione di Giovanni Paolo
Maggioni (2 voll., Firenze 1998, cui è seguita, nel 1999, una seconda edizione
rivista dal curatore con allegato un CD-ROM del testo della Legenda ,
a cura di L. G. G. Ricci) presenta l’ultima redazione d’autore dell’opera ed è
basata su due manoscritti (Milano, Ambr., C 240 sup. e Milano, Ambr., M 76
sup.), identificati, tra i 70 manoscritti più antichi, come testimoni
dell’ultima redazione compiuta da Iacopo sul testo.
Il successo della Legenda non
termina con il Medioevo, anche se il giudizio negativo di umanisti e riformati
contribuì al suo declino come testo religioso sia nella predicazione sia nella
devozione privata. Resta però il piacere della lettura che la narrazione
agiografica di Jacopo è stata capace di offrire e che ne ha garantito la
fortuna anche contemporanea: molte sono le traduzioni in tutte le principali
lingue moderne e numerose anche le opere teatrali, musicali, figurative da essa
ispirate. Ricordiamo le due più recenti traduzioni integrali in italiano e
francese, condotte sul testo dell’edizione Graesse, da Alessandro e Lucetta
Vitale Brovarone (Torino 1995) e da un’équipe diretta da Alain Boureau e
Monique Goullet (Paris 2004).
Le raccolte di sermoni
Iacopo scrisse tre
raccolte di sermoni modello, i Sermones de sanctis et festis ,
i Sermones de tempore , i Sermones quadragesimales . Ogni
sermone è sviluppato secondo la tecnica del sermo modernus : da
un thema iniziale, sempre costituito da un passo scritturale, segue
una divisione che individua le parti del sermone, che sono in genere tre, ma il
numero può variare a seconda dei casi da due a otto; ogni parte è poi a sua
volta soggetta a specifiche e più o meno estese divisioni, all’interno delle
quali trovano posto passi scritturali, auctoritates , metafore,
etimologie, inserti dottrinali, agiografici, liturgici. Se la tecnica è la
stessa in tutti i sermonari, tuttavia nel De sanctis i modelli
appaiono più schematici, mentre nei De tempore e poi, ancora di più,
nei Quadragesimales gli schemi si fanno più articolati e più ricchi
di contenuti. I modelli di sermoni di Iacopo sono caratterizzati, oltre che da
un certa schematicità, come si è detto, da moltissime citazioni scritturali,
dall’assenza del prothema , dall’uso parco di auctores profani,
dalla scarsa ed episodica presenza di exempla , dal ricorso costante
al linguaggio figurato, dall’uso continuo e pervasivo della distinctio ,
cui spesso è affidata la divisio del sermone e le divisioni interne
delle singole parti. Le fonti, spesso citate indirettamente da florilegia ,
sono quelle già utilizzate per la Legenda aurea : la letteratura
patristica e monastica, i testi per la predicazione elaborati in ambito
domenicano, qualche opera di carattere storico e qualche autore profano.
Le date di composizione
sono incerte. L’ordine di composizione dei tre sermonari è probabilmente quello
con cui Iacopo li elenca nella Chronica , e cioè De
sanctis , De tempore e Quadragesimales . Poiché il
primo sermonario, il De sanctis , è stato composto dopo la stesura
della Legenda aurea , come si legge nel prologo presente in alcuni
manoscritti, e l’ultimo, il Quadragesimale , potrebbe essere stato
portato a termine nel 1286, come appare nel colophon dei manoscritti di area
inglese (“expliciunt sermones fratris Ianuensis ordinis praedicatorum compilati
anno Domini MCCLXXXVI”), si può supporre che nell’insieme le tre raccolte siano
state scritte dopo il 1267, cioè dopo la prima redazione della Legenda ,
o forse dopo il 1277, cioè dopo la fine del primo provincialato, come molti
biografi sono portati a credere, e non oltre 1286. I tre sermonari ebbero uno
straordinario successo, come testimonia il grande numero di manoscritti
rimasti, più di 1120. Numero che fa dei sermonari di Iacopo da Varazze i
sermonari medievali di cui ci sono rimasti più manoscritti.
I Sermones de
omnibus sanctis et festis comprendono 305 sermoni dedicati ai santi e alle
feste liturgiche. Ad ogni santo o festa sono dedicati da due a nove sermoni.
Nella Chronica Iacopo dichiara di aver scritto due volumi di questi
sermoni, uno più ampio, quello che ci è pervenuto, l’altro più breve, di cui
non si ha notizia. I santi e le feste sono elencati secondo l’ordine del
calendario ecclesiastico già adottato nella Legenda aurea , se pure
in numero ridotto: dei 178 capitoli della Legenda più di cento non
vengono ripresi nei Sermones , per lo più quelli dedicati a santi
“minori” dei primi secoli, martiri e monaci. Molti sono i brani ripresi
dalla Legenda e presentati nei Sermones in forma
compendiata e moralizzata. L’opera si presenta in effetti come la trasposizione
sermocinale del materiale agiografico raccolto della Legenda . Lo
stesso Iacopo, nel prologo, riconosce di aver scritto il De sanctis in
seguito alle sollecitazioni dei confratelli che avevano letto e apprezzato
la Legenda aurea . Il successo della raccolta è testimoniato da più
di 300 manoscritti, e dalle edizioni, che si susseguono ininterrottamente dal
XV al XIX secolo a partire dall’ editio princeps di Colonia 1478
(per l’elenco dei manoscritti, vedi Schneyer, III, pp. 266-268;
Kaeppeli-Panella, II, n. 2155, pp. 359-61 e IV, p. 141). L’edizione dei Sermones
de sanctis a cura di Giovanni Paolo Maggioni è in corso di stampa presso
la Sismel – Edizioni del Galluzzo. Per il testo e i problemi legati
all’edizione vedi i materiali raccolti da Giovanni Paolo Maggioni nel sito
ephilology.org.
La seconda raccolta,
conosciuta sotto vari titoli ( Sermones de omnibus evangeliis
domenicalibus , secondo l’indicazione dello stesso Iacopo, oppure Sermones
de tempore per annum , Sermones dominicales , Sermones
festivales ), comprende 160 modelli di sermoni, tre per ogni Vangelo della
domenica. Anche quest’opera è stata scritta, come dichiara Iacopo nel prologo,
su sollecitazione dei confratelli (“importuna fratrum instantia”) e dedicata
alla Trinità, alla Vergine Maria e a san Domenico, alla cui intercessione ci si
raccomanda per il buon esito dell’opera. Anche in questo caso si contano
moltissimi manoscritti, più di 350, e numerose edizioni che seguono la princeps di
Colonia 1467-69 (vedi Schneyer , IIII, 233-235; Kaeppeli-Panella, II, n. 2156,
pp. 361-364 e IV, p. 141). A conferma della secolare fortuna della raccolta
segnaliamo una traduzione italiana edita a Milano presso Fabbiani nel 1913-14
con il titolo Sermoni domenicali .
I Sermones
quadragesimales comprendono 98 modelli di sermoni predicabili nel periodo
quaresimale (due per ogni feria ). L’edizione da poco disponibile, a
cura di Giovanni Paolo Maggioni (Sismel – Edizioni del Galluzzo, Firenze 2004),
è basata su sei testimoni delle principali aree di diffusione del testo (area
italiana, germanica e britannica): Firenze, Laurenz., Acq. e Doni 344; Graz,
Universitätbibl., 1472; London, Lambeth Palace Library, 23; München, Bayerische
Staatsbibl., clm 18850; Tosi, Bibl. Com., 142; Würzburg, Universitätbibl.,
M.p.th.f. 54. I manoscritti appartengono tutti al secolo XIII tranne il
testimone inglese, risalente agli ultimi decenni del sec. XIV, il più antico
della famiglia insulare, l’unica caratterizzata dalla datazione 1286, presente
negli explicit . L’edizione, pur costituendo, come sostiene lo stesso
curatore, una sorta di prolegomena a una futura definitiva edizione,
rappresenta un notevole avanzamento rispetto alle edizioni precedenti e
consente di giungere ad alcune conclusioni: la conferma che Iacopo si sia
servito di florilegia per la citazione delle auctoritates ,
l’ipotesi, altamente probabile, che il testo sia frutto di un’unica redazione,
la certezza che i due sermoni finali presenti in molte edizioni, il Sermo
de Passione Domini e il Sermo in planctu Beatae Virginis Mariae ,
non appartengano alla raccolta originale e non siano dunque autentici. Come le
altre raccolte, anche i Sermones quadragesimales ebbero uno
straordinario successo, testimoniato da più di 300 manoscritti e numerose
edizioni dal XV fino al XIX secolo, seguite alla princeps di Brescia
1483. Per l’elenco dei manoscritti vedi l’Appendice all’ed. Maggioni che
riprende e integra gli elenchi di Schneyer (III, pp. 244-246) e
Kaeppeli-Panella (II, n. 2157, pp. 364-367 e IV, p. 141).
Il Liber Marialis
Anche Liber
marialis è stato per molto tempo considerato una raccolta di sermoni, come
testimonia, per esempio, il titolo Sermones aurei de Maria virgine Dei
matri , presente nell’edizione Venezia 1590 e la recente inclusione
nel Repertorium dei sermoni dello Schneyer. In realtà, il Liber
marialis , è certamente un testo composto ad uso dei predicatori ma non
una raccolta di sermoni. Si tratta di un opuscolo, come scrive lo stesso Iacopo
nel prologo, in onore della Vergine, che presenta un elenco, in ordine
alfabetico, di termini che illustrano caratteristiche, funzioni, immagini,
virtù ad essa tradizionalmente attribuite. I termini elencati sono 160,
da Abstinentia a Vulnerata , passando per Ancilla , Assumptio , Aurora , Conceptio , Domus , Fides , Gaudium , Humilitas , Ignis , Luna , Lux , Mater , Mediatrix , Palma , Regina , Requies , Salutatio , Stella , Templum ,
solo per fare qualche esempio; ognuno di essi costituisce il punto di partenza
di una schematica trattazione che ricorda da vicino lo stile espositivo dei
sermoni. Anche in questo caso si parte infatti da una distinzione in più punti,
nei quali trovano posto passi scritturali, citazioni da auctores ,
altre distinzioni, metafore. Iacopo, nel prologo, dichiara di aver composto
l’opera in età senile, quando, arcivescovo di Genova, si sentì ormai prossimo
alla morte e volle affidarsi alla tutela della Vergine. La data di composizione
dell’opera deve quindi essere collocata tra la sua nomina ad arcivescovo, il
1292, e la sua morte, il 1298. Se pure in misura minore rispetto alle altre
opere, anche il Liber marialis conobbe una certa fortuna nel Medioevo
e nei secoli successivi. Si contano una settantina di manoscritti e, a partire
da quella di Amburgo 1491, molte altre edizioni dal XV al XIX secolo (vedi
Schneyer, III, p. 283 e Kaeppeli-Panella, II, n. 2158, pp.367-368). Recente una
traduzione in lingua italiana: (Iacopo da Varagine, Mariale aureo ,
versione italiana, introduzione e dizionario di Valerio Ferrua, EDB, Bologna
2006).
La Cronaca di Genova
La Chronica
civitatis Ianuensis ab origine urbis usque ad annum MCCXCVII è l’ultima
opera di Iacopo, scritta dal 1295, o dall’inizio del 1296, al 1298, anno della
morte, cioè durante gli ultimi anni del suo mandato arcivescovile a Genova. Il
testo si divide in dodici parti: le prime cinque trattano della fondazione
della città, delle prime fasi della sua storia, delle origini del nome, della
conversione al cristianesimo e del suo progressivo sviluppo fino all’anno 1294;
seguono quattro parti che costituiscono una sorta di trattato politico sulla
natura e sulla tipologia del governo secolare e sui modelli del rector e
del civis cristiano; concludono l’opera tre parti dedicate, la prima,
alla trasformazione di Genova da sede vescovile a sede arcivescovile, le altre
due, alla rassegna in ordine temporale dei vescovi e degli arcivescovi e dei
principali avvenimenti accaduti a Genova e nel mondo durante il loro mandato.
La narrazione si conclude con una sorta di piccola autobiografia di Iacopo e
con il racconto fino al 1297 degli eventi accaduti negli anni del suo mandato
di arcivescovo in città. Come si vede, si tratta di un testo “composito”,
ispirato a diversi stili di scrittura: l’encomio delle laudes civitatum ,
la narrazione delle cronache universali, il resoconto degli avvenimenti secondo
i moduli della storia annalistica, il discorso dottrinale e normativo
degli specula . Diversi sono anche gli obiettivi cui l’opera tende:
sottolineare il legame tra storia cittadina e azione vescovile, proporre
un’idea “agostiniana” della storia umana come scenario dell’azione salvifica di
Dio, e, in generale, “istruire ed edificare”, come scrive lo stesso Iacopo nel
prologo. A questo scopo, Iacopo non si limita ad alternare il racconto degli
eventi con considerazioni di carattere dottrinale e morale ma dedica la parte
centrale del testo all’esposizione di un vero e proprio speculum
civitatis in cui, all’interno di un discorso che non si rivolge più solo
ai genovesi ma che acquista valore universale, si analizzano e si valutano le
diverse forme del governo secolare, si mostrano le qualità del buon rector e
dei suoi consiliarii , si indicano i doveri del buon cittadino nei
suoi rapporti con i governanti, la moglie, i figli e i servi. L’intento
didattico ed edificatorio dell’opera la rende molto vicina ai testi per la
predicazione: non a caso Iacopo vi inserisce lunghi brani tratti sia
dalla Legenda aurea sia dai sermonari, non a caso il testo è stato di
fatto utilizzato come supporto per la predicazione, come dimostra la presenza
nella tradizione manoscritta di indici tematici alfabetici, tipico strumento di
consultazione per predicatori. Anche le fonti della Chronica sono in
larga parte comuni con le opere per la predicazione: accanto a fonti storiche
specifiche, come per esempio gli Annali di Caffaro , relativi alla
storia di Genova, ritroviamo infatti quell’insieme variegato di auctores già
utilizzato per la compilazione della Legenda e dei sermonari. Da
segnalare anche l’utilizzo del De regno di Tommaso d’Aquino, in
particolare riguardo all’analisi delle diverse forme di governo, ferma restando
la distanza tra la concezione politica di Iacopo da quella del teologo
domenicano. La Chronica ebbe, se pure in misura minore rispetto alle
altre opere di Iacopo, una certa fortuna nel Medioevo e nei secoli successivi:
si contano 44 manoscritti (vedi Monleone, I, pp. 351-509 con l’integrazione di
Kaeppeli-Panella, II, p. 368) e un’edizione parziale a cura di Ludovico
Muratori ( Rerum Ital. Script. , IX, Mediolani 1726, coll. 1-56).
L’edizione critica è di Giovanni Monleone (Fonti per la storia d’Italia, Roma
1941), che ha premesso al testo uno Studio introduttivo sulla vita di
Iacopo e le sue opere, a tutt’oggi punto di riferimento fondamentale.
L’edizione Monleone, oltre a mettere a disposizione una versione criticamente
affidabile della Chronica , ha il merito di aver ribadito il
carattere del tutto peculiare dell’opera di Iacopo all’interno del genere
cronachistico sottraendola ai giudizi impietosi sulla sua affidabilità come
opera storica che molti nel corso dei secoli, tra i quali anche Coluccio
Salutati e Muratori, le hanno riservato. Recentemente Stefani Bertini Guidetti
ha fornito una traduzione integrale della Chronica in lingua italiana
(ECIG, Genova 1995), preceduta da un riesame critico dell’opera in rapporto con
la storia di Genova e l’azione pastorale e politica dei frati Predicatori.
Altri opuscoli
agiografici
Iacopo scrisse inoltre
alcuni opuscoli di carattere agiografico che sono tradizionalmente ritenuti
autentici. Alcuni di essi sono ricordati dallo stesso Iacopo in vari passaggi
della Chronica , altri gli vengono attribuiti nei manoscritti e
risultano per lo stile molto vicini alla Legenda aurea .
Tre riguardano santi e
reliquie legati alla storia di Genova: la Legenda seu vita sancti Syri
episcopi Ianuensis , scritta nel 1293 (il testo, che corrisponde al
capitolo dedicato a san Siro in delle ultime revisioni editoriali della Legenda
aurea , è stato pubblicato nel 1874 da Vincenzo Promis come opera autonoma
in Leggenda e inni di san Siro vescovo di Genova , in Atti della
Società ligure di storia patria , X (1874), pp. 357-383); l’ Historia
reliquiarum que sunt in Monasterio SS. Philippi et Iacobi de Ianua ,
probabilmente composta tra il 1286 e il 1292, e l’ Historia translationis
reliquiarum Sancti Iohannis Baptistae Ianuam , redatta tra 1296 e il 1298
(entrambe pubblicate in Due opuscoli di Jacopo da Varagine , ed. a
cura di A. Vigna e L. T. Belgrano in Atti della Società ligure di storia
patria , X (1874), pp. 465-479 e pp. 480-491).
Il Tractatus
miraculorum reliquiarum Sancti Florentii e l’ Historia translationis
reliquiarum eiusdem , composte probabilmente tra il 1281 e il 1285, sono
contenute nel manoscritto Fiorenzuola d’Arda, Bibl. Parrochiale (sec. XV), ff.
33r-53v (traduzione italiana in G. Bonnefoy, San Fiorenzo vescovo di
Orange , Roma 1945, pp. 108-126; per la bibliografia sul manoscritto e
sull’opera vedi Kaeppeli-Panella, II, p. 369).
La Passio sancti
Cassiani è stata scritta da Iacopo nel 1282 su richiesta del vescovo di
Imola, Sinibaldo de’ Milotti, che aveva consacrato nel 1271 la nuova cattedrale
della città a san Cassiano ( Bibliotheca Hagiographica Latina ,
1635b-c).
Bibliografia
Fonti
Hieronymus de
Bursellis, Cronica magistrorum generalium Ordinis Praedicatorum,
Bologna , Bibl. Univ. 1999, f. 69; A. Potthast, Regesta Pontificum
Romanorum , II, Berlino 1875, n. 24635, p.1971; Les Registres de
Boniface VIII , ed. G. Digard, M. Faucon, A, Thomas, R. Fawtier, 4 voll.,
Paris 1884-1939 (ad indices s.v. Jacopus archiepiscopus Januensis e Januensis
archiepiscopus ); Les registres de Nicolas IV , ed. E. Langlois,
I, Paris 1886, n. 76, pp. 13-14, n. 142, p. 23; Galvagni de la Flamma Cronica
ordinis praedicatroum ab anno 1170 usque ad 1333 , ed. B. M. Reichert,
in Mon. Ordinis Fratrum Praed. Historica , II.1, Romae-Stuttgardiae
1897, p. 100; Litterae Encyclicae Magistrorum Generalium ordinis
Praedicatorum ab anno 1233 usque ad annum 1376 , ed. B. M. Reichert,
in Mon. Ordinis Fratrum Praed. Historica , V,
Romae-Stuttgardiae-Vindobonae 1900, pp. 148-149, 154, 156; Laurentii
Pignon Catalogi et Chronica … , ed. G. Meersseman, in Mon.
Ordinis Fratrum Praed. Historica , XVIII, Romae 1936, p. 29, 65, 74; D.
Puncuh, Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis , Genova 1962, n. 124
pp. 185-186; nn. 194-195, pp. 294-295.
Studi
La rassegna qui
presentata è selettiva per quanto riguarda gli studi più datati per i quali si
rinvia a Th. Kaeppeli – E. Panella, Scriptores Ordinis Fratrum
Praedicatorum , II, Roma 1975, pp. 348-369 (che comprende studi fino al
1973) e IV, Roma 1993, pp. 139-141 (che comprende studi fino al 1991) e a La
Légende dorée (Lyon, 1476). Edition critique de la Légende dorée dans la
revision de 1476 par Jean Batailier, d’après la traduction de Jean de Vignay
(1333-1348) de la Legenda aurea (c. 1261-1266) , ed. B. Dunn-Lardeau,
Paris 1997, pp. 1515-1557 (che comprende studi fino al 1996).
1925
F. Lanzoni, Le leggende di San Cassiano da Imola , in “Didaskleion,
III (1925), pp. 34-44
1935
E.C. Richardson, Material for a Life of Jacopo da Varagine , New York
1935
1936
A. Pagano, Etimologie medievali di Jacopo da Varazze , in Memorie
domenicane , LIII (1936), pp. 81-91
1942
A. Pagano, L’oratoria di Jacopo da Varazze , in Memorie
domenicane , LIX (1942), pp. 69-77, 108-112, 137-141
1946
A. Dondaine, Le dominicain français Jean de Mailly et la ‘Légende
dorée’ , in Archives d’histoire dominicaine , I (1946), pp.
53-102
1949
M. Grabmann, Die Schönheit Marias nach dem ‘Mariale’ des seligen Jakob von
Voragine O.P., Erzbischofs von Genua (+1298) , in Divus Thomas ,
XXVII (1949), pp. 87-102
1951
P. Lorenzin, Mariologia Jacobi a Varagine , Roma 1951
1953
A. Dondaine, Saint Pierre Martyr , in Archivum Fratrum
Praedicatorum , XXIII (1953), pp. 66-162
1965
U. M. Carmarino, Giacomo da Varazze , in Bibliotheca
Sanctorum , VI, Roma 1965, coll. 422-25
B. de Gaiffier, Legénde dorée ou légende de plomb? , in Analecta
Bollandiana , LXXXIII (1965), p. 350
1969
A. Mombrini, La ‘Legenda aurea’ di Jacopo da Varazze , in Memorie
domenicane , LXXXVI (1969), pp. 19-42
1970
S. G. Axters, Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta,
1224-1500 , Louvain 1970, pp. 160-171
1971
M. von Nagy – C. von Nagy, Die ‘Legenda aurea’ und ihr Verfasser Jacobus
de Voragine , Bern-München 1971
P. Raffin, Jacques de Voragine , in Dictionnaire de
Spiritualité, Ascétique et Mystique , Paris 1971, coll. 62-64
J. B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters ,
III, Münster Westfalen 1971, pp. 221-283
1972
M. Görlach, The South English Legendary. Gilte Legende and Golden
Legend , Braunschweig 1972
1973
B. de Gaiffier, L’ ‘Historia apocrypha’ dans la ‘Légende dorée’ ,
in Analecta Bollandiana , XCI (1973), pp. 265-272
1975
G. Huot-Girard, La justice immanente dans la ‘Légende dorée’ ,
in Épopées, légendes et miracles, Cahiers d’études médiévales , ed.
G. H. Allard – J. Ménard, I, Montréal-Paris 1975, pp. 135-147
C. J. Witlin, Las explicacions dels hagiònims en la ‘Legenda aurea’ i la
tradició medieval d’etimologies no-derivacionals , in Analecta sacra
Tarraconensia , XLVIII (1975), pp. 75-84
1976
G. Brunel, ‘ Vida de sant Frances’. Version en langue d’oc et en catalan
de la ‘Legenda aurea’. Essai de classement de manuscrits , in Revue
d’histoire des textes , VI (1976), pp. 219-265
M.-C. Pouchelle, Représentations du corps dans la ‘Légende dorée’ ,
in Ethnologie française , XVI (1976), pp. 293-308
1977
C. Walter, Prozess und Wahrheitsfindung in der ‘Legenda aurea’ , Kiel
1977
1978
J. Chierici, Il miracolo in Jacopo da Varazze, Gonzalo de Berceo e
Dante , in L’Alighieri , XIX (1978), pp. 18-27
R. Hamer, Three Lives from the Golden Legend , Heidelberg 1978
1979
L. J. Bataillon, Iacopo da Varazze e Tommaso d’Aquino , in Sapienza ,
XXXII (1979), pp. 22-29
W. Williams-Krapp, Die deutschen Übersetzungen der ‘Legenda aurea’ des
Jacobus de Voragine , in Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur , CI (1979), pp. 252-276
1980
C. Delcorno, Il racconto agiografico nella predicazione dei secoli
XIII-XIV , in Agiografia dell’Occidente cristiano, secoli
XIII-XIV , Atti dei Convegni dei Lincei, 48, Roma 1980, pp. 79-114 (rist.
con il titolo Agiografia e predicazione in ‘ Exemplum’ e letteratura
tra Medioevo e Rinascimento , Bologna 1989, pp. 7-77)
V. Marucci, Manoscritti e stampe antiche della ‘Legenda aurea’ di Jacopo
da Voragine volgarizzata , in Filologia e critica , V (1980),
pp. 30-50
1981
F. Barth, Legenden als Lehrdichtung. Beobachtungen zu den Märtyrerlegenden
in der ‘Legenda aurea’ , in Europäische Lehrdichtung ,
Festschriften W. Naumann, Darmstadt 1981, pp. 61-73
S. Reames, Saint Martin of Tours in the ‘Legenda aurea’ and Before ,
in Viator , XII (1981), pp. 131-164
1983
A. Boureau, Le prêcheur et les marchands. Ordre divin et désordres du
siècle dans la ‘Chronique de Gênes’ de Jacques de Voragine (1297) ,
in Médiévales , IV (1983), pp. 102-122
K. Kunze, Jacobus a (de) Voragine (Varagine), in Die deutsche
Literatur des Mittelalters: Verfasserlexicon , IV, Berlin-New York 1983,
coll. 448-466
A.-J. Surdel, Les quatre éléments dans les légendes hagiographiques du
XIIIe siècle (‘Legenda aurea’, ‘Abbreviatio in gestis sanctorum’), in Les
quatre éléments dans la culture médiévale , ed. D. Buschinger, Göppingen
1983, pp. 49-62
A. Vidmanová, À propos de la diffusion de la ‘Légende dorée’ dans les pays
tchèques , in L’art au XIIIe siècle dans les pays tchèques ,
Prague 1983, pp. 599-619
1984
A. Boureau, La Legende dorée. Le système narratif de Jacques de Voragine
(+1298) , Paris 1984
B. Fleith, Hagiographisches Interesse im 15. Jahrhundert? Erörtert an
einem Jahrhundert Rezeptionsgeschichte der ‘Legenda aurea’ , in Fifteenth
Century Studies , IX (1984), pp. 85-98
R. O’Gorman, Unrecorded Manuscript with Sermons of Jacobus de Voragine and
Discourses by Pierre aux Bœufs and Jean Petit , in Manuscripta ,
XXVIII (1984), pp. 138-144
P. Petitmengin (ed.), Pélagie la pénitente. Métamorphoses d’une
légende, Paris 1984, II, pp. 145-163
1985
E. Colledge , James of Voragine’s ‘Legenda sancti Augustini’ and its
sources , in Augustiniana , XXXV (1985), pp. 281-314
B. Dunn-Lardeau – D. Coq, Fifteenth and Sixteenth Century Editions of the
‘Légende dorée’ , in Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance ,
XLVII (1985), pp. 87-101
J. Knape – K. Strobel, Zur Deutung von Geschichte in Antike und
Mittelalter. ‘Historia apocrypha’ der ‘Legenda aurea’ , Bamberg 1985
S. Reames, The ‘Legenda aurea’. A Reexamination of its Paradoxical
History , Madison (Wisconsin) 1985
1986
S. Bastianetto, Iacopo da Varazze , in Dizionario critico della
letteratura italiana , II, Torino 1986, pp. 478-480
B. Dunn-Lardeau, Étude autour d’une ‘Légende dorée’ , in Travaux
de linguistique et de littérature de l’Université de Strasbourg , XXIV
(1986), pp. 257-296
Bibliotheca Hagiographica Latina , n.s., ed. H. Fros, Bruxelles 1986, p.
189
‘ Legenda Aurea’. Sept siècles de diffusion, Actes du colloque sur la
‘Legenda aurea’: texte latin et branches vernaculaires (Montréal, 11-12 mai
1983) , ed. B. Dunn-Lardeau, Montréal-Paris 1986
A.-J. Surdel, Temps humain et temps divin dans la ‘Legenda aurea’ et dans
les mystères dramatiques (XVe s.) , in Le temps et la durée dans la
littérature au Moyen Age e à la Renaissance , ed. Y. Bellenger, Paris
1986, pp. 85-102
1987
K. E. Geith, Die ‘Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum’ von Jean
de Mailly als Quelle des ‘Legenda aurea’ , in Analecta
Bollandiana , CV (1987), pp. 289-302
G. P. Maggioni, Il codice novarese di Jean de Mailly e la ‘Legenda aurea’.
Due errori del ms. LXXXVI di Novara comuni al testo di Jacopo da Varazze.
Problemi sulle fonti , in Novarien , XVII (1987), pp. 173-184
A. Vauchez, Liturgie et culture folklorique: les Rogations dans la
‘Légende dorée’ de Jacques de Voragine , in Les laïcs au Moyen Age.
Pratiques et expériences religieuses , Paris 1987, pp. 145-155
Jacopo da Varazze. Atti del I Convegno di Studi (Varazze 13-14 apr. 1985),
ed. G. Farris – B. T. Delfino, Cogoleto 1987
1988
G. Airaldi, Jacopo da Varagine tra santi e mercanti , Milano 1988
J. W. Dahmus, A Medieval Preacher and His Sources: Johannes Nider’s Use of
Jacobus de Voragine , in Archivum Fratrum Praedicatorum , LVIII
(1988), pp. 121-176
P. Devos, Édition des fragments B, C, D (SS. Jean et Paul martyrs, Léon
pape, Pierre apôtre , in Analecta Bollandiana , CVI (1988), pp.
153-170
E. Spinelli, Frammenti agiografici in Beneventana. Note a margine della
‘Legenda aurea’ e della sua diffusione nell’Italia meridionale , in Analecta
Bollandiana , CVI (1988), pp. 143-151
1989
C. Casagrande –S. Vecchio, Cronache, morale, predicazione: Salimbene da
Parma e Iacopo da Varagine , in Studi medievali , 3 s., XXX
(1989), pp. 749-788
R. Hamer – V. Russell, A Critical Edition of Four Chapters from the
‘Légende dorée’ , in Medieval Studies LI (1989), pp. 130-204
1990
F. Dolbeau, Le dossier de Saint Dominique de Sora d’Alberic de Mont-Cassin
à Jacques de Voragine , in Mélanges de l’École français - Moyen
Age , CII (1990), pp. 7-78
B. Fleith, ‘ Legenda aurea’: destination, propagation, utilisateurs.
L’histoire de la diffusion du légendier au XIIIe et au début du XIVe
siècle , in Raccolte di vite di santi dal XIII al XVII secolo ,
ed. S. Boesch Gajano, Brindisi 1990, pp. 41-48
J. Larmat, Les critères de la sainteté d’après la ‘Légende dorée’ ,
in Razo , X (1990), pp. 43-52
G. P. Maggioni, Aspetti originali della ‘Legenda aurea’ di Iacopo da
Varazze , in Medioevo e Rinascimento , IV (1990), pp. 143-201
Repertorium Fontium Medii Aevi , VI, Romae 1990, pp. 136-139
J. A. Ysern, La ‘Legenda aurea’ i el ‘Recull d’exemplis’ , in Estudis
de llengua i literatura catalanes , XXI (1990), pp. 37-48
1991
B. Fleith, Studien zur Überlieferungsgeschichte der lateinischen ‘Legenda
aurea’ , Bruxelles 1991
L. Gaffuri, Bartolomeo di Breganze predicatore e la ‘Legenda aurea’ ,
in Rivista di storia e letteratura religiosa , XXVII (1991), pp.
223-255
Lexicon des Mittelalters , V, München -Zurich, 1991, pp. 262
e1796-1801
H. Maddocks, Pictures for the Aristocrats: The Manuscripts of the ‘Légende
dorée’ , in Medieval Texts and Images. Studies of Manuscripts from
the Middle Ages , ed. M. Manion – B. Muir, Paris-Sydney 1991, pp. 1-23
1992
T. Baarde, The Etymology of the Name of the Evangelist Mark in the
‘Legenda aurea’ of Jacobus a Voragine , in Neederlands archief voor
kerkegeschiedenis , LXXII (1992), pp. 1-12
B. P. McGuire, A Saint’s Afterlife. Bernard in the Golden Legend and the
Other Medieval Collections , in Bernard de Clairvaux: Histoire,
mentalités, spiritualité , Paris 1992, pp. 179-211
1993
‘ Legenda aurea’ – ‘Légende dorée’ (XIIIe-XVe s.) , Actes du Coll.
intern. de Perpignan, ed. B. Dunn-Lardeau, in Le Moyen Âge français ,
XXXII (1993)
A. Boureau, L’événement sans fin. Récit et christianisme au Moyen
Age , Paris 1993, pp. 000-000
C. Campana, La tradizione veneziana della ‘Translatio sancti Nicolai’ nel
primo volgarizzamento italiano a stampa della ‘Legenda aurea’ di Jacopo da
Varazze , in Miscellanea Marciana , VII-IX (1992-1994), pp.
103-1115
S. Bertini Guidetti, Il mito di Genova in Iacopo da Varazze: tra storia e
satira , in XIV Congr. di Studi Umanistici , Sassoferrato 23-23
giugno 1993, in Studi umanistici piceni , XIV (1994), pp. 63-69
1994
A. Boureau, Saint Bernard dans les légendiers dominicains , in Vies
et légendes de Saint Bernard de Clairvaux , ed. P. Arabeyre – J. Berlioz –
Ph. Pirrier, Cîteaux 1994, pp. 84-90
R. Gounelle, Sens et usage d’ ‘apocryphus’ dans la ‘Légende dorée’ ,
in Apocrypha , V (1994), pp. 189-210
G. P. Maggioni, Diverse redazioni della ‘Legenda aurea’. Particolarità e
problemi testuali , in La critica del testo mediolatino . Atti
del Convegno, Firenze 6-8 dicembre 1990, ed. C. Leonardi, Spoleto 1994, pp.
365-380
1995
B. Fleith – A. Wenzel, ‘ Legenda aurea’ , in Enzyklopädie des
Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden
Erzählforschung , VIII, Berlin – New York, 1995, pp. 846-855
G. P. Maggioni, Appelli al lettore e definizione di apocrifi nella ‘Legenda
aurea’. A margine della legenda di Giuda Iscariota , in Medioevo e
Rinascimento , IX (1995), pp. 241-253
G. P. Maggioni, Dalla prima alla seconda redazione della ‘Legenda aurea’.
Particolarità e anomalie nella tradizione manoscritta delle compilazioni
medievali , in Filologia medievale , II (1995), pp. 259-277
G. P. Maggioni, Ricerche sulla composizione e sulla trasmissione della
‘Legenda aurea’ , Spoleto 1995
R. Rhein, Die ‘Legenda Aurea’ des Jacobus de Voragine: die Entfaltung von
Heiligkeit in ‘Historia’ und ‘Doctrina’ , Köln-Weimar, 1995
A. Winroth, ‘ Thomas interpretatur abyssus vel geminus’. The Etymologies
in the Golden Legend of Jacobus de Varagine , in Symbolae
Septentrionales. Latin Studies Presented to Jan Oeberg , Stockholm 1995,
pp. 113-135
1996
S. Bertini Guidetti, Enquête sur les techniques de compilation de Jacques
de Voragine , in Cahiers d’histoire , XVI (1996), pp. 5-24
P. Bourgain, Les sermons de Federico Visconti comparés aux écrits de Fra
Salimbene et Jacques de Voragine , in Mélanges de l’École française
de Rome - Moyen Âge, CXVIII (1996), pp. 243-257
B. Fleith, Die ‘Legenda aurea’ und ihre dominikanischen Bruderlegendare.
Aspekte der Quellenverhältnisse apokryphen Gedankenguts, in Apocrypha ,
VII (1996), pp. 167-191
T. Refice, Jacopo da Varazze , in Enciclopedia dell’arte
italiana , VII, Roma 1996, pp. 254-256
1997
S. Bertini Guidetti, Iacopo da Varagine e le ‘Ystorie antique’: quando il
mito diventa ‘exemplum’ nella storia , in Posthomerica I: tradizioni
omeriche dall’Antichità al Rinascimento , Genova 1997, pp. 139-157
A. Boureau, Vincent de Beauvais et les légendiers dominicains ,
in Vincent de Beauvais, frère prêcheur: un intellectuel et son milieu au
XIIIe siècle , Grâne 1997, pp. 113-126
M. D. Edward, The Handling of Narrative in the Cycle of St. Catherine of
Alexandria in the Oratory of St. George in Padua (c. 1379-1384) , Il
Santo , XXXVII (1997), pp. 147-163
G. Farris, L’anti-trinitarismo di Lucifero nei Sermoni di Jacopo da
Varazze e nel canto XXXIV dell’Inferno , Critica letteraria ,
XXV (19997), pp. 211-224
B. Fleith, The Patristic Sources of the ‘Legenda aurea’: a Research
Report , in The Receptions of the Church Fathers in the West ,
ed. I. Backus, I, Leiden-New York-Köln 1997, pp. 231-287
L. Gaffuri, Paroles pour le clergé, paroles pour le peuple. Définition de
la foi et réfutation de l’hérésie dans deux sermonnaires du XIIIe siècle ,
in La parole du prédicateur. Ve-Xe siècle , ed. M. Lauwers – R. M.
Dessì, Nice 1997, pp. 343-362
Gonden Legende. Heiligenlevens en Heiligenverering in de Nederlanden , ed.
A. Mulder-Bakker – M. Carasso-Kok, Hilversum 1997
G. P. Maggioni, Storie malvagie e vite di santi. Storie apocrife, cattivi
e demoni nei leggendari condensati del XIII secolo , in Tra
edificazione e piacere della lettura: le vite dei santi in età medievale ,
Atti del Convegno (Trento 22-23 ott. 1996), ed. A. Degl’Innocenti – F. Ferrari,
Trento 1997, pp. 131-143
1998
S. Bertini Guidetti, Contrastare la crisi della chiesa cattedrale: Iacopo
da Varagine e la costruzione di un’ideologia propagandistica , in Le
vie del Mediterraneo. Uomini, idee, oggetti (secoli XI-XVI) , a cura di G.
Airaldi, Genova 1998, pp. 155-182
S. Bertini Guidetti, Potere e propaganda a Genova nel Duecento ,
Genova 1998
S. Bertini Guidetti, I ‘Sermones’ di Iacopo da Varazze. Il potere delle
immagini nel Duecento , Firenze 1998
S. Bertini Guidetti, Fonti e tecniche di compilazione nella ‘Chronica
civitatis Ianuensis’, di Iacopo da Varagine , in Gli umanesimi
medievali , Atti del Convegno di Firenze, 11-13 settembre 1993, Firenze
1998, pp. 17-36
D. J. Collins, A Life Reconstituted: Jacobus de Voragine, Erasmus of
Rotterdam and Their Lives of St. Jerome , in Medievalia et
Humanistica , XXV (1998), pp. 31-51
A. Ferreiro, Simon Magus and Simon Peter in a Baroque Altar Relief in the
Cathedral of Oviedo, Spain , Hagiographica , V (1998), pp.
141-148
M. Görlach, Studies in Middle English Saints’ Legends , Heidelberg
1998
La ‘Légende dorée’ de Jacques de Voragine: le livre qui fascinait le Moyen
Age , ed. B. Fleith et alii, Genève 1998
1999
E. Colomer Amat, El ‘Flos Sanctorum’ de Loyola y las distinctas ediciones
de la ‘Leyenda de los santos’. Contribución al catálogo de Juan Varela de
Salamanca , in Analecta sacra Tarraconensia , LXXII (1999), pp.
109-142
R. Schnell, Kostanz und Metamorphosen eines textes. Eine überlieferungs
und geschlechtergeschichlicheStudie zur volkspredichten Rezeption von Jacobus
de Voragine , in Frühmittelelterliche Studien , XXXIII (1999),
pp. 319-395
2000
M. Balzert, Ein Carmen sapphicum in der Legenda-Aurea-Appendix ,
in Hagiographie im Kontext. Wirkungsweisen und Möglichkeiten historischer
Auswertung, ed. D. R. Bauer - K. Herbers, Stuttgart, 2000, pp. 000-000
K. Jansen, The Making of the Magdalen: Preaching and Popular Devotion in
the later Middle Ages , Princeton 2000, pp. 000-000
2001
Il Paradiso e la terra. Iacopo da Varazze e il suo tempo , Atti del
Convegno Intern. di Studio, Varazze 24-26 sett. 1998, a cura di S. Bertini
Guidetti, Firenze 2001
De la saintété à l’hagiographie. Genèse et usage de la ‘ Légende
dorée’ , ed. B. Fleith – F. Morenzoni, Genève 2001
P. Di Pietro Lombardi - M. Ricci – A. R. Venturi Barbolini, ‘ Legenda
aurea’: iconografia religiosa nelle miniature della Biblioteca estense universitaria ,
Modena 2001
D. D’Avray, Medieval Marriage Sermons: Mass Comunication in a Culture
without Print , Oxford 2001, pp. 000-000
2002
G. P. Maggioni, La trasmissione dei legendari abbreviati del XIII
secolo , in Filologia Mediolatina , IX (2002), pp. 87-107
2003
G. P. Maggioni, Parola taciute, parole ritrovate. I racconti agiografici
di Giovanni da Mailly, Bartolomeo da Trento e Iacopo da Varazze , in Le
riscritture agiografiche , Atti del V Convegno della SISMEL, Firenze 22-23
marzo 2002, Hagiographica , X (2003), pp. 00-00.
SOURCE : http://www.sermones.net/node/23
The Golden Legend, by Blessed Jacobus de Voragine : https://catholicsaints.info/the-golden-legend-by-blessed-jacobus-de-voragine/

_03.jpg)
_04.jpg)
_01.jpg)
_05.jpg)
_03.jpg)
-chiesa_nativit%C3%A0_maria-gruppo_ligneo.jpg)


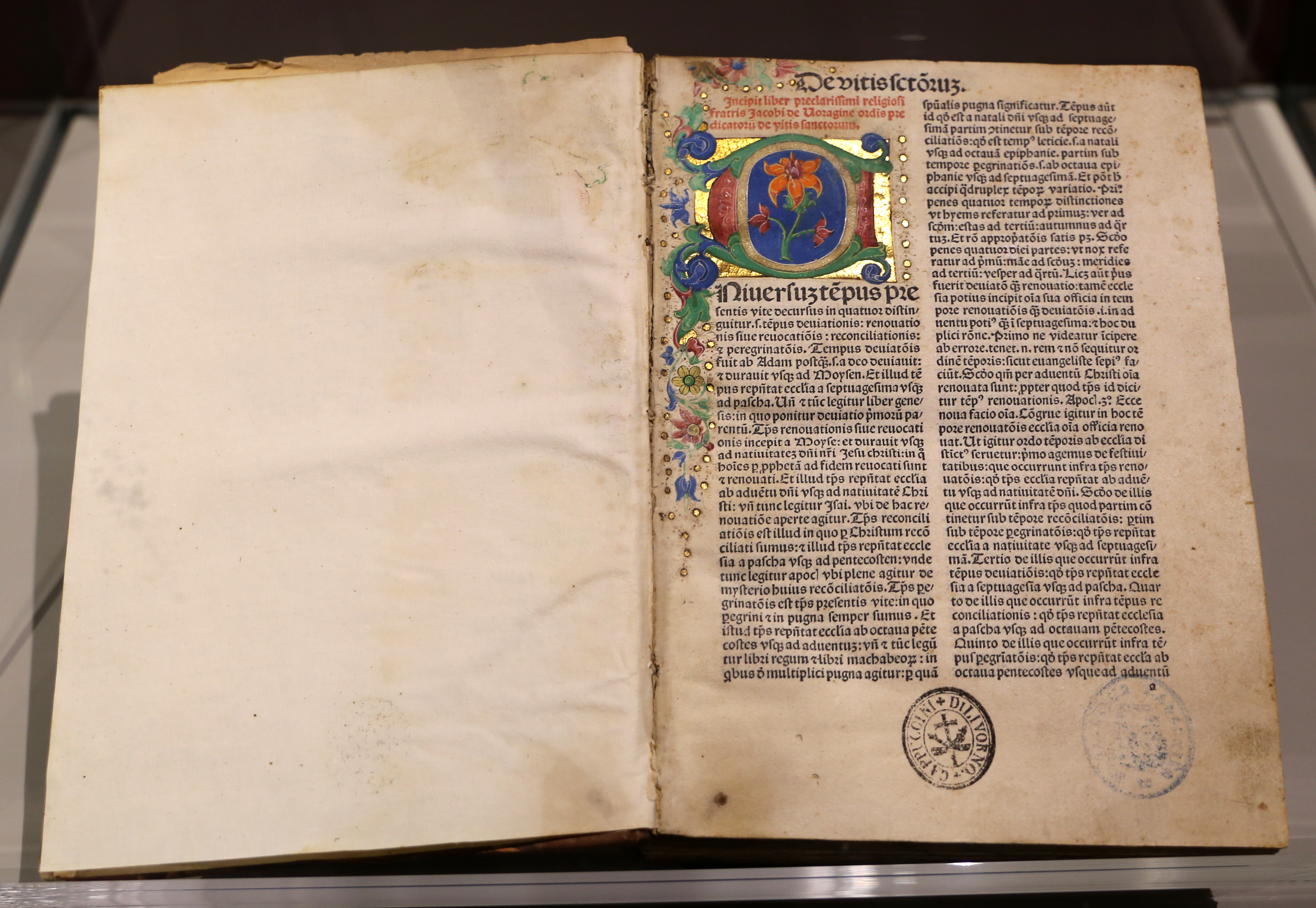


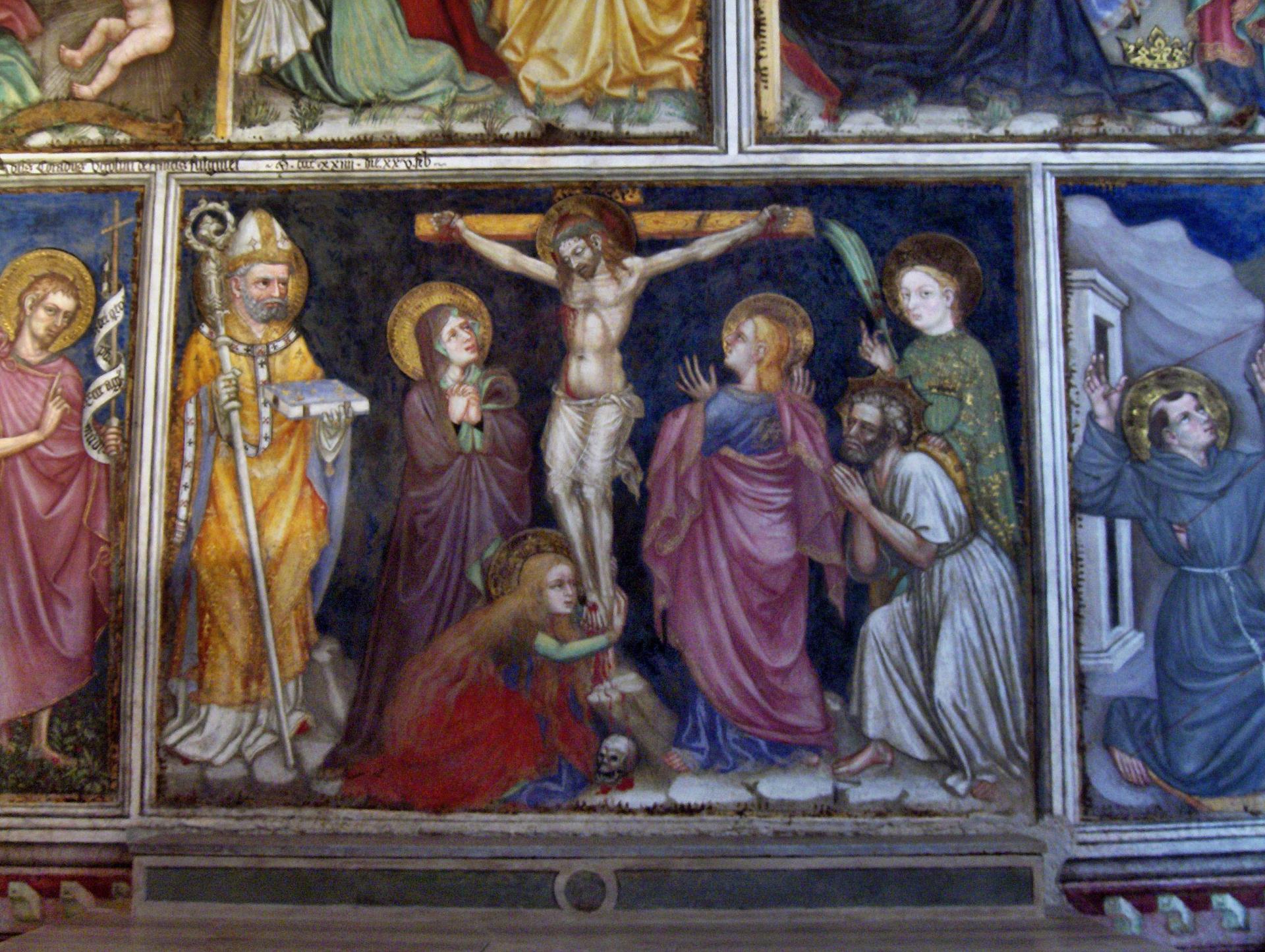
.jpg)
-cappella_Beato_Jacopo-facciata.jpg)
-cappella_Beato_Jacopo-interno.jpg)



