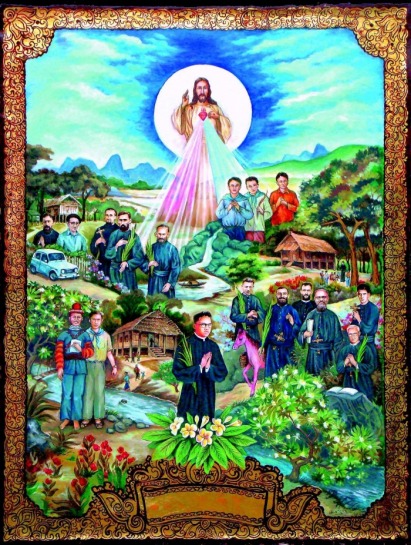Bienheureux Noël Tenaud
Martyr au Laos (+ 1961)
Noël Tenaud, M.E.P., né
en Vendée en 1904, mort à Savannakhet en 1961.
En avril-mai 1961, dans
la province de Xieng Khouang, les PP. Louis Leroy, Michel
Coquelet et Vincent
L’Hénoret sont cueillis à leur poste et abattus sans procès. De même
dans le sud du pays, le P. Noël Tenaud et son fidèle catéchiste Outhay sont
pris et exécutés; le P. Marcel
Denis sera retenu prisonnier quelque temps mais partagera le même
sort. Un de leur confrères écrit: "Ils ont été, tous, d’admirables
missionnaires, prêts à tous les sacrifices, vivant très pauvrement, avec un
dévouement sans limite. En cette période troublée, nous avions tous, chacun
plus ou moins, le désir du martyre, de donner toute notre vie pour le Christ.
Nous n’avions pas peur d’exposer nos vies; nous avions tous le souci d’aller
vers les plus pauvres, de visiter les villages, de soigner les malades, et
surtout d’annoncer l’Évangile…"
Noël Tenaud est né le 11
novembre 1904 à Rocheservière, dans le diocèse de Luçon en Vendée (France). De
1924 à 1928, il est au Grand Séminaire diocésain, puis rejoint celui des
Missions Etrangères de Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1931, il est envoyé à
la 'Mission du Laos ', dont la partie principale est alors au Siam. Ses années
comme curé à Kham Koem (Thaïlande) ont laissé un souvenir vivant.
La guerre franco-siamoise
(1939-1940) l’amène au Laos proprement dit. A partir de 1944, il est curé de
Pong Kiou (Khammouane) et rayonne dans toute la région. Son action, notamment
au cours de divers épisodes belliqueux contre la tyrannie japonaise et la
mainmise des troupes communistes, marque profondément les chrétientés de la
minorité Sô. Il accepte aussi, dans les situations difficiles, des
responsabilités de plus en plus lourdes dans l’organisation de la mission.
En 1959, le P. Tenaud
accepte de quitter sa belle région pour l’arrière-pays de Savannakhet, où le
travail de première évangélisation n’a pas encore commencé. Basé à Xépone, près
de la frontière du Vietnam, avec son fidèle catéchiste Joseph Outhay, il
prospecte les villages tout au long de la route qui monte de Savannakhet.
En avril 1961, les deux
apôtres partent en tournée apostolique. On les avertit qu’une attaque
nord-vietnamienne se prépare; mais rien ne doit arrêter la Parole de Dieu. Le
chemin du retour est coupé: ils sont pris au piège, arrêtés, interrogés et
exécutés le 27 avril 1961 pour leur action missionnaire. Chez tous ceux qui
l’ont connu, le souvenir du P. Noël Tenaud, de son œuvre missionnaire et du don
suprême de sa vie, est resté très vivant.
(présentation des 17 martyrs du Laos, Missions
étrangères de Paris)
Il fait partie des martyrs
au Laos entre 1954 et 1970 qui seront béatifiés en 2016.
Liens utiles:
- Noël Tenaud
(1904-1961), prêtre des Missions Étrangères de Paris envoyé au Siam en 1931,
Noël Tenaud est assassiné avec son catéchiste Joseph Outhay Phongphumi le 27
avril 1961 - site OMI, province de France
- Le
Vatican reconnaît les martyrs du Laos
- Présentation des martyrs du Laos
SOURCE : http://nominis.cef.fr/contenus/saint/13038/Bienheureux-No%EBl-Tenaud.html
TENAUD Noël (1904-1961)
né le 11 novembre 1904 à Rocheservière (Vendée), fut admis au Séminaire des
M.-E. en 1928, ordonné prêtre le 29 juin 1931, et partit le 7 septembre suivant
pour le Laos. Après avoir étudié la langue à Tharae de 1932 à 1934, il fut curé
de Khamkeum de 1934 à 1940, puis curé de Nam Tok de 1940 à 1943, et de
Phongkiou, en 1944. Après la division de la mission en 1951, il fut nommé
pro-préfet de la préfecture apostolique de Thakhek. En avril 1961, au cours
d’une tournée pastorale entre Savannaket et Tchépone, il fut arrêté par les
soldats du Vietminh, puis remis aux Pathet-lao, près de Phalane. Il fut alors
emmené par un peloton de soldats, et on ne le revit jamais.
SOURCE : http://archives.mepasie.org/fr/notices/notices-biographiques/tenaud-1
Noël Tenaud (1904-1961)
Enfance vendéenne
Noël TENAUD est né
le 11 novembre 1904 à Rocheservière en Vendée ; il y fut baptisé en l´église
Notre-Dame dès le lendemain. Le bourg de Rocheservière est proche de Nantes
mais appartient au diocèse de Luçon . C´est la Vendée, terre de foi chrétienne
profonde et démonstrative où s´est développée, à la fin du XVIIIè siècle, une
résistance farouche à la Révolution française. Très jeune, Noël a été nourri de
cette histoire encore récente, dont les souvenirs sont partout : luttes sans
merci contre les révolutionnaires impies, massacres de prêtres et de religieux,
mais aussi de chrétiens fidèles à leur clergé, et même d´enfants. Les symboles
de la résistance sont la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus et le Rosaire.
Tout naturellement, comme
de nombreux garçons de cette région, Noël souhaite devenir prêtre. Il fera donc
ses études secondaires au Petit Séminaire de Chavagnes-en-Paillers. Il est
admis ensuite au Grand Séminaire de Luçon, où il étudie de 1924 à 1928.
À cette époque de
vocations abondantes, les missionnaires passent régulièrement dans les
séminaires pour promouvoir leur vocation particulière. Noël entend l´appel des
Missions et décide de le suivre. Le 14 septembre 1928, il passe au Séminaire
des Missions Étrangères de Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1931, il part le 7
septembre suivant pour la « Mission du Laos », dont la partie principale est
alors située au Siam (Thaïlande).
Au Siam et au Laos,
persécutions et guerres
Après deux années
(1932-1934) à Tharae au Siam, consacrées surtout à étudier la langue lao, Noël
est nommé curé de Kham Koem, une chrétienté bien établie proche de Nakhon
Phanom ; il y restera six ans. C´est là qu´il fait la connaissance d´un jeune
garçon qui deviendra plus tard son collaborateur et ami, Outhay ; devenu
catéchiste, et veuf à vingt ans, Outhay le suivra au Laos, l´accompagnant dans
toutes ses tournées apostoliques et jusque dans la mort.
Le rapport de la mission
pour 1939 évoque indirectement le travail du Père Tenaud à l´époque de Kham
Koem :
M. Thibaud a visité un
grand nombre de villages païens de la région de Thakhek, et, s´il n´a pas eu un
succès immédiat partout où il a prêché l´Évangile, il a du moins le ferme
espoir que la semence de la parole divine n´aura pas été jetée en vain. Ce
qu´il a fait dans son district, deux prêtres indigènes et M. Tenaud l´ont fait
comme lui dans une autre région. Une légende laotienne dit qu´il fut un temps,
et c´était l´âge d´or, où le riz venait tout seul au grenier ; ce temps n´est plus.
Les missionnaires du Laos doivent courir par monts et par vaux pour amener les
âmes au grenier du bon Dieu, et je vois avec plaisir que les ouvriers
apostoliques y travaillent avec une ardeur infatigable...
En novembre 1940, la
persécution éclate au Siam - qui s´appelle désormais Thaïlande. À quelques
dizaines de kilomètres de Kham Koem, les martyrs de Songkhon offriront à Dieu
les prémices de la mission. Quant aux missionnaires français, ils doivent
chercher refuge de l´autre côté du Mékong, au Laos, sous la protection de la
France.
Dans ce nouveau
territoire de mission, le Père Tenaud est affecté d´abord à la mission de Nam
Tok, où il restera trois ans (1940-1943). Mais c´est l´époque troublée de la
Seconde Guerre mondiale ; il passera une année d´exil (1943-1944) au Viêt-nam,
au Collège de la Providence à Hué. À son retour, il devient curé de Pongkiou,
une chrétienté importante de la minorité ethnique Sô, dans la Province de
Khammouane. En mars de l´année suivante, c´est le coup de force de l´armée
japonaise, qui entraîne le massacre de civils français et la ruine de
nombreuses missions. Trois confrères des Missions Étrangères de Paris - les
deux évêques présents à Thakhek, Mgr Gouin et Mgr Thomine, et le Père Jean
Thibaud - sont emmenés en forêt sans autre forme de procès et sauvagement
abattus.
Chez le Père Noël Tenaud,
ces événements, qu´il considère comme une persécution religieuse aux mains des
impies, provoquent un déclic. Son enfance vendéenne avait été nourrie des
récits de la résistance contre la persécution déchaînée par les
révolutionnaires français. Il voit se reproduire ici l´assassinat des prêtres,
la mort des innocents, l´intrusion d´une idéologie athée. Il n´est pas homme à
rester passif ; il se laissera inspirer par ce que Jacques Cathelineau,
surnommé « le Saint de l´Anjou », avait fait naguère en Vendée.
Il sera donc, non
seulement proche du mouvement de résistance franco-laotien contre les Japonais,
mais bien l´un de ses protagonistes. Dans la défense armée il voit la sauvegarde
indispensable, et des hommes, et de l´oeuvre d´évangélisation qu´ils doivent
accomplir. Il faut dire qu´il a montré en cette circonstances des qualités de
chef indéniables. La milice villageoise qu´il mit sur pied, comprenant des Sôs
et d´autres Laotiens des villages environnants, était bien organisée. Quand
l´armée française - ou franco-laotienne selon le vocabulaire utilisé - revint
pour rétablir progressivement l´ordre français dans un pays en pleine
confusion, cet apport fut hautement apprécié. Le Père Tenaud fit cause commune
avec son commandement ; il en restera proche même par la suite. Son action lui
vaudra d´ailleurs la Légion d´honneur.
Le Père Marcel Denis,
m.e.p., arrivé au Laos l´été 1946, a recueilli de la bouche même du Père Tenaud
le récit de ses exploits aux dépens des Japonais, où il faut sans doute voir
quelque exagération :
"Presque tous les
ponts, que le Père Tenaud avait fait sauter lui-même pour couper la route aux
Japonais, alors qu´il guerroyait avec ses villages chrétiens, sont réparés...
Avec un autre Père, il a pris la brousse quand les Japonais ont arrêté tous les
Français. Mais le Père Tenaud a vraiment été le héros, parcourant tout le Haut
et le Bas Laos, à pied ; ou parachutant des soldats français dans des avions
anglais ; ou traquant les Japonais avec ses villages chrétiens. Lors de la
prise de Thakhek en mars dernier, il était là, commandant ses Laotiens et ses
Sôs. Aussi son renom et son influence sont très grands parmi les officiers
français du haut en bas de l´échelle. Quand à ses chrétiens, il peut leur
demander la lune, ils feraient l´impossible pour la lui décrocher."
Le Père Denis conclut par
cette réflexion :
"À ceux qu´il
destine à être ses apôtres, Dieu donne souvent, avec la soif du salut des âmes,
le goût du risque, le mépris des boîtes à coton et des coins « bien
tranquilles."
Il est évident qu´à cette
date les missionnaires (y compris le narrateur et son auditeur attentif) n´ont
pas compris que l´ère des colonies est en train de s´achever. Le combat pour
Dieu se mêlait - se confondait presque - avec le combat pour la légitimité
française. La condamnation officielle par Rome de l´idéologie révolutionnaire,
qui s´était affirmée au Laos avec la complicité des Japonais, renforçait encore
l´amalgame. Pour ces hommes, la séparation entre la foi et l´action politique
et militaire exigera une prise de conscience et une purification progressives.
Un épisode moins glorieux
doit être mentionné ici : la prise de Thakhek le 21 mars 1946. Cette ville
était peuplée d´une très forte majorité (83% peut-être) de Vietnamiens («
Annamites » dans le vocabulaire de l´époque) dont la plupart avait acclamé l´indépendance
du Viêt-nam proclamée unilatéralement le 2 septembre 1945 contre la France. Les
chefs historiques du front indépendantiste Lao-Issara, proches alliés du
Viet-minh, trouvèrent là un appui très important. C´est donc à Thakhek qu´ils
tentèrent en octobre 1945 un soulèvement anti-français ; ils purent y maintenir
pendant plus de cinq mois une poche entièrement sous le contrôle de leur «
Armée de libération et de défense lao », dont six cent « volontaires de la mort
». L´assaut final par les troupes franco-laotiennes fut sanglant et occasionna
une répression terrible.
Le Père Denis poursuit,
toujours d´après le récit oral de Noël Tenaud :
"Le 21 mars 1946
vint enfin la libération de Thakhek. À la tête de leurs Laotiens, les Pères
Tenaud et Cavaillier entrent dans Thakhek avec les parachutistes français...
C´est alors une journée épouvantable. Français et Laotiens entrent dans Thakhek
en hurlant comme des possédés, le massacre commence... Le Mékong devient
rouge... Officiellement, on compte 1 500 Annamites, hommes femmes et enfants
(!) massacrés. En réalité, il y en eut plus de 3 000 !..."
Le Père Noël Tenaud et
son confrère Cavaillier n´ont certes été ni les promoteurs ni les complices du
massacre de populations civiles ; mais il faut sans doute reconnaître qu´ils
ont été en l´occurrence débordés par les combattants qu´ils encadraient ! Il
est difficile encore aujourd´hui de trouver des témoignages directs sur
l´action du Père Tenaud en mars 1946 ; mais c´est un fait que ses supérieurs et
les chrétiens locaux ont continué à lui faire pleine confiance comme homme de
Dieu, témoin de la béatitude des artisans de paix.
Un long congé en France,
de mars 1947 à décembre 1948, permettra au Père Tenaud de prendre
définitivement ses distances avec la vie militaire.
Reconstruire la paix et
la concorde
Au sein de la mission
catholique du Laos, la guerre achevée, c´est l´enthousiasme. La soeur de Mgr
Thomine, un des missionnaires sauvagement massacrés par les Japonais, écrit
dans l´éloge funèbre de son frère :
Cette parole m´a été dite
de vive voix par deux missionnaires laotiens, MM. Tenaud et Mainier, avec la
même conviction absolue : « Mgr Thomine nous a promis de rebâtir l´Église du
Laos, donc nous la rebâtirons ! » Car ils savent la puissance d´une volonté pour
qui l´accomplissement du devoir en Dieu a seul compté sur la terre, force
spirituelle maintenant directement associée à la volonté éternelle. De fait,
les ruines du Laos se relèvent, les chrétientés refleurissent, de jeunes
missionnaires sont venus seconder les anciens et remplacer les morts...
En 1947, Mgr Bayet
succède à Mgr Thomine comme vicaire apostolique à Tharae ; il nomme le Père
Tenaud pro-vicaire et vicaire délégué pour la partie du vicariat située dans le
protectorat (futur Royaume) du Laos. Noël occupera ce poste de son retour de
congés jusqu´en juillet 1951. Après la création de la préfecture apostolique de
Thakhek, confiée à Mgr Jean Arnaud, il en est nommé pro-préfet (1951-1958).
La paix et la
reconstruction se révélèrent toutefois des tâches difficiles. Dans les
opérations de la guérilla autour de la ville de Thakhek, la veille de Noël
1953, la vie de Noël Tenaud est menacée : il était sans doute trop mêlé, une
fois de plus, à la résistance. Selon un rapport de la mission daté de 1954, à
quelque trente kilomètres de Thakhek on pouvait voir encore les trous des deux
mines qui lui étaient destinées. Mais il eut la vie sauve, et échappa aussi au
sort du groupe arrêté le 15 février 1954 et déporté au Viêt-nam, dont Mgr
Arnaud, le Père Jean-Baptiste Malo, deux autres confrères m.e.p. et une
religieuse. Il fut alors supérieur par intérim des missionnaires de Paris et
procureur de la Mission. Mais dans toutes ces circonstances il restait avant
tout le curé de Pongkiou, le missionnaire bien-aimé et admiré des Sôs.
Portrait d'un
missionnaire
Dans les dernières années
de sa vie, après l´indépendance totale du Laos et la reconnaissance
internationale du pays, dégagé de ses propres responsabilités sur l´ensemble de
la mission, Noël Tenaud fut un missionnaire de base particulièrement dynamique
et apprécié. À Thakhek il était connu pour rechercher dans toute la ville, au
cours de ses fréquents passages, les chrétiens sortis des villages et perdus au
milieu de la population urbaine.
Dans son texte de 1946
déjà cité, le Père Marcel Denis évoque son confrère et mentor :
"Partons pour le
village du Père Tenaud, Pong Kiou... Le Père cause avec tout le monde, fait
rire tout le monde. Il a ses gens bien en main ; il est le grand maître dans
toute la région, et il s´impose même chez les païens... Un fameux missionnaire
que le Père Tenaud. C´est un Vendéen ; énorme barbe noire, visage bronzé,
toujours pieds nus, un chapeau militaire sur la tête. Avec le Père Dézavelle,
c´est le plus grand blagueur. Mais à le fréquenter on voit vite quel bon sens,
quelle foi, quelle largeur d´esprit et dévouement l´animent. Il a la sympathie
de tous ses paroissiens et de tous les villages environnants... Il sait leur «
passer un savon » sans se les aliéner, et après une bonne ballade, l´entretien
se termine par de bonnes blagues qui font avaler la pilule. Des païens
insultent-ils des chrétiens parce que chrétiens ? Le différend est vite réglé,
et les coupables font des excuses et paient une jarre qui réconcilie offensés
et offenseurs, sous le regard du Père qui met tout le monde à l´aise."
De nombreuses années plus
tard, Mgr Urkia témoigne :
"Le Père Tenaud
était un vrai, un très bon missionnaire. Il était assez exigeant pour ses
chrétiens, et il avait un grand amour en particulier pour les non-chrétiens. Il
était profondément préoccupé des catéchumènes, ou plus simplement des Laotiens
qui avaient montré quelque désir de connaître la foi chrétienne. À l´époque de
sa mort, il ne supportait pas de les voir délaissés, abandonnés, à cause de
l´insécurité qui rendait les voyages dangereux. Il a voulu à tout prix partir à
leur rencontre, malgré le danger."
Mgr Bach complète :
"Le Père Tenaud avait une foi solide. Il était cependant un peu fanfaron,
il aimait se montrer... mais il était aussi très courageux." Marcel
Vignalet, m.e.p., évoque simplement l´amitié vraie dont Noël témoignait envers
ses confrères missionnaires plus jeunes.
Selon un témoin laotien,
qui fut à Pongkiou un de ses catéchistes débutants, le Père Tenaud était aimé
des gens parce qu´il excellait à les soigner. Ses connaissances médicales
étaient bonnes. Ses jeunes collaborateurs avaient un peu peur de lui : en
effet, il était très strict sur la discipline et les horaires, un peu à la
manière militaire, et pouvait à l´occasion parler durement. Il ne cherchait pas
à être populaire.
Une mission dangereuse au
service des plus lointains
En juin 1958 le Père
Tenaud partit en congé en France. À son retour en juillet 1959, il avait 55
ans. Avec beaucoup de désintéressement, il accepta une paroisse qui n´existait
pas encore, dans une province vide de tout chrétien, où le travail
d´évangélisation n´avait jamais été commencé. Basé à la mission centrale de
Savannakhet, il allait prospecter les villages tout au long de la route n° 9 en
direction de la frontière du Viêt-nam, ayant le ferme espoir de créer sur ces
hauts plateaux une chrétienté nouvelle.
Il sut se créer beaucoup
de sympathies dans la région de Phalane, Muang Phine et Muang Xepone (Tchépone)
; c´est dans ce dernier bourg qu´il loua une maison pour lui servir de base.
Les quelques dizaines de familles catholiques aujourd´hui dispersées le long de
la route n° 9 sont le fruit de son travail ; ils avaient une petite église en
forme de hutte, mais les temps ont changé...
La région que le Père
Tenaud avait prise en charge était depuis toujours réputée peu sûre. Sur la
route, il rencontrait des soldats de la guérilla ; il n´avait pas peur de les
prendre en auto-stop dans sa jeep. Cela a fini par se savoir : les soldats ont
vraisemblablement fait leur rapport sur ses allées et venues. Le jour venu, il
a été facile de lui tendre un piège.
Le Père Tenaud fut averti
du danger par plusieurs personnes, y compris les responsables de l´armée royale
laotienne. Il n´écouta aucun conseil : il répondait simplement qu´il
connaissait ceux de la guérilla, et qu´il n´y avait pas lieu d´en avoir peur.
Le dernier voyage
En avril 1961, Noël
Tenaud part avec son fidèle catéchiste Outhay et un tout jeune chrétien de
Pongkiou, sourd-muet, pour une tournée des villages de catéchumènes qui lui
étaient confiés. En même temps, la guérilla entamait une avance-éclair, au cours
de laquelle elle allait s´emparer de tout ce secteur.
Il s´arrête au passage au
camp de Seno (Xenô) ; les militaires français l´avertissent qu´une attaque
nord-vietnamienne se prépare sur la zone où il devait se rendre et lui
déconseillent formellement de poursuivre. Plus loin sur la route, un pasteur
protestant qui rentrait de Xepone lui confirme la mauvaise nouvelle. Le Père
Tenaud poursuit malgré tout son périple, et arrive dans le secteur de
l´offensive ; finalement il rebrousse chemin. Mais la route du retour avait été
coupée au-delà de Phalane, à une cinquantaine de kilomètres de Savannakhet.
Les trois voyageurs se
réfugient alors dans un village en retrait de la route. Trahis par les
villageois, il sont arrêtés par les soldats nord-vietnamiens, qui leur
enjoignent de retourner à Phalane. Sur le chemin entre Muang Phine et Phalane,
ils tombent dans une embuscade : des Vietnamiens sont tués, le Père est blessé
au jarret, le catéchiste Outhay au cou. On les ramène à Phalane, où
l´administration provisoire vient d´être mise en place. Ils y sont soignés
durant huit jours et se remettent de leurs blessures. Le gamin sourd-muet est
relâché ; c´est lui qui rapportera la nouvelle des événements.
La semaine achevée, le
Père Tenaud demande à l´administration provisoire établie dans la zone «
libérée » de pouvoir rentrer à Savannakhet avec Outhay. Des témoins les voient
sortir du bureau de l´administration et se mettre en route à pied, accompagnés
d´un peloton de soldats. On ne les a jamais vus revenir à Phalane, et on ne les
a jamais vus arriver à Savannakhet. Des bruits alarmants circulèrent tout de
suite sur leur compte. La maison du Père Tenaud à Phalane fut pillée de fond en
comble et criblée de balles ; sa voiture fut retrouvée complètement détruite. Quelqu´un
déclarera avoir vu sa tombe.
En 1963 des témoignages
très divers permirent de conclure avec certitude que, ayant donné sa vie pour
la mission, Noël Tenaud était retourné vers le Père. Son décès a alors été
enregistré par la Société des Missions Étrangères à la date fictive du 15
décembre 1962. Cette date a toutefois été rectifiée par la suite : un avis
officiel de l´ambassade de France au Laos, daté du 19 avril 1967, la fixe
définitivement au 27 avril 1961.
Pourquoi cette mort
brutale ?
Pourquoi le P. Noël
Tenaud a-t-il été tué ? Certains parmi ses confrères pensent qu´il a été
condamné parce qu´il avait été compromis, et cela se savait très largement,
dans les affaires politiques et militaires. Toutefois, si l´on rapproche sa
mort de celle des trois Oblats tués dans la région de Xieng Khouang exactement
à la même période (18 et 20 avril et 11 mai 1961), la conclusion est différente
: il faut penser à un plan d´ensemble de la guérilla concernant les
missionnaires isolés dans les zones qu´elle contrôlait.
Par ailleurs, Mgr Bach
atteste qu´en 1961, le Père Noël Tenaud n´avait avec les Français que des
rapports de bon voisinage. Il en voit pour preuve que l´Ambassade de France au
Laos ne s´est jamais occupée de rien à la mort de Tenaud et de ses confrères,
alors qu´elle suivait de près ce qui pouvait arriver à d´autres Français.
L´indépendance des missionnaires par rapport à leur pays d´origine a été
reconnue en 1975 par le nouveau régime lui-même, malgré une certaine confusion
dans l´esprit des dirigeants : la présence des missionnaires a été tolérée dans
le pays six mois environ après que tous les autres Français aient été expulsés.
En somme, ceux qui ont
tué le Père Tenaud n´ont peut-être pas agi directement en haine de la foi ;
mais ils ont certainement agi en haine de la présence de l´Église catholique au
Laos. Les dirigeants de la guérilla, formés au Viêt-nam, étaient motivés pour
arrêter coûte que coûte la progression du christianisme dans le peuple laotien.
Leur conviction était que, une fois les missionnaires « ennemis du peuple »
partis ou éliminés, il serait facile de détourner le peuple de la foi pour
l´attacher à la nouvelle idéologie.
De même, au témoignage
d´un catéchiste, les causes de la mort du Père Tenaud ne sont pas à chercher du
côté de ses options politiques ou de ses liens avec les militaires. Pour ceux
qui furent ses collaborateurs laotiens, le Père Tenaud est un vrai martyr : il
a certainement montré qu´il avait le courage de vivre sa foi jusqu´au bout.
Le sens profond de sa
mort
Pourquoi le Père Noël
Tenaud est-il allé au-devant de la mort ? Mgr Bach répond :
"Le Père Donjon,
m.e.p., son supérieur, lui avait recommandé de ne pas partir dans les zones
dangereuses. Mais pour lui le souci des catéchumènes laissés à eux-mêmes a été
plus fort. On peut certainement parler d´imprudence, mais tous les martyrs
n´ont-ils pas été de même de grands imprudents ? Le Christ, quand il est monté
à Jérusalem en dépit des menaces et malgré les recommandations de ses
disciples, n´a-t-il pas été lui-même un exemple d´imprudence ?"
En embrassant d´un même
regard les autres missionnaires m.e.p. morts de mort violente au Laos dans les
années 1960, le même témoin poursuit :
"Je suis certain que
les Pères Denis et Galan ont donné des signes qu´ils acceptaient la mort
librement, à cause de leur foi ; ils l´ont fait tout simplement. Je suis sûr
que le Père Tenaud l´a fait aussi à sa manière, même si cela a été un peu en
fanfaron. Tous, ils ont montré qu´ils avaient choisi de suivre le Christ, de
servir le peuple de Dieu, quoi qu´il arrive. Ils sont morts courageusement,
héroïquement, pour être fidèles à cette option fondamentale de leur vie."
"Je suis intimement
convaincu que les Pères Denis, Tenaud et Galan sont des martyrs, c´est-à-dire
des hommes, des prêtres et des missionnaires héroïques qui ont offert leur vie
courageusement pour leur foi, et qui ont vraiment suivi le Christ jusque dans
la mort. Je suis certain aussi que ceux qui les ont connus et ont entendu
parler d´eux partagent cette même conviction."
"Pour quelques-uns
toutefois, la conviction est peut-être un peu moins forte à propos du Père
Tenaud. Il faut dire que les réserves à son sujet n´existent pas chez le peuple
chrétien, les prêtres et les religieuses laotiens, mais plutôt chez quelques
confrères français."
"Quant aux
non-chrétiens du Laos, je pense que le souvenir de la présence des
missionnaires, et de la mort violente de certains, s´est estompé et que l´on ne
fait plus guère mention d´eux."
"La réputation de
martyrs des Pères Denis, Tenaud et Galan a commencé dès le moment de leur mort
et ne s´est jamais démentie. Elle est revenue fortement sur le devant de la
scène - avec d´autres - en 1989, au moment de la béatification des martyrs de
Songkhon (Thaïlande), qui étaient des chrétiens laotiens."
"Il m´arrive souvent
de m´inspirer de l´exemple de ces « martyrs » du Laos : le Père Tenaud pour son
courage, et les autres, en toute simplicité, pour toute leur vie. [...] Je suis
convaincu que leur exemple inspire le courage d´autres chrétiens."
"Comme je l´ai dit,
il m´arrive de demander l´intercession auprès de Dieu de nos « martyrs » du
Laos, de façon collective, sans privilégier tel ou tel. De même, je peux aussi
attester qu´un peu partout au Laos on fait mention d´eux après chaque
messe."
Le témoignage de Mgr
Urkia est concordant :
"Je considère sans
hésiter le Père Tenaud comme un martyr. Pour moi, le Père Tenaud a choisi de
suivre cet exemple du Christ jusqu´au bout, quoi qu´il arrive."
SOURCE : http://oblatfrance.com/index.php?id_page=261
Brève présentation des 17
martyrs du Laos
10/06/2015
Le 10 novembre 1994, dans
le cadre de la préparation du Jubilé de l’an 2000, le pape Jean-Paul II
publie Tertio Millennio Adveniente, lettre apostolique par laquelle il
appelle à préserver la mémoire des martyrs du XXe siècle. Les évêques du Laos
demandent alors aux Missions Étrangères de Paris (MEP) et aux Oblats de Marie
Immaculée (OMI) de les aider à rechercher les documents nécessaires.
Plus de vingt ans plus
tard, leur démarche a abouti. Ce 5 juin, le
pape a signé le décret que lui présentait le cardinal Angelo Amato,
préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Le pape François a signé
la promulgation des décrets relatifs au martyre de 17 prêtres et laïcs tués au
Laos entre 1954 et 1970. Afin de mieux connaître ces martyrs, Églises
d’Asie publie les documents ci-dessous, rédigés dans le style
hagiographique propre à ce type de littérature.
Au printemps 1953, la guérilla occupe la province laotienne de Sam Neua ; les
missionnaires ont été évacués. Le jeune prêtre Joseph Thao Tiên, ordonné en
1949 a décidé pour sa part : « Je reste pour mon peuple. Je suis prêt à
donner ma vie pour mes frères laotiens. » Quand on l’emmène vers le camp
de Talang, les gens se mettent à genoux sur son passage en pleurant. Il dit
: « Ne soyez pas tristes. Je vais revenir. Je m’en vais étudier...
Continuez à faire progresser votre village… » Un an plus tard, le 2 juin
1954, il est condamné à mort et fusillé : il avait refusé, une fois de plus,
d’abandonner son sacerdoce et de se marier.
Entre temps, à l’autre
bout du pays, le P. Jean-Baptiste Malo, ancien missionnaire en Chine, avait été
arrêté avec quatre compagnons. Il mourra bientôt d’épuisement et de mauvais
traitements sur le chemin des camps, en 1954 dans une vallée perdue du
Viêtnam. En 1959, son confrère des Missions Étrangères René Dubroux, ancien
prisonnier de guerre en 1940, est trahi par un proche collaborateur et éliminé
par la guérilla, qui le balaie comme un obstacle dérisoire à leur volonté.
Cette année-là le Saint-Siège avait donné la consigne : « Le clergé, ainsi
que le personnel auxiliaire religieux (excepté naturellement les vieillards et
malades) doit rester à son poste de responsabilité, à moins qu’il ne vienne à
être expulsé. »
Les missionnaires
adoptent avec joie cette consigne, qui signe l’arrêt de mort pour plusieurs
d’entre eux. En 1960, le jeune catéchiste hmong Thoj Xyooj et le P. Mario
Borzaga ne rentrent pas d’une tournée apostolique. En avril-mai 1961, dans la
province de Xieng Khouang, les PP. Louis Leroy, Michel Coquelet et Vincent L’Hénoret
sont cueillis à leur poste et abattus sans procès. De même dans le sud du pays,
le P. Noël Tenaud et son fidèle catéchiste Outhay sont pris et exécutés ; le P.
Marcel Denis sera retenu prisonnier quelque temps mais partagera le même sort.
Un de leur confrères écrit : « Ils ont été, tous, d’admirables
missionnaires, prêts à tous les sacrifices, vivant très pauvrement, avec un
dévouement sans limite. En cette période troublée, nous avions tous, chacun
plus ou moins, le désir du martyre, de donner toute notre vie pour le Christ.
Nous n’avions pas peur d’exposer nos vies ; nous avions tous le souci d’aller
vers les plus pauvres, de visiter les villages, de soigner les malades, et
surtout d’annoncer l’Évangile… »
En 1967, Jean Wauthier,
infatigable apôtre des réfugiés, épris de justice, champion des droits des
pauvres, est éliminé par une autre faction ; il laisse une population éperdue
de douleur : « Nous avons perdu un père ! » Jean avait regardé plus
d’une fois la mort en face. Il était prêt ; il a donné sa vie par amour pour
les siens.
En 1968, Lucien Galan,
lui aussi ancien missionnaire de Chine, visite les catéchumènes isolés du
plateau des Boloven. Son jeune élève Khampheuane, 16 ans, a tenu à
l’accompagner en raison du danger. Au retour de leur mission, on leur a tendu
un guet-apens ; tous deux meurent sous les balles ; leur sang se mêle pour
féconder la terre du Laos. L’année suivante c’est le tour du P. Joseph Boissel,
le doyen des martyrs du Laos (60 ans), d’être pris en embuscade en route vers
une petite communauté chrétienne, et exécuté comme eux.
Début 1970, le jeune
catéchiste Luc Sy est envoyé en mission par son évêque dans la région de Vang
Vieng. Avec un compagnon, Maisam Pho Inpèng, ils sont en tournée dans un
village où plusieurs familles sont devenues catéchumènes. Ils catéchisent et
soignent les malades, s’attardent… On les attendait à la sortie du village. Eux
aussi meurent, en plein élan missionnaire, pour le Christ et pour le peuple de
Dieu. Tous deux étaient chefs de famille.
Laotiens et étrangers, laïcs ou prêtres, ces dix-sept hommes ont donné pour l’Évangile le témoignage suprême. La jeune Église du Laos reconnaît en eux leurs Pères fondateurs. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »
Profil biographique des 17 martyrs du Laos
Joseph Thao Tiên,
protomartyr (1918-1954)
Joseph Thao Tiến est né
le 5 décembre 1918 dans la province des Houa Phanh au Laos. Son grand-père et
son père avaient déjà été des chrétiens remarquables. À onze ans, il entre à
l’école des catéchistes montagnards à Hữu Lễ, dans la province de Thanh Hóa au
Vietnam ; à cette époque, sa province d’origine appartenait en effet au
vicariat apostolique de Phát Diệm, et à partir de 1932 à celui de Thanh Hóa.
Bon élève, il est admis en 1937 à la section petit séminaire, où il étudie le
latin et le français. Il sera le seul des jeunes montagnards à passer avec
succès au grand séminaire. Vacances et stages confirment sa vocation : très
proche des gens les plus simples, catéchiste zélé et régulier, doué de ses
mains, il est apprécié des missionnaires et aimé de tous.
De 1942 à 1946 il est
élève des Pères sulpiciens au Grand Séminaire de Hanoi. Assidu à la prière et
aux études, il se tient à l’écart de l’agitation politique. À Noël 1946, c’est
la fermeture du séminaire et la dispersion. Il rentre au Laos à pied, mais la
guerre arrive là aussi. C’est à Saigon qu’il achèvera ses études. De nombreux
condisciples se souviennent avec émotion de lui, et témoignent de son
attachement indéfectible à la mission dans son pays, le Laos.
Le 6 juin 1949 il est
ordonné prêtre à la cathédrale de Hanoi. Le 1er octobre 1949, il peut
enfin rejoindre sa chère mission, à Sam Neua au Laos. Mais dès novembre, il se
retrouve au-delà de la ligne de front, en zone de guérilla. Avec l’accord avec
ses supérieurs, il y restera. La paix revenue provisoirement, il réorganise et
dirige les écoles du Muang Sôi. Mais au fond de son cœur il est pasteur. Les
gens venaient en masse pour l’écouter. Vivant la pauvreté et la précarité,
homme de vision et d’espérance, il est l’ami des pauvres et aimé de tous.
A Noël 1952, la guérilla
communiste reprend. Tout le personnel de la mission est évacué, mais Thạo Tiến
reste à son poste, « prêt à donner ma vie pour mes frères laotiens ».
Après Pâques, c’est l’arrestation, le jugement populaire, la prison et le camp
de rééducation. Isolé, résistant aux manœuvres destinées à le faire apostasier
ou abandonner sa promesse de célibat sacerdotal, seul avec le Christ souffrant
et glorieux, il est un signe d’espérance pour tous. Le 2 juin 1954, il quitte
le camp de Ban Ta Lang, escorté de quatre gardiens. Il est ligoté et abattu de
cinq balles.
Aujourd’hui, chez tous
les chrétiens laotiens, tant au pays que dans la diaspora, le nom du P. Tiến
est prononcé avec respect et invoqué avec confiance : il est le premier fruit
de leur jeune Église, les prémices qu’elle a offert à Dieu.
Le P. Jean-Baptiste Malo,
MEP (1899-1954)
Jean-Baptiste Malo est né
le 2 juin 1899 à La Grigonnais, dans le diocèse de Nantes en France. Il grandit
à Vay (44), dans une famille de petits paysans. Vocation tardive, il entre au
Séminaire des Missions Étrangères à 29 ans. Ordonné prêtre le 1er juillet 1934,
il est envoyé en mission à Lanlong (Anlong, Guizhou), en Chine.
Dans cette région
montagneuse aux confins des provinces de Guizhou, Guangxi et Yunnan, il règne
alors une grande insécurité. En dépit de grandes difficultés, toujours sur le
qui-vive, le P. Malo visite ses chrétientés, dont certaines n’ont pas vu de
prêtre depuis 20 ans ; il fonde quatre nouvelles écoles. Au printemps 1951
c’est l’arrivée des troupes communistes : il est arrêté, détenu puis, après un
jugement sommaire, expulsé de Chine affaibli et malade.
Le 27 novembre 1952, il
rejoint son nouveau champ d’apostolat : la mission de Thakhek, au Laos. A Noël
1953, les troupes vietminh progressent dans la région et l’armée française
contraint les missionnaires à s’évacuer vers Paksé, dans le sud du pays. Au
retour, le 15 février 1954, ils tombent dans une embuscade des Viêt Minh. Avec
son préfet apostolique, des confrères et une religieuse, le P. Malo fait face à
des interrogatoires.
Le groupe est emmené à
pied vers un camp de rééducation près de Vinh (Vietnam), à des centaines de
kilomètres. Le P. Malo n’arrivera pas au bout de cette marche forcée. Il est
malade et ne peut digérer le vieux riz qui sert d’unique nourriture quotidienne
aux prisonniers. Ses gardiens lui refusent tout repos et tout soin : il meurt
de faim et d’épuisement le 28 mars 1954 en offrant sa vie à Dieu. Il est mis en
terre la nuit suivante sur le bord du fleuve Ngàn Sau, dans la province de Hà
Tĩnh au Vietnam. Les chrétiens de cette région isolée, qui ont surpris
l’enterrement, ont pieusement gardé sa tombe et son souvenir jusqu’à
aujourd’hui.
Le P. Mario Borzaga, OMI (1932-1960)
Mario Borzaga est né à
Trente le 27 août 1932. A 11 ans, il entre au Petit Séminaire diocésain, puis
poursuit ses études au Grand Séminaire jusqu’à la 1e année de théologie. A 20
ans, il entre dans la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Le 21 novembre 1953, il fait ses premiers vœux à Ripalimosani (Campobasso), et
reprend ses études de théologie au scolasticat oblat de San Giorgio Canavese
(Turin). Durant quatre ans il se prépare, dans l’étude et la prière, pour la
mission ad gentes, dont il rêve depuis longtemps. Le 21 novembre 1956, il fait
son oblation perpétuelle. Quelques semaines plus tard il écrit : « Je
m’approche de la prêtrise comme une mère qui attend de mettre au monde… Je veux
former en moi une foi et un amour profonds, solides comme le granit ; sans cela
je ne pourrais pas être martyr... »
Le 24 février 1957, Mario
est ordonné prêtre ; sa messe de prémices est célébrée le dimanche 28 avril à
la cathédrale de Trente, sa paroisse. Le 2 juillet, il reçoit son obédience
pour le Laos. Le 31 octobre, il s’embarque à Naples avec le premier groupe de
Missionnaires Oblats italiens destinés au Laos. A 25 ans, il est le plus jeune
de l’expédition.
Après un mois de voyage,
le voici à Paksane, où il débute son année d’apprentissage : étude de la
langue, des coutumes laotiennes, etc. En stage à Keng Sadok, il s’efforce
d’entrer le plus vite possible en contact avec des personnes à qui il peut
annoncer la Bonne Nouvelle. Son Journal d’un homme heureux (publié en
1985-86 puis en 2005) et son abondante correspondance décrivent le voyage
intérieur à la découverte d’une mission difficile, rendue encore plus ardue à
cause de la guérilla.
En décembre 1958 le P.
Mario Borzaga est envoyé dans le village de Kiucatiam (Louang Pra-bang). Au
service de la communauté chrétienne hmong, il s’efforce de former des
catéchistes, de visiter les familles, et de soigner les malades qui affluent
chaque jour à sa porte. Le dimanche 24 avril 1960 après la messe, des Hmong de
Pha Xoua viennent à lui. Ils renouvellent la demande de visiter leur village,
qui est à trois jours de marche par-delà la forêt et les pentes escarpées de la
montagne.
Mario se prépare alors en
hâte pour une tournée missionnaire de quinze jours, avant le début de la saison
des pluies. Le 25 avril il se met en marche, accompagné de son jeune catéchiste
Paul Thoj Xyooj. Ce sera un voyage sans retour. Les recherches entreprises
après la disparition des deux voyageurs ne donneront aucun résultat.
Les témoignages
recueillis depuis le début, mais surtout au cours des dernières années,
confirment toutefois ce qui était depuis le début la certitude des Hmong : les
deux apôtres ont été pris et éliminés par des éléments de la guérilla. À 27
ans, le P. Mario Borzaga avait rendez-vous avec son Créateur. N’avait-il pas
écrit dans son journal : « Moi aussi, j’ai été choisi pour le martyre » ?
Le catéchiste Paul Thoj
Xyooj (1941-1960)
Paul Thoj Xyooj est un
jeune catéchiste laotien d’ethnie hmong. Né en 1941 à Kiukatiam (Louang
Prabang), il sera baptisé à 16 ans, le 8 décembre 1957, par le P. Yves
Bertrais, OMI. A Noël 1957, il est à l’école des catéchistes au Séminaire de
Paksane, où il reçoit le nom lao de Khamsè ; mais au bout d’un an, il est de
retour à Kiukatiam. En avril 1959, faute d’un catéchiste mieux formé, on
l’envoie à Na Vang (Louang Namtha) avec le P. Luigi Sion.
Les témoignages décrivent
Paul Xyooj comme un catéchiste zélé et utile. Son enseignement et son exemple
de vie chrétienne sont à l’origine de nombreuses conversions. En décembre 1959,
il est envoyé à la nouvelle école de catéchistes de Louang Prabang pour y
poursuivre sa formation ; mais il est en crise et retourne bientôt dans son
village natal. Les mois suivants, il est proche du P. Mario Borzaga, qui parle
souvent de lui dans son Journal.
Lundi 25 avril 1960, le
P. Mario Borzaga prend Paul Xyooj comme compagnon pour un voyage missionnaire ;
ils n’en reviendront jamais. En fait, Xyooj doit faire face au sacrifice de sa
vie en cherchant à sauver son missionnaire. Un témoin a rapporté ses dernières
paroles : « Je ne pars pas, je reste avec lui ; si vous le tuez, tuez-moi
aussi. Là où il sera mort, je serai mort, et là où il vivra, je vivrai. »
Les corps, jetés dans une
fosse commune dans la forêt, n’ont jamais été retrouvés ; mais les témoignages
permettent de situer la mort glorieuse de Paul Thoj Xyooj et du P. Mario
Borzaga dans la région de Muong Met, sur la piste de Muong Kassy.
Le P. René Dubroux, MEP (1914-1959)
René Dubroux est né le 28
novembre 1914 à Haroué, dans le diocèse de Nancy en France. Le 8 janvier 1939
il est ordonné prêtre pour le diocèse de Saint-Dié, et nommé vicaire à la
paroisse Saint-Pierre-Fourier de Chantraine. En 1940, lors de l’attaque
allemande, il est infirmier militaire au front et s’illustre par sa bravoure.
Le 30 octobre 1943, René
Dubroux est admis dans la Société des Missions Étrangères de Paris, et bientôt destiné
à la Mission de Thakhek au Laos. Il ne pourra rejoindre sa mission qu’après
deux années comme aumônier militaire en Indochine (1946-1948).
Au poste missionnaire de
Namdik (1948-1957), il développe la vie chrétienne de ses fidèles par ses
instructions et par la fréquentation assidue de l’eucharistie et de la
pénitence. Sur le plan matériel, il s’efforce d’améliorer leur sort et leur
apprend à exploiter la forêt et à exporter le bois. En 1957, il est chargé du
district de Nongkhène près de Paksé. C’est un endroit dangereux, au contact
immédiat avec la guérilla communiste naissante. Des menaces pèsent sur lui : la
rébellion veut montrer que le missionnaire n’est qu’un fétu sur leur chemin, un
obstacle dérisoire à leur volonté. Quant à lui, il a décidé de rester et de
poursuivre sa mission.
Tard dans la soirée du 19
décembre 1959, le P. Dubroux est en conversation avec ses catéchistes dans la
sacristie de la petite chapelle de Palay, qui lui sert de logement. Il est
abattu presque à bout portant par ses ennemis. Il avait une haute idée de ses
devoirs de pasteur ; il est mort par amour de ses fidèles, par fidélité à sa
mission. Son souvenir est resté très vivant chez tous ses anciens paroissiens.
Le P. Louis Leroy,
OMI (1923-1961)
Louis Leroy est né le 8
octobre 1923 à Ducey, dans le diocèse de Coutances en France. Orphelin de père,
il travaille une dizaine d’années dans la ferme familiale. A 22 ans, il
s’oriente vers la vie missionnaire chez les Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée. Après un temps de rattrapage scolaire à Pontmain, il suit avec
courage les six années de philosophie et de théologie à Solignac. A l’un ou
l’autre de ses compagnons il confie son espoir de mourir martyr.
Ordonné prêtre le 4
juillet 1954, il est envoyé à la Mission du Laos. Affecté dans des postes de
montagne, il étudie patiemment les langues – lao, thaï-deng, kmhmu’ –, desservi
par une surdité précoce. Ses résultats médiocres sont compensés par son
infatigable dévouement au service des malades, par son amour des plus pauvres,
par sa patience envers les pécheurs. Inlassablement, il visite les villages qui
lui sont confiés, à des heures de marche autour de sa résidence de Ban Pha. A
ses correspondantes carmélites, il confie ses joies et ses peines ; il souffre
de la tiédeur et du manque de constance de certains chrétiens.
Devant l’arrivée des
troupes communistes, obéissant aux consignes de Rome et de son évêque, il
refuse avec opiniâtreté de quitter son poste. Le 18 avril 1961, un détachement
vient le chercher. Demandant d’enfiler sa soutane, de prendre sa croix et son
bréviaire, il suit les soldats. Dans la forêt voisine, il est sommairement
abattu. Son rêve de jeunesse, témoigner du Christ jusqu’au martyre, était
exaucé.
Le P. Michel Coquelet,
OMI (1931-1961)
Michel Coquelet est né le
18 août 1931 à Wignehies, dans l’archidiocèse de Cambrai en France. Il grandira
dans le diocèse d’Orléans, puis retourne dans son diocèse d’origine pour
achever ses études au Petit Séminaire de Solesmes. En 1948, il est admis au
noviciat des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée à La Brosse-Montceaux,
puis au scolasticat de Solignac. De son service militaire aux confins du
Sahara, il rapporte une véritable passion pour le soin des malades.
Ordonné prêtre le 19
février 1956, il est envoyé l’année suivante à la Mission du Laos. Ses quatre
années d’apostolat furent une dure épreuve : dans la montagne, il fut affecté à
des villages de néophytes dont la formation chrétienne laissait fort à désirer.
Le journal de la mission montre sa souffrance de missionnaire, mais aussi son
grand esprit de foi, teinté d’un humour qui était un des traits attachants de
son caractère. Il se fit tout à tous, avec le souci d’aller vers les plus
pauvres, de visiter les villages, de soigner les malades, et surtout d’annoncer
l’Évangile…
Le 20 avril 1961, il est
en tournée au service des malades. Les soldats de la rébellion lui tendent un
guet-apens à Ban Sop Xieng. Il est tué au bord de la route. Son corps sera jeté
dans le torrent, qui irrigue cette terre laotienne où il avait semé avec
patience et amour la Parole de Dieu. Ses Kmhmu’ ne l’ont jamais oublié.
Le P. Vincent L’Hénoret,
OMI (1921-1961)
Vincent L’Hénoret est né
le 12 mars 1921 à Pont l’Abbé, dans le diocèse de Quimper en Bretagne (France).
Il fait ses études secondaires, puis son noviciat, chez les Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée à Pontmain. Pour les études de philosophie et de
théologie, il est à La Brosse-Montceaux, où il vit le drame du 24 juillet 1944
: l’exécution sommaire par les nazis de cinq Oblats. Ordonné prêtre le 7
juillet 1946, il se fait photographier devant le monument aux Oblats fusillés,
où est gravée dans la pierre la phrase de Jésus : « Il n’est pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Conformément à son
souhait, il est envoyé à la Mission oblate du Laos, ruinée par la guerre.
Dans le secteur de
Paksane, il est un pasteur attentif, qui sait se faire aimer de ses chrétiens
de troisième génération. En 1957, il est envoyé semer l’Évangile dans les
montagnes de Xieng Khouang. A Ban Ban, son apostolat est surtout auprès des
réfugiés thaï-deng, qui avaient fui la persécution des Houa Phanh – apostolat
ingrat, où il doit lutter contre le découragement. Le jour de l’Ascension au
petit matin, 11 mai 1961, il circule à bicyclette pour assurer l’Eucharistie.
Un poste de la guérilla communiste contrôle son laissez-passer, qui est en
règle, puis l’abat d’une rafale dans le dos. Dans leur idéologie, la présence
d’un missionnaire n’était pas tolérable.
Le P. Noël Tenaud,
MEP (1904-1961)
Noël Tenaud est né le 11
novembre 1904 à Rocheservière, dans le diocèse de Luçon en Vendée (France). De
1924 à 1928, il est au Grand Séminaire diocésain, puis rejoint celui des
Missions Etrangères de Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1931, il est envoyé à
la « Mission du Laos », dont la partie principale est alors au Siam. Ses années
comme curé à Kham Koem (Thaïlande) ont laissé un souvenir vivant.
La guerre franco-siamoise
(1939-1940) l’amène au Laos proprement dit. A partir de 1944, il est curé de
Pong Kiou (Khammouane) et rayonne dans toute la région. Son action, notamment
au cours de divers épisodes belliqueux contre la tyrannie japonaise et la
mainmise des troupes communistes, marque profondément les chrétientés de la
minorité Sô. Il accepte aussi, dans les situations difficiles, des
responsabilités de plus en plus lourdes dans l’organisation de la mission.
En 1959, le P. Tenaud
accepte de quitter sa belle région pour l’arrière-pays de Savannakhet, où le
travail de première évangélisation n’a pas encore commencé. Basé à Xépone, près
de la frontière du Vietnam, avec son fidèle catéchiste Joseph Outhay, il
prospecte les villages tout au long de la route qui monte de Savannakhet.
En avril 1961, les deux
apôtres partent en tournée apostolique. On les avertit qu’une attaque
nord-vietnamienne se prépare ; mais rien ne doit arrêter la Parole de Dieu. Le
chemin du retour est coupé : ils sont pris au piège, arrêtés, interrogés et
exécutés le 27 avril 1961 pour leur action missionnaire. Chez tous ceux qui l’ont
connu, le souvenir du P. Noël Tenaud, de son œuvre missionnaire et du don
suprême de sa vie, est resté très vivant.
Le catéchiste Joseph
Outhay (1933-1961)
Joseph Outhay naquit vers
Noël 1933, dixième enfant d’une famille catholique très pieuse de Kham Koem,
dans le Lao Issan, aujourd’hui diocèse de Tharè-Nonseng en Thaïlande.
Lorsqu’éclate au Siam la persécution de 1940, le jeune Outhay a sept ans. Sa
paroisse puis l’ensemble de la province restent sans prêtre résident ; son père
est catéchiste et prend le relais. À douze ans, la persécution finie, Outhay
est envoyé pour 6 ans au petit séminaire de Ratchaburi. Il revient alors au
village : sa mère et ses frères aînés sont tous morts ; il doit s’occuper de
son père et de ses deux sœurs encore petites… Il se marie donc – il a 19 ans –,
mais un an plus tard son épouse meurt en couches, suivie peu après de leur
enfant.
Outhay vit là un signe :
il partit pour Tharè, se mettant à la disposition de son évêque comme
catéchiste diocésain. À l’invitation de son ancien curé, le P. Noël Tenaud,
MEP, il suivra bientôt ce dernier vers la Mission de Thakhek au Laos. Homme
expérimenté, mûri précocement par la vie, il fut à Pongkiu un catéchiste
apprécié de tous, chargé de la formation de jeunes catéchistes débutants. Homme
de confiance du P. Tenaud, il le suivra en 1960 vers les régions de la
province de Savannakhet à défricher pour l’Évangile. Il partagera aussi son
destin final, rendant comme lui l’ultime témoignage de foi le 27 avril 1961. De
son vivant, Outhay était déjà considéré comme un catéchiste héroïque. Après sa
mort, sa renommée n’a fait que monter, jusqu’à aujourd’hui. Son exemple est une
inspiration pour tous.
Le P. Marcel Denis,
MEP (1919-1962)
Marcel Denis est né le 7
août 1919 à Alençon, la ville de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, dans le
diocèse de Séez en France. Il fréquente d’abord le petit et le grand séminaire
de son diocèse ; en 1942, il est admis aux Missions Étrangères de Paris.
Ordonné prêtre le 22 avril 1945, il part en 1946 pour la Mission du Laos.
Chargé d’abord des
chrétientés de Dong Makba et alentours, dans la plaine, il y travaille avec
difficulté à l’éducation des villageois. À partir de 1954, il est envoyé vers
les zones intérieures du Khammouane. Il s’établit à Maha Prom et s’entoure de
collaborateurs de valeur. Il met sa science, son cœur et sa foi, dans la
patience et la persévérance, au service de la promotion humaine et spirituelle
du peuple auquel il est envoyé. Peu à peu, il se tourne vers les villages de la
montagne, qui ignorent tout de l’Évangile, et consacre beaucoup de temps et
d’amour aux lépreux. Pèlerin infatigable, il parcourt une vaste région et ouvre
le dialogue avec les populations rencontrées. Çà et là la bonne graine germe,
ouvrant de grands espoirs de conversions.
En avril 1961, la
guérilla communiste occupe en quelques semaines tout le territoire qui lui est
dévolu. Il se dépense sans compter pour mettre collaborateurs et enfants à
l’abri, mais décide de rester au milieu d’eux. Il est arrêté et emmené en
détention vers un lointain village à la frontière du Vietnam. Au bout de trois
mois, le 31 juillet 1961, il est emmené dans la forêt et exécuté. Sa mémoire
est vénérée et son exemple continue d’inspirer de nombreux chrétiens laotiens.
Le P. Jean Wauthier, OMI (1926-1967)
Né le 22 mars 1926 à
Fourmies, dans l’archidiocèse de Cambrai en France, Jean Wauthier grandit
durant la Seconde Guerre mondiale comme réfugié dans le diocèse d’Agen. Il y
est élève au Petit Séminaire de Bon-Encontre, et son souvenir y reste très vivant.
En 1944, il rejoint à travers un pays en désordre le noviciat des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée à Pontmain. Au scolasticat de Solignac, alors en
construction, les travaux manuels les plus pénibles ne le rebutent pas. Homme
au physique robuste et au caractère trempé, il fait son service militaire en
Afrique du Nord comme élève-officier parachutiste : un missionnaire bien
préparé ! Ordonné prêtre le 17 février 1952, il rejoint en octobre la mission
du Laos.
Jean Wauthier est mis
sans tarder au service de la mission chez les plus pauvres, les Kmhmu’. Durant
les années de guerre et de guérilla, il accompagne les gens de ses villages à
travers leurs déplacements à la recherche d’un havre de paix. Pionnier
lui-même, il se met à leur service à travers ses connaissances médicales,
techniques, linguistiques et catéchétiques.
En 1961, il est sauvé in
extremis en face d’un peloton d’exécution. Par prudence, ses supérieurs le
rappellent comme éducateur au petit séminaire de Paksane, tâche dont il
s’acquitte avec compétence et dévouement ; mais il n’aspire qu’à retrouver ses
réfugiés dans la montagne, parmi lesquels la misère s’est installée : récoltes
incertaines, attaques, mines le long des pistes, pénurie de médicaments, abus
de toute sorte. C’est chose faite en octobre 1964.
Outre le soin des
néophytes et des catéchumènes et le défrichage missionnaire, le P. Wauthier se
consacre à répartir équitablement l’aide humanitaire. C’est là que se noue le
drame, car même dans la pire misère il y a encore exploitants et exploités : il
défend les pauvres Kmhmu’, sans pour autant les favoriser car il sait se mettre
au service de tous. Il est désormais conscient que sa vie est menacée. Le 16
décembre 1967 dans la nuit, sous le couvert d’une attaque simulée de la guérilla,
il est exécuté de trois coups de feu en pleine poitrine. Le lendemain, un des
catéchistes écrit à ses parents : « Le P. Jean est mort parce qu’il nous
aimait et n’a pas voulu nous abandonner. » Son amour des pauvres continue
de rayonner au Laos.
Le P. Lucien Galan, MEP (1921-1968)
Lucien Galan est né le 9
décembre 1921 à Golinhac, dans le diocèse de Rodez en France. Il entre d’abord
au Grand Séminaire de Rodez, mais est admis en 1946 aux Missions Étrangères de
Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1948, il part en décembre pour la Mission de
Xichang, au Sichuan (Chine).
Fin mars 1950, la région
est « libérée » par les communistes. En novembre, au retour d’une tournée chez
ses chrétiens, il est appréhendé et emprisonné, puis mis en résidence
surveillée sous un régime de terreur. Il est finalement expulsé de Chine,
arrivant à Hong Kong au terme d’un long périple en janvier 1952.
Après quelques semaines
de repos, il est réaffecté à la Mission de Paksé au Laos. Vers 1953-1954, il
prend contact avec les populations « kha », les minorités montagnardes
méprisées du plateau des Bolovens. En 1956, il s’installe au milieu d’eux dans
une petite maison-chapelle, d’où il rayonne sur les villages. Il les visite
malgré la présence d’éléments rebelles qui se cachent dans ces montagnes. Il a
soin aussi des Chinois de Paksé.
En février 1960, il prend
la relève du Serviteur de Dieu René Dubroux, assassiné, dans la zone limitrophe
entre forces laotiennes rivales. L’insécurité ne permet de visiter que très
rarement les villages les plus lointains. Le 11 mai 1968, il part en
remplacement d’un confrère pour Nong Mot et de Nong I-Ou, qui sont entrés en
catéchuménat, avec deux jeunes élèves catéchistes. Il y assure la catéchèse et
la messe. Dimanche 12, il reprend la route pour une célébration au Km-15 de
Paksé. Mais l’ennemi a dressé une embuscade : la voiture est prise sous le feu
d’armes lourdes. Le jeune Khampheuane est tué sur le coup, son ami blessé. Le
P. Galan est achevé au poignard. Il meurt, victime de son devoir et de sa charité.
Le souvenir de son esprit de service et d’abnégation reste très vivant jusqu’à
aujourd’hui.
L’élève catéchiste Thomas
Khampheuane Inthirath (1952-1968)
Thomas Khampheuane
Inthirath est né en mai 1952 dans le village de Nong Sim (ethnie lavên) sur le
plateau des Boloven, vicariat apostolique de Paksé. Son père avait succédé au
grand-père maternel comme catéchiste du village, et avait connu la prison pour
ce motif. Khampheuane était le fils chéri, longuement désiré et attendu ; mais
cela n’a pas gâté sa nature pacifique et généreuse. Il était serviable et d’une
grande simplicité. C’était aussi un cœur pur, et certains ont vu là un signe de
sa vocation à la sainteté, au martyre.
A quinze ans, il est
choisi par le P. Lucien Galan pour entrer à l’école des catéchistes à Paksong,
qui assurait aux élèves une bonne formation générale, doctrinale et liturgique.
Thomas était fier de ce choix. Le 11 mai 1968, le P. Galan passe là, en route
pour les villages catéchumènes les plus lointains. Deux élèves, Khampheuane et
son ami Khamdi, se portent volontaires pour l’accompagner. Ils étaient très
conscients du danger, mais Khampheuane avait la volonté de servir l’Église. Au
retour, la voiture fut prise en embuscade : il mourut à côté du P. Galan.
Malgré la détresse de la famille, le papa confia à un missionnaire être fier
que son fils ait accepté de donner sa vie pour sa foi. Sur le plateau, Thomas
n’est pas oublié.
Le P. Joseph Boissel, OMI (1909-1969)
Joseph Boissel naît le 20
décembre 1909 dans une famille de petits fermiers bretons, au Loroux dans
l’archidiocèse de Rennes (France). C’était un solide paysan, dur à la besogne.
À 14 ans, orphelin de père, il entre au juniorat des Oblats de Marie Immaculée
à Jersey, et poursuit avec eux sa vocation missionnaire. Ordonné prêtre le 4
juillet 1937, il reçoit l’année suivante sa feuille de route pour la jeune
Mission du Laos.
Le P. Boissel appartient
à la génération des pionniers oblats de cette mission, qui ont connu toutes les
secousses des guerres successives. Il débute auprès des Hmong de la province de
Xieng Khouang où l’évangélisation n’avait pas encore commencé. En mars 1945, il
est prisonnier des Japonais à Vinh au Vietnam. Au retour, il retrouve la
mission entièrement ruinée et se remet courageusement à l’œuvre, malgré une
santé désormais ébranlée par les privations. En 1949 il est à Paksane dans la
vallée du Mékong : il aide à construire et à gérer le petit séminaire,
n’hésitant pas à cultiver lui-même la rizière. En 1952, il obtient de repartir
dans les montagnes de Xieng Khouang. Il y poursuit l’évangélisation des Thaï
Dam de Ban Na et entreprend celle des Khmhmu’ des villages environnants.
En novembre 1957, il est
de retour pour de bon dans le district missionnaire de Paksane, curé de Nong
Veng puis de Lak Si. Mais il aura de plus en plus la charge des villages des
réfugiés, qui ont fui la guerre et le communisme de Xieng Khouang. Dans ces
années-là, prendre la route est toujours risqué ; à partir de mars 1969, la
pression de la guérilla s’accentue.
Le samedi 5 juillet 1969,
le P. Boissel s’en va assurer le service à Hat I-Êt, à une vingtaine de
kilomètres de Paksane, en compagnie de deux jeunes Oblates Missionnaires de
Marie Immaculée qui l’aident pour les visites, les soins aux malades et la
catéchèse. A la sortie d’un virage, le Viêt Minh le guette : deux rafales de
mitrailleuse, le ‘gêneur’ est tué net, et les Oblates grièvement blessées.
Cette mort sur la brèche, en pleine mission apostolique, a fortement
impressionné tout le peuple de Dieu. Son souvenir y reste très vivant.
Le catéchiste Luc
Sy (1938-1970)
Luc Sy est né en 1938 à
Ban Pa Hôk, un village de la minorité kmhmu’ à quatre heures de marche dans la
montagne au sud de Xieng Khouang au Laos. Le village fut baptisé le 28 octobre
1951 ; Sy reçut les noms de Luc et Marie. Elève timide mais franc et
travailleur, il étudie de 1953 à 1957 à l’école des catéchistes, au Petit
Séminaire de Paksane. En 1958, il est réclamé pour les écoles de l’État, mais
continue à travailler en étroite collaboration avec le P. Jean Wauthier, qui
sut lui faire partager son esprit apostolique.
En 1961, Luc Sy est
enrôlé dans l’armée, où il sera caporal. Dans une vie d’errance à travers un
pays en désordre, il reste bon chrétien. En 1967, blessé, il est démobilisé. Il
est accueilli comme catéchiste à Nong Sim dans la Mission de Paksé. Il se marie
avec une jeune veuve catholique, qui avait deux enfants ; le couple mettra au
monde une fille. Mais la mort de Jean Wauthier réveilla chez Luc Sy le désir de
servir les Kmhmu’, déplacés par la guerre, humiliés et brimés. En avril 1969,
il rejoint le Centre pastoral de Hong Kha à Vientiane, où l’on formait les
catéchistes kmhmu’ pour assurer le service pastoral et social, là où les
prêtres n’avaient plus accès. Élève doué, mûri par la vie, assidu à la prière,
ouvert aux plus délaissés, Luc Sy fut prêt dès Noël 1969 pour un envoi en
mission. Il devint associé de l’Institut séculier Voluntas Dei.
Le 26 janvier 1970, il
est envoyé par l’évêque en mission dans la région de Vang Vieng, vaste secteur
peuplé de villages de réfugiés. En peu de temps, il y accomplit un travail
remarquable, tant pour le développement que pour la catéchèse. Le 4 mars,
rejoint par Louis-Marie Ling, diacre Voluntas Dei et futur évêque, il
fait la retraite mensuelle. Ils partent le lendemain avec un compagnon à Dène
Dine, pour une tournée auprès des catéchumènes. Le matin du 7 mars 1970, veille
du dimanche Lætare, les trois apôtres, dénoncés, sont pris dans une
embuscade ; seul Louis-Marie a la vie sauve. Dès le début, il y eut autour de
Luc Sy une réelle aura de sainteté et de martyre : il fut et reste un exemple
vivant pour les autres catéchistes. Les chrétiens kmhmu’ vénèrent sa mémoire.
Le responsable laïc Pho
Inpèng (1934-1970)
Maisam, appelé plus tard
‘Pho Inpèng’ du nom de son fils selon la coutume, est né en 1934 dans la
Province des Houa Phanh. Avec de nombreux autres Kmhmu’ de sa province, il est
touché vers 1959 par la prédication de l’Évangile. Enrôlé dans l’Armée royale
lors de l’attaque des troupes communistes en octobre 1960, il sera capitaine.
Mais c’est un homme de paix. Dès que possible il quitte l’armée et se marie.
Avec son épouse, il se réfugie à Houey Phong dans la région de Vang Vieng ;
c’est là que le couple sera baptisé. Homme instruit, respecté et influent, il est
bientôt choisi comme responsable laïc de la petite chrétienté, faite surtout de
catéchumènes. En l’absence du missionnaire et du catéchiste, il dirige la
prière et instruit les enfants.
Lors de la journée de retraite de Louis-Marie Ling et Luc Sy, le 4 mars 1970, Pho Inpèng est là pour les servir. Quand il apprend que les deux jeunes gens doivent se rendre dans un milieu hostile, pour visiter les catéchumènes et soigner les malades, il s’offre pour les accompagner et fait équipe avec eux. Au retour, c’est l’embuscade fatale. La balle qu’il reçoit en plein front était destinée à Louis-Marie Ling ; elle met fin à la brève carrière héroïque de ce chrétien laïc exemplaire.
Liste des 17 témoins de l’Église du Laos
1. Joseph Thao Tiên, né
le 5.12.1918 à Muang Sôi (Houa Phanh, Laos), prêtre diocésain taï-deng du
vicariat de Thanh Hóa (Vietnam), mort le 2.6.1954 à Ban Talang (Houa Phanh),
vicariat de Vientiane.
2. Jean-Baptiste Malo, MEP, né le 2.6.1899 à La Grigonnais (44), missionnaire
en Chine puis au Laos, mort le 28.3.1954 à Yên Hội (Hà Tĩnh), diocèse de Vinh
(Vietnam).
3. René Dubroux, MEP, né le 28.11.1914 à Haroué (54), prêtre diocésain de
Saint-Dié puis missionnaire au Laos ; mort le 19.12.1959 à Palay, vicariat de
Paksé.
4. Paul Thoj Xyooj, né en 1941 à Kiukatiam (Louang Prabang), catéchiste hmong,
mort le 1.5.1960 à Muang Kasy, vicariat de Louang Prabang.
5. Mario Borzaga, OMI, né le 27.8.1932 à Trente (Italie), mort le 1.5.1960 à
Muang Kasy, vicariat de Louang Prabang.
6. Louis Leroy, OMI, né le 8.10.1923 à Ducey (50), mort le 18.4.1961 à Ban Pha
(Xieng Khouang), vicariat de Vientiane.
7. Michel Coquelet, OMI, né le 18.8.1931 à Wignehies (59) et éduqué à Puiseaux
(45), mort le 20.4.1961 à Sop Xieng (Xieng Khouang), vicariat de Vientiane.
8. Joseph Outhay Phongphoumi, catéchiste veuf, né en 1933 à Khamkoem, diocèse
de Tha-rè-Nongsèng (Thaïlande), mort le 27.4.1961 à Phalane, vicariat de
Savannakhet.
9. Noël Tenaud, MEP, né le 11.11.1904 à Rocheservière (85), missionnaire en
Thaïlande puis au Laos, mort le 27.4.1961 à Phalane, vicariat de Savannakhet.
10. Vincent L’Hénoret, OMI, né le 12.3.1921 à Pont l’Abbé (29), mort le
11.5.1961 à Ban Ban / Muang Kham (Xieng Khouang), vicariat de Vientiane.
11. Marcel Denis, MEP, né le 7.8.1919 à Alençon (60), mort le 31.7.1961 à Kham
Hè (Khammouane), vicariat de Savannakhet.
12. Jean Wauthier, OMI, né le 22.3.1926 à Fourmies (59), mort le 16.12.1967 à
Ban Na (Xieng Khouang), vicariat de Vientiane.
13. Thomas Khampheuane Inthirath, né en mai 1952 à Nong Sim (Champassak), élève
caté-chiste lavên, mort le 12.5.1968 à Paksong (Champassak), vicariat de Paksé.
14. Lucien Galan, MEP, né le 9.12.1921 à Golinhac (12), missionnaire en Chine
puis au Laos, mort le 12.5.1968 à Paksong (Champassak), vicariat de Paksé.
15. Joseph Boissel, OMI, né le 20.12.1909 au Loroux (35), mort le 5.7.1969 à
Hat I-Et (Bo-likhamsay), vicariat de Vientiane.
16. Luc Sy, catéchiste kmhmu’ père de famille, né en 1938 à Ban Pa Hôk (Xieng
Khouang), mort le 7.3.1970 à Dène Din (Province de Vientiane), vicariat de
Vientiane.
17. Maisam Pho Inpèng, laïc kmhmu’ père de famille, né vers 1934 près de Sam
Neua (Houaphan), mort le 7.3.1970 à Dène Din (Province de Vientiane), vicariat
de Vientiane.
Importance du témoignage des Martyrs du Laos pour l’Église et la société au
moment de leur mort
Dès avant sa mort, au
moment de son emprisonnement, le P. Joseph Thao Tiên est apparu comme un
véritable témoin de la foi chrétienne dans un milieu foncièrement hostile.
Cette réputation lumineuse a commencé dans sa province d’origine, les Houa
Phanh, et dans son propre groupe ethnique, les Thaï Deng ; mais après la
confirmation de sa mort en 1955, elle s’est répandue très vite dans l’ensemble
du pays et au Vietnam.
Le P. Tiên a servi de
modèle à tous ceux qui se trouvaient confrontés aux mêmes choix que lui. Grâce
à son exemple de fidélité héroïque au Christ et à sa propre vocation
sacerdotale, de nom-breux prêtres laotiens et étrangers, et d’innombrables
chrétiens laïcs, ont su à leur tour trouver le chemin de la constance intrépide
au milieu des épreuves les plus dures, y compris en face d’une mort imminente.
L’histoire de la Mission catholique au Laos ne connaît aucun missionnaire qui
ait reculé devant le danger ; en grande majorité, les chrétiens ont préféré
perdre toutes leurs possessions matérielles plutôt que de renoncer aux valeurs
de l’Évangile.
Un vieux catéchiste, Jean
Louk Khamsouk, qui avait été compagnon de Joseph Tiên dans l’évangélisation
puis en prison, donne le témoignage suivant : « Dans la pensée de
l’ensemble de la communauté chrétienne…, le P. Tiên est un saint et un héros…
On lui a promis de le libérer s’il acceptait de se marier et de devenir un
citoyen ordinaire. Mais lui a toujours refusé. Pour nous, c’est cela qui
compte, c’est là le signe de sa sainteté… »
Pour la communauté
chrétienne du Laos, et largement au-delà, le témoignage donné par les «
compagnons » du P. Joseph Tiên a eu la même valeur exemplaire. Certains des
Serviteurs de Dieu ont un rayonnement plus localisé, mais ils ont été d’emblée
reconnus comme un groupe unique de témoins de la foi, de la justice et de la
charité. Leur mort a été comme les mystères douloureux d’un chapelet que l’on
égrène dans la souffrance, au long de 16 années de vie ecclé-siale, mais sans
jamais perdre de vue les mystères de la Résurrection et de la Gloire. Toutes
les composantes de l’Eglise au Laos ont lu dans la vie et dans la mort de ces
prêtres et de ces laïcs la valeur incomparable de l’annonce de l’Evangile pour
le progrès humain et social des plus pauvres, et pour que le salut en Jésus
Christ puisse atteindre les personnes et leurs liens sociaux, jusqu’au plus
profond de leur être.
La prise de pouvoir sur l’ensemble du pays par la faction communiste en 1975, et son maintien jusqu’à ce jour, ont été incapables d’effacer cela, de gommer le témoignage incomparable de ces témoins du Christ.
Les martyrs du Laos : historique de la Cause
1994 : Jean-Paul II,
dans Tertio Millennio Adveniente, appelle à préserver la mémoire des
martyrs du XXe siècle. Les évêques du Laos demandent aux Missions
Etrangères de Paris (MEP) et aux Oblats de Marie Immaculée (OMI) de les aider à
rechercher les documents nécessaires.
2000, 7 mai : dans le cadre du Grand Jubilé, commémoration des « Témoins de la
foi au XXe siècle » ; ceux du Laos font partie de la longue liste.
2003, mai : les évêques du Laos approuvent une liste provisoire de 14 présumés
martyrs ; ils demandent à la Congrégation des Missionnaires OMI de les
représenter pour les démarches nécessaires en vue de la béatification.
2004, 26 juillet : le P. W. Steckling, supérieur général OMI, notifie à la
Conférence épiscopale Laos-Cambodge que les Oblats acceptent de représenter les
évêques pour cette cause. Le travail sera effectué par les Provinces de France
(pour quinze martyrs) et d’Italie (pour deux martyrs).
2004, 27 décembre : la Conférence épiscopale Laos-Cambodge nomme un postulateur
pour l’enquête diocésaine à coordonner en France.
2004-2008 : recherche de documents et de témoignages, d’abord en France, puis
au Laos en coopération étroite entre les évêques et la postulation.
2007, 2 juillet : Mgr Georges Soubrier, évêque de Nantes, accepte de diriger
l’enquête diocésaine pour le P. Joseph Thao Tiên et ses 14 compagnons.
2007, 6 septembre : la Congrégation pour les Causes des Saints accorde la
compétence à l’évêque de Nantes.
2008, 18 janvier : Le Saint-Siège accorde le nihil obstat à la
cause.
2008, 10 juin : Session publique d’ouverture de l’enquête diocésaine à Nantes.
2008, 7 juillet : Mgr G. Soubrier nomme la Commission historique.
2008, 29 juillet : la Congrégation pour les Causes des Saints accorde une
procédure simplifiée pour l’audition des témoins dans les vicariats du Laos
2009, 31 juillet : fin des travaux de la Commission historique de Nantes.
2009, 28 décembre : publication des actes de l’enquête diocésaine.
2010, janvier-février : à la demande du Promoteur de la Foi et du Postulateur,
supplément d’enquête pour répondre aux difficultés soulevées par la Commission
historique de Nantes.
2010, 27 février : session publique de clôture de l’enquête à Nantes ;
transfert des actes à Rome.
2010, 20 septembre : ouverture des sceaux.
2011, 20 octobre : décret de validité pour la cause du P. Joseph Thao Tiên et
ses compagnons.
2012, mars : nomination du Rapporteur, R. P. Zdzisław Kijas, o.f.m. conv.
2012, 13 octobre : la Congrégation pour les Causes des Saints notifie son
accord de principe pour que les causes du P. Joseph Thao Tiên (Nantes, 15
martyrs) et du P. Mario Borzaga (Trente, 2 martyrs) soient coordonnées, puis
étudiées conjointement.
2014, 21 février : le P. Thomas Klosterkamp, OMI, Postulateur général OMI, est
en charge de la cause.
2014, juillet : la Positio est imprimée et envoyée aux consulteurs
théologiens.
2014, 27 novembre : le Congresso des experts théologiens examine
la Positio. Un volume de 230 pages contenant leurs observations,
objections et questions est remis à la Postulation.
2015, 3 février : la Postulation remet ses réponses (124 pages) à la Congrégation
pour les Causes des Saints, pour envoi aux experts théologiens.
2015, 5 mai : le Congresso des cardinaux et évêques de la
Congrégation pour les Causes des Saints approuve définitivement la déclaration
de martyre de Mario Borzaga et Paul Thoj Xyooj. Le même jour, le pape François
signe le décret autorisant la publication de cette décision.
2015, 2 juin : le Congresso des cardinaux et évêques de la
Congrégation pour les Causes des Saints approuve définitivement la déclaration
de martyre de Joseph Thao Tiên et de ses 14 compagnons.
2015, 5 juin : signature par le pape François des décrets relatifs au P. Joseph
Thao Tiên et ses 14 compagnons.
(eda/ra)
Martyrs du Laos
1954-1970
Au printemps 1953 la guérilla occupe la province laotienne de
Sam Neua; les missionnaires ont été évacués. Le jeune prêtre Joseph Thao Tiên,
ordonné en 1949 a décidé pour sa part: «Je reste pour mon peuple. Je suis prêt
à donner ma vie pour mes frères laotiens. » Quand on I’emmène vers le camp de
Talang, les gens se mettent à genoux sur son passage en pleurant. Il dit: « Ne
soyez pas tristes. Je vais revenir. Je m’en vais étudier... Continuez à taire
progresser votre village... » Un an plus tard, le 2 juin 1954, il est condamné
è mort et fusillé: il avait refusé, une fois de plus, d’abandonner son
sacerdoce et de se marier.
Entre temps, è l’autre
bout du pays, le Père Jean-Baptiste Malo, ancien missionnaire en Chine,
avait été arrêté avec quatre compagnons. Il mourra bientôt d’épuisement et de
mauvais traitements sur le chemin des camps, en 1954 dans une vallée perdue du
Viêt-nam. En 1959, son confrère des Missions Étrangères René Dubroux,
ancien prisonnier de guerre en 1940, est trahi par un proche collaborateur et
éliminé par la guérilla, qui le balaie comme un obstacle dérisoire è leur
volonté. Cette année-la le Saint-Siège avait donné la consigne « Le clergé,
ainsi que le personnel auxiliaire religieux (excepté naturellement les
vieillards et malades) doit rester è son poste de responsabilité, è moins qu’il
ne vienne à être expulsé. »
Les missionnaires
adoptent avec joie cette consigne, qui signe l’arrêt de mort pour plusieurs
d’entre eux. En 1960 le jeune catéchiste hmong Thoj Xyooj et le
Père Mario Borzaga ne rentrent pas d’une tournée apostolique. En
avril-mai 1961, dans la province de Xieng Khouang, les Pères Louis Leroy,
Michel Coquelet et Vincent L’Hénoret sont cueillis è leur poste et abattus sans
procès. De même dans le sud du pays, le Père Noël Tenaud et son
fidèle catéchiste Outhay sont pris et exécutés; le Père Marcel Denis
sera retenu prisonnier quelque temps mais partagera le même sort. Un de leur
confrères écrit: « Ils ont été, tous, d’admirables missionnaires, prêts è tous
les sacrifices, vivant très pauvrement, avec un dévouement sans limite. En
cette période troublée, nous avions tous, chacun plus ou moins, le désir du
martyre, de donner toute notre vie pour le Christ. Nous n’avions pas peur
d’exposer nos vies; nous avions tous le souci d’aller vers les plus pauvres, de
visiter les villages, de soigner les malades, et surtout d’annoncer
l’Evangile... »
En 1967, Jean
Wauthier, infatigable apôtre des réfugiés, épris de justice, champion des
droits des pauvres, est éliminé par une autre faction; il laisse une population
éperdue de douleur: « Nous avons perdu un père! ». Jean avait regardé plus dune
fois la mort en face. Il était prêt; il a donné sa vie par amour pour les
siens.
En 1968, Lucien
Galan, lui aussi ancien missionnaire de Chine, visite les catéchumènes isolés
du plateau des Boloven. Son jeune élève Khampheuane, 16 ans, a tenu è
l’accompagner en raison du danger. Au retour de leur mission, on leur a tendu
un guet-apens; tous deux meurent sous les balles; leur sang se mêlé pour
féconder la terre du Laos. L’année suivante c’est le tour du Père Joseph
Boissel, le doyen des martyrs du Laos (60 ans), d’être pris en embuscade en
route vers une petite communauté chrétienne, et exécuté comme eux.
Début 1970, le jeune
catéchiste Luc Sy est envoyé en mission par son évêque dans la région
de Vang Vieng. Avec un compagnon, Maisam Pho lnpèng, Is sont en tournée dans un
village où plusieurs familles sont devenues catéchumènes. Ils catéchisent et
soignent les malades, s’attardent... On les attendait è la sortie du village.
Eux aussi meurent, en plein élan missionnaire, pour le Christ et pour le peuple
de Dieu. Tous deux étaient chefs de famille.
Laotiens et étrangers,
laïcs ou prêtres, ces dix-sept hommes ont donné pour l’Evangile le témoignage
suprême. La jeune Église du Laos reconnaît en eux leurs Pères fondateurs. « Si
le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit. »
SOURCE : http://postulationomifr.weebly.com/martyrs-laos.html
L’Église du Laos en liesse célèbre ses Martyrs
12 Décembre 2016 - Laos
Le P. Roland JACQUES,
Vice-Postulateur, était témoin d’un bel événement dans la vie de l'Eglise au
Laos et dans l'histoire des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
Ce dimanche matin, à
Vientiane, Laos, le 11 décembre 2016, 3ème de l’Avent, une seule messe
était célébrée dans tout le Laos. L’église du Sacré-Cœur, pro-cathédrale et
seul lieu de culte de la capitale Vientiane, apparut bien minuscule au fur et à
mesure que les fidèles, venus de tous les horizons, ayant rempli les quelque
400 places de l’édifice, se massaient dans tout l’espace disponible à l’entour
– dont une grande cour d’école – puis dans les rues du voisinage. D’immenses
toiles de tentes avaient été déployées pour permettre à cette foule de se
recueillir à l’abri du grand soleil. Des cadeaux – fleurs, images et médaillons
des martyrs – étaient remis à chacun des arrivants. Une atmosphère de paix, de
joie et de recueillement s’est répandue dès le début de la fête, qui s’ouvrit
par la traditionnelle procession populaire du Christ-Roi dans les rues les plus
proches.
L’Église catholique au
Laos est toute petite, humble, presque cachée. Elle ne compte que 4 évêques, 21
prêtres et un diacre laotiens, quelques douzaines de religieuses, et un peu
moins de 50000 fidèles laïcs. Son histoire est mal connue. Plantée jadis au
prix de la sueur et du sang de trois générations de missionnaires, elle ne peut
guère compter aujourd’hui que sur ses propres forces, avec à peine l’appui
d’une poignée de prêtres venus du Viêt Nam ou de Thaïlande. C’est dire à quel point
l’événement de ce jour était unique, inouï pour ce petit pays et pour cette
toute jeune Église.
Le Pape François avait
envoyé le cardinal Orlando QUEVEDO, venu de Mindanao aux Philippines; c’est un
homme aussi humble et proche des petites gens que Celui qu’il représentait ici.
Autour de lui prirent place 15 autres évêques – du Laos et du Cambodge, de
Thaïlande et du Viêt Nam – les Supérieurs généraux des Missions Étrangères de
Paris, des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée et de l’Institut Voluntas
Dei, et plus de 150 prêtres, dont un très grand nombre venait du Viêt Nam et de
Thaïlande; ceux arrivant des pays occidentaux n’étaient qu’une petite poignée.
Les fidèles étaient plus de 6000, déjouant les prévisions les plus optimistes
qui attendaient de 3 à 4000 participants.
Aux premiers rangs de
l’assemblée prirent place les représentants des autorités de l’État et les
délégués des religions reconnues au Laos, y compris Protestants et Musulmans;
vis-à-vis, c’étaient les Ambassadeurs de France et d’Allemagne et quelques
autres diplomates. Venaient ensuite les familles et les proches de quelques-uns
des martyrs, venus de lointaines régions du Laos ou de France. Parmi ces
proches, Mgr Tito Banchong, neveu du catéchiste Thoj Xyooj; Mgr Louis-Marie
Ling, seul survivant de l’attentat qui coûta la vie à son cousin le catéchiste
Luc Sy; le P. Yvon L’HENORET, cousin de Vincent L’Hénoret et qui a été
missionnaire au Laos comme lui; les nièces des Pères Noël Tenaud et Marcel
Denis, m.e.p. Dans une telle assemblée, on comprend à quel point l’émotion
était au rendez-vous; mais aussi qu’il y avait d’autres enjeux, bien plus
importants que la nostalgie ou le regard en arrière.
Au cœur de la
célébration, le cardinal Quevedo donna lecture de la Lettre apostolique du Pape
François déclarant «Bienheureux» les 17 martyrs, et fixant leur fête au 16
décembre. Ce court texte met en relief la fidélité de ces «témoins
héroïques du Seigneur Jésus Christ et de son Évangile de paix, de justice et de
réconciliation, au prix de leur vie». Dans son homélie le représentant du Pape,
commentant la vie et la mort du Père Joseph Tiên et de plusieurs autres, reprit
longuement ce thème.
À la fin de la
célébration, au grand étonnement de l’assemblée, le Directeur-adjoint du Front
Lao pour l’Édification de la Nation, organisme d’État sous la direction du
Parti et du Ministère de l’Intérieur qui chapeaute les religions, fit
longuement l’éloge de la doctrine et de l’action de l’Église catholique au
Laos, et développa à son tour les termes mis en avant par le Pape François,
disant tout ce que la Nation attendait de cette Église pour le bien commun. Le
nonce apostolique Paul Tschang In-Nam, lui-même profondément enraciné dans la
culture de l’Asie orientale, n’hésita pas à saisir la main tendue: il fit des
vœux pour que l’harmonie et la collaboration se développent, de sorte que tout
le peuple du Laos puisse se développer dans l’unité malgré les différences
religieuses.
L’utilisation des langues
fut un signe parlant du caractère profondément asiatique et laotien, et de la
fête, et de l’Église en fête. À 75 %, ce fut en laotien; le célébrant
s’exprimait bien entendu dans son anglais des Philippines; pour le reste, on
entendit les langues usuelles de cette petite chrétienté: le kmhmu’, le hmong
et le vietnamien. Pour le français et l’italien, il faudra attendre d’autres
célébrations, qui se feront en temps voulu en Europe…
Bilan de cette journée
mémorable? Voilà une Église humble et toute petite qui ose affirmer
publiquement son existence, sa fierté, et son immense respect pour ceux qui au
siècle dernier ont irrigué de leur sang les graines d’Évangile plantées dans le
sol laotien. Voilà une Église qui ne se cachera plus, et qui trouvera chaque
jour davantage sa place et son rôle au sein de la Nation et de la chrétienté
tout entière.
SOURCE : http://archive.omiworld.org/fr/content/nouvelles/3959/l-glise-du-laos-en-liesse-c-l-bre-ses-martyrs/
Profile
Member of the Paris Foreign Missions Society. Priest. Martyr.
Born
11
November 1904 in
Rocheservière, Vendée, France
27
April 1961 in
Muang Phalane, Savannakhet, Laos
5
June 2015 by Pope Francis (decree
of martyrdom)
11
December 2016 by Pope Francis
beatification recognition
celebrated in Vientiane, Laos, presided by Cardinal Angelo
Amato
SOURCE : http://catholicsaints.info/blessed-noel-tenaud/
The 17 Martyrs of Laos
1. Fr. Joseph Tien, Laos 5/12/1918, + Muang Xoi (Sam
Neua) 2/6/1954
educated in Vietnam, first Laotian martyr
2. Fr. Jean-Baptiste Malo, M.E.P., Nantes (F) 1899, +
Ha Tinh (Vietnam) 1954
missionary to China and Laos
3. Fr. René Dubroux, M.E.P., Lorraine (F) 1914, +
Palay (Champasak) 1959
4. Catechist Paul Thoj Xyooj, Laos 1941, + Muang
Kasy (Luang Prabang)1960
first Hmong missionary and martyr
5. Fr. Mario Borzaga, O.M.l., Trent 1932, + Muang Kasy
(Luang Prab.) 1960
6. Fr. Louis Leroy, O.M.I., Normandy 1923, + Ban Pha
(Xieng Khouang) 1961
7. Fr. Michel Coquelet, O.M.I., France 1931, +
Sop Xieng (Xieng Kh.) 1961
8. Catechist Joseph Outhay, Thailand 1933, +
Savannakhet 1961
9. Fr. Noël Tenaud, M.E.R, Vendée (France)1904, +
Savannakhet 1961
10. Fr. Vincent L’Hénoret, O.M.l., Bretagne 1921, +
Ban Ban (Xieng Kh.)1961
11. Fr. Marcel Denis, M.E.P., Aten9on (France) 1919, +
Khammouane 1961
12. Fr. Jean Wauthier, O.M.l., France 1926, + Ban Na
(Xieng Khouang) 1967
13. Thomas Khampheuane, Laos 1952, + Paksong
(Champasak) 1968
first Laven martyr
14. Fr. Lucien Galan, M.E.P., France 1921, + Paksong
(Champasak) 1968
missionary to China and Laos
15. Fr. Joseph Boissel, O.M.l., France 1909, ÷
Hat l-Et (Bolikhamsay) 1969
16. Catechist Luc Sy, Laos 1938, + Den Din
(Vientiane Province) 1970
first Kmhmu’ martyr together with Maisam
17. Lay leader Maisam Pho Inpeng, Laos 1934, + Den Din
1970
Blessed
Noël Tenaud, m.e.p. (11.11.1904-27.04.1961)
Just as Jesus delivered himself to death for us, the
ignominious death on the cross, so too the missionary, who has received from
God the Mission to be His successor on earth, must be ready for every
sacrifice. The vocation of the Foreign Missions, in fact, is a vocation to
total sacrifice, a total gift of self to God in the details of daily life, even
unto death itself.
He even needs to change his deepest ways of thinking.
Like Jesus Christ, the missionary must become like those whom he has come to
save… And having reached maturity, he must make for himself a new life; restart
his education from its very foundations; rebuild the entire structure of his
knowledge.
Much more suffering, many more sacrifices still await
him there, but that does not bother him, for his commitment to God must extend
even unto death…
The Gospel laborer must work with the sweat of his
brow and, at the price of his suffering, purchase the fruit that will serve as
remuneration for his action, that is to say, souls…
Blessed Noël Tenaud, farewell sermon to his parish,
Martyrs of Laos
1954-1970
During Easter time in 1953, while guerrillas stormed Sam Neua, Laos, many
missionaries retreated to safety. Joseph Thao Tìen, a young Laotian priest
ordained in 1949, had decided otherwise: ‘I am staying for my people. I am
ready to lay down my life for my Laotian brothers and sisters.” He was marched
to the prison camp in Talang; people knelt along the way, weeping. He told
them: Do not be sad, III come back. I am going to study... Make sure that your
village keeps improving.” One year later, on June 2, 1954, Joseph Tien was
condemned and shot to death. One time too many he had refused to give up his
priesthood and get married.
In the meantime at the other end of the country, Fr.
John Baptist Malo, a former missionary to China, had been detained with four
companions. Soon after—in 1954—on his way to the prison camp, he would die from
exhaustion and iII-treatment in a remote valley of Central Vietnam. In 1959 his
confrere René Dubroux, a former prisoner of war in 1940, was betrayed by a dose
associate- and eliminated as a mere hindrance in the guerrilla’s way. That year
the HoIy See had given strict instructions: “All clergy and religious
personnel—excepting obviously the elderly and sick—must remain in their place
of duty unless and until they are expelled.’”
All missionaries adhered joyfully to this
command; far a number of them it meant a verdict of death. In 1960, a young
Hmong catechist, Thoj Xyooj, went together with Fr. Mario Borzaga on an
apostolic trip to some villages; they never carne back. In April and May 1961,
Frs. Louis Leroy, Michael Coquelet and Vìncen tL’Hénoret were snatched from
their stations in the Province of Xieng Khouang and savagely put to death. In
Southern Laos Fr. Noël Tenaud and his faithful catechist Outhay were taken and
killed. Fr. Marcel Denis was kept prisoner for a while but ended in the same
way. One of their confreres wrote: “All of them were praiseworthy missionaries,
ready for any kind of sacrifice. They lived in utter poverty and their
dedication knew no limit. In those troubled times all of us, to some degree,
aspired to martyrdom, wishing to surrender our lives totally to Christ. We did
not fear exposing our Iives. All of us endeavoured to reach the poorest of the
poor, to visit their villages, to take care of the sick, and especially to
announce the Good News of Jesus...”
Fr. John Wauthier was a tireless apostle of the
refugees and stood up for Justice on their behalf; in 1967 another faction
ambushed and eliminated him. He left behind countless people crying in their
grief: We lost our father!” Fr. John had more than once looked death in its
ugly face. He was ready. He laid down his life out of love far his own.
In 1968 Fr. Lucien Galan, who had also started his
missionary life in China, visited some isolated catechumens on the Boloven
plateau. Because of the looming danger his pupil Khampheuane, aged 16, had decided
toga along. On their way back enemies lay in wait; both were killed, and their
blood mingled to irrigate the Laotian soil. One year later, it was the turn of
Fr. Joseph Boissel, 60, a veteran of the Laos mission: he was ambushed on his
way to an isolated Christian community and executed in the same manner.
In January 1970 Luke Sy, a young catechist and father
of three, was sent by his bishop to evangelize the Vang Vieng area. In March he
was visiting catechumens in a distant village with a companion, Maisam Pho
Inpeng, also the head of a family. Catechizing and tending to the many sick
villagers took quite some time. They were expected on the way back. A volley of
bullets put an end to their missionary thrust; they died for Christ and his People.
These seventeen men, lay Christians and priests
together, Laotians as well as foreigners, gave the supreme testimony for sake
of the Gospel. The young Church of Laos recognizes them as her founding
fathers. “Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains
just a single grain; but if it dies, it bears much fruit.”
SOURCE : http://omipostulationen.weebly.com/martyrs-of-laos.html
Heroes
of faith
AUTHOR
Pham Ngoc Tri |
Journalist
The beatification of 17
new martyrs, in the Laotian capital, was a historic event for a tiny minority
Church in a country ruled by a communist regime. For the good of the people of
Laos, Church authorities affirmed their willingness to cooperate with the civil
authorities.
PUBLISHED ON
Mar 2017
"Be strong, stay
firm !” boldly repeated Cardinal Orlando Quevedo, the Special Envoy of Pope
Francis, in a loud voice, at the historic beatification ceremony of new martyrs
of Laos, killed in odium fidei (hatred of the faith) by the communist Pathet
Lao guerrillas between 1954 and 1970, last December 2016 in the capital
Vientiane.
“This is a day of love of
the 17 martyrs, a day of joy for all the people in Laos, a day of blessing for
peaceful and harmonious relationship among all the Laotian citizens,” said the
Filipino Archbishop of Cotabato in his homily, addressing his message not only
to Christians but also to all the citizens of Laos.
It was the first time a
communist government of a country allowed a religious ceremony for the
beatification of Christian martyrs to take place. Communist government
authorities attended the celebration and exchanged messages of mutual respect,
understanding and collaboration with the bishops and the apostolic nuncio.
The huge crowd of the
faithful who participated in the well-organized event went beyond all
expectations of the local Church. The peaceful and joyful atmosphere surrounding the whole celebration
eased the initial fears of the official authorities who, at first, had
authorized a “limited” celebration.
“Little
flock”
Cardinals, bishops,
priests, nuns and lay people from neighboring countries, especially Vietnam,
and also from Europe (France and Italy) joined in the historic ritual of
beatification, the greatest event in the history of the Church in Laos. Also
present were the bishops who suffered in prison and re-education camps, as well
as missionaries who survived the persecutions and expulsions of all the foreign
priests in 1975. Relatives of some of the martyrs also took part in the
celebration.
Cardinal Quevedo exhorted
the “little flock” to be faithful to Christ and to His Gospel as “light and
salt” in the midst of the Laotian society. The Cardinal, who presided over the
beatification on the Pope’s behalf, said the Church in Laos would celebrate the
feast day of the martyrs every year on December 16.
In his decree for the
beatification of the Laotian martyrs, Pope Francis mentioned Fr. Joseph Thao
Tien, the first local priest and the first Laotian martyr, killed in 1954. The Pope also named the five laymen catechists, and
finally, the 11 martyrs: five priests of the Paris Foreign Missions Society
(MEP), and six missionaries of the Oblates of Mary Immaculate (OMI) – all of
them “witnesses of the faith.”
Terrible
and glorious history
French missionaries (MEP)
arrived in Laos at the end of the 18th century to start their evangelization,
followed in 1935 by a group of French missionaries (OMI) and in 1957 by the
first Italian OMI. A short presentation of some of them revealed the terrible
and glorious history of the Church in Laos, “the country of a thousand
elephants.”
Ever since, Christians in
Laos have been pronouncing the name of “Father Tiên” with respect and devotion.
Blessed Joseph Thao Tiên (1918-1954) received his formation in Vietnam, first
as a catechist in Thanh Hoa, then in the seminaries of Hanoi and Saigon. After
his priestly ordination in Hanoi (1949), Fr. Joseph returned to Laos, to Sam
Neua Parish, living an austere life.
With the outbreak of the
communist insurgence, Fr. Tiên remained in his mission “ready to give my life
for my Laotian brothers.” In the Easter of 1954, he was arrested, submitted to
‘people’s judgment,’ imprisoned and sent to a re-education camp. Isolated, he
rejected all proposals against his faith and priestly celibacy, until the
moment he was killed.
Blessed Mario Borzaga, an
Italian OMI from Trent, arrived in Laos the same year of his priestly
ordination (1957). He was young but already prepared for his hard mission. “I
need deep faith and love, otherwise I cannot become a martyr,” he wrote. He
worked in the formation of catechists, visiting families, curing sick people.
On April 25, 1960, Fr. Mario undertook a two-week journey to visit a faraway
village in the forest, accompanied by a young hmong (a member of a
mountain-dwelling people) catechist, Paul Thoj Xyooj. It was a journey without
return! Some witnesses confirmed the death of the two missionaries by the
communist Pathet Lao and reported that the last words of the catechist Paul
was, “I remain here. If you kill him, kill me too.”
Blessed John Baptist
Malo, a French missionary (MEP) expelled from China, arrived in Laos in 1951.
Soon after, he and some other missionaries were ambushed and transferred to a
re-education camp in Vietnam. Fr. Malo could not survive the forced march; he
died of exhaustion.
Blessed
Noël Tenaud, also a French missionary (MEP), came
from Thailand. He was assigned to a region near the Vietnamese border for the
work of first evangelization. Accompanied by his faithful catechist, Blessed
Joseph Outhay, he visited many villages. In April 1961, on their way back from
an apostolic trip, they were ambushed by Vietnamese troops – were arrested and
executed “because of their missionary activity.” The catechist Joseph Outhay,
the 10th son of a catechist, just got married but soon became a widower. He
volunteered to serve full time as a diocesan catechist for the training of
young catechists, accompanying Fr. Noël until that last missionary trip.
Blessed John Wauthier, a
French OMI, of strong body and character, did his military service in northern
Africa as a parachute officer. Ordained as a priest in 1952, he arrived in Laos
that same year. During the years of war and guerrilla, Fr. John accompanied
villagers in their displacements, helping them with his medical, technical and
linguistic skills. After a three-year service as an educator in a seminary, he
returned to his refugees, evangelizing and caring for the poorest and the new
Christians. One of the catechists wrote to Fr. John’s family in France after he
was killed: “Fr. John died because he loved us and did not abandon us.”
SOURCE : https://worldmissionmagazine.com/archives/february-2017/heroes-faith
Beato Natale Tenaud Sacerdote
e martire
>>>
Visualizza la Scheda del Gruppo cui appartiene
Rocheservière, Francia,
11 novembre 1904 - Phalane, Laos, 27 aprile 1961
Padre Noël Tenaud, della
Società delle Missioni Estere di Parigi, operò a lungo nei territori tra
Thailandia e Laos, impegnandosi anche nella resistenza armata all’esercito
giapponese. Incaricato di svariati villaggi, riusciva a farsi ascoltare da
tutti e si preoccupava in particolare dei catecumeni. Nell’aprile 1961 cadde in
un’imboscata insieme al catechista Joseph Outhay Phongphumi e a un ragazzo
sordomuto, poi liberato. Alla richiesta di essere riportato alla missione col
catechista, venne portato via e ucciso con lui il 27 aprile 1961. Inseriti
entrambi nel gruppo di quindici martiri capeggiato dal sacerdote laotiano
Joseph Thao Tiên, sono stati beatificati l’11 dicembre 2016 a Vientiane, in
Laos. La loro memoria liturgica cade il 16 dicembre, unitamente a quella degli
altri quindici martiri del Laos.
Una vocazione alimentata
dal sangue dei martiri
Noël Tenaud nacque l’11
novembre 1904 a Rocheservière in Francia e fu battezzato l’indomani. Il suo
villaggio era vicino a Nantes, ma apparteneva alla diocesi di Luçon.
Geograficamente, si trova in Vandea, la regione diventata celebre per la
resistenza alla Rivoluzione francese che costò la morte di numerosi cattolici,
di tutti gli stati di vita e di qualsiasi età.
Crebbe quindi nel ricordo
di quelle lotte sanguinose e, in modo del tutto naturale, desiderò diventare
sacerdote. Frequentò dunque gli studi secondari nel Seminario minore di
Chavagnes-en-Paillers e fu poi ammesso al Seminario maggiore di Luçon, dove studiò
dal 1924 al 1928.
Missionario in Thailandia
Si sentì però chiamato
alle missioni all’estero: accadeva spesso, infatti, che i membri dei primi
istituti missionari passassero nei Seminari in cerca di nuove leve. Così, il 14
settembre 1928, passò al Seminario della Società delle Missioni Estere di Parigi.
Ordinato sacerdote il 29
giugno 1931, partì il 7 settembre successivo per la missione del Laos, la cui
parte principale era nel territorio dell’allora Siam. Dal 1932 al 1934 fu
a Tharae, dove si dedicò a studiare soprattutto la lingua lao. In seguito
divenne parroco di Kham Koem, una comunità cristiana ben stabilita.
Passaggio in Laos
Nel novembre 1940, a
causa di una persecuzione religiosa scoppiata nel territorio dell’ormai
Thailandia, i missionari francesi dovettero riparare in Laos, sull’altra riva
del fiume Mekong, sotto la protezione della madrepatria. Nel nuovo territorio,
padre Tenaud venne assegnato alla missione di Nam Tok, dove restò tre anni.
Nel pieno della seconda
guerra mondiale, dovette trascorrere un anno in esilio in Vietnam. Rientrato
in Laos, dovette occuparsi della comunità cristiana di Pongkiou, nella
provincia di Khammouan, abitata dall’etnia dei Sô.
Protagonista della
resistenza
Nel marzo seguente, un
colpo di forza dell’esercito giapponese provocò un massacro di civili francesi
e la rovina di numerose missione. Anche tre membri della Società delle Missioni
Estere, i vescovi monsignor Gouin e monsignor Thomine e il sacerdote Jean
Thibaud vennero portati nella foresta e uccisi senz’alcuna forma di
processo.
A padre Tenaud parve di
rivivere i racconti di quanto accaduto in Vandea e decise di non restare in
disparte: divenne quindi uno dei protagonisti della resistenza franco-laotiana
contro i giapponesi, ritenendo che la lotta armata rappresentasse la
salvaguardia sia degli uomini sia dell’opera di evangelizzazione che lui e i
missionari dovevano portare avanti. Mise quindi insieme un piccolo esercito
composto dai Sô e da altri laotiani dei villaggi vicini, la cui organizzazione
venne lodata dall’esercito ufficiale e valse per lui la Legion d’Onore.
Distacco dalla vita
militare
Un lungo congedo in
Francia, dal marzo 1947 al dicembre 1948, gli fece capire di dover prendere le
distanze dalla vita militare. Si diede quindi alla ricostruzione delle comunità
cristiane del Laos, in qualità di pro-vicario e delegato per la parte del
vicariato che rientrava nel protettorato francese. Fu poi nominato
pro-prefetto della neonata prefettura apostolica di Thakhek.
Nel Natale 1953, le
truppe dei guerriglieri avanzavano sempre di più nella regione. L’esercito
francese costrinse quindi i missionari a evacuare la zona, rifugiandosi a
Pakse, nel sud del paese. Padre Tenaud sfuggì alla stessa sorte del gruppo
composto dal prefetto apostolico, da altri tre confratelli e da una religiosa, arrestato
il 15 febbraio 1954 e deportato in Vietnam; padre Jean-Baptiste Malo, parte di
quel gruppetto, morì di stenti il 28 marzo seguente.
La sua attività
missionaria
Nominato superiore ad
interim dei missionari parigini e procuratore della Missione, poté dedicarsi
ancora più direttamente all’attività missionaria. A Thakhek divenne famoso
perché cercava in tutta la città i cristiani che erano scappati dai villaggi,
ma si erano persi.
Nel corso di una visita
al suo vecchio villaggio di Kham Koem, incontrò Joseph Outhay Pongphumi, un
giovane vedovo molto portato per l’insegnamento: gli chiese dunque di seguirlo
come catechista, dopo il necessario periodo di formazione nella scuola di Sriracha,
nel sud della Thailandia.
In un territorio a
rischio
Nel giugno 1958 padre
Tenaud partì per un anno di riposo in Francia. Al suo ritorno, accettò una
parrocchia pressoché inesistente, in una provincia del tutto priva di
cristiani, dove quindi l’evangelizzazione non era ancora cominciata. Facendo
base a Savannakhet, visitava i villaggi verso la frontiera del Vietnam, con la
speranza di creare una nuova comunità cristiana.
La regione era
apparentemente tranquilla, ma spesso, lungo la strada, il missionario
incontrava alcuni guerriglieri: senz’alcun timore, li caricava sul suo
fuoristrada. Quel suo comportamento, unito alle sue andate e venute, offrì loro
l’occasione di tendergli una trappola. A chi gli faceva presente il rischio,
lui rispondeva che conosceva i soldati e che non c’era affatto bisogno di
temerli.
L’ultimo viaggio
Nell’aprile 1961, padre
Tenaud partì col catechista Outhay e un giovanissimo cristiano sordomuto, per
girare i villaggi che gli erano stati affidati. Giunto al passaggio del campo
di Seno (Xenô), i militari francesi l’avvertirono che un attacco dei
nord-vietnamiti si stava preparando sulla zona che doveva raggiungere e lo
sconsigliarono formalmente di proseguire. Più avanti, un pastore protestante
gli confermò la brutta notizia, ma lui tirò dritto.
Dopo aver raggiunto il
cuore dell’offensiva, tornò indietro, ma la strada era stata interrotta oltre
Phalane, a circa cinquanta chilometri da Savannakhet. I tre viaggiatori,
allora, si rifugiarono in un villaggio lungo la strada, ma furono traditi dai
loro stessi ospiti e arrestati dai soldati nord-vietnamiti, che imposero loro
di tornare a Phalane.
Sulla strada tra Muang
Phine e Phalane, tuttavia, caddero in un’imboscata: i soldati furono uccisi,
padre Tenaud ferito a una gamba, mentre Outhay fu colpito al collo. Ricondotti
a Phalane, vennero curati, mentre il ragazzo sordomuto venne rimesso in
libertà.
Il martirio
Dopo otto giorni, il
missionario domandò all’amministrazione provvisoria stabilita nella zona di
poter rientrare a Savannakhet con Outhay. Alcuni testimoni li videro uscire
dall’ufficio dell’amministrazione e, da allora, non ebbero più loro notizie né
arrivarono a destinazione.
Nel 1963 varie
testimonianze condussero a pensare che entrambi fossero dispersi. La Società
delle Missioni Estere registrò quindi la morte di padre Tenaud alla data
presunta del 15 dicembre 1962. Un avviso ufficiale dell’ambasciata di Francia
in Laos, datato 19 aprile 1967, retrodatò la sua uccisione al 27 aprile 1961.
La ragione ultima
dell’accaduto rientrava probabilmente nei tentativi da parte dei guerriglieri
di sradicare il cristianesimo dal Laos: era visto come un pericolo e i
missionari apparivano, di conseguenza, come “nemici del popolo”.
La causa di
beatificazione
Padre Noël Tenaud e
Joseph Outhay Phongphumi sono stati inseriti in un elenco di quindici tra
sacerdoti, diocesani e missionari, e laici, uccisi tra Laos e Vietnam negli
anni 1954-1970 e capeggiati dal sacerdote laotiano Joseph Thao Tiên. La fase
diocesana del loro processo di beatificazione, ottenuto il nulla osta dalla
Santa Sede il 18 gennaio 2008, si è svolta a Nantes (di cui era originario il
già citato padre Jean-Baptiste Malo) dal 10 giugno 2008 al 27 febbraio 2010,
supportata da una commissione storica.
A partire dalla fase
romana, ovvero dal 13 ottobre 2012, la Congregazione delle Cause dei Santi ha
concesso che la loro “Positio super martyrio”, consegnata nel 2014, venisse
coordinata, poi studiata, congiuntamente a quella di padre Mario Borzaga, dei Missionari
Oblati di Maria Immacolata, e del catechista Paul Thoj Xyooj (la cui fase
diocesana si era svolta a Trento).
Il decreto sul martirio e
la beatificazione
Il 27 novembre 2014 la
riunione dei consultori teologi si è quindi pronunciata favorevolmente circa il
martirio di tutti e diciassette. Questo parere positivo è stato confermato il 2
giugno 2015 dal congresso dei cardinali e vescovi della Congregazione delle
Cause dei Santi, ma solo per Joseph Thao Tiên e i suoi quattordici compagni:
padre Borzaga e il catechista, infatti, avevano già ottenuto la promulgazione
del decreto sul martirio il 5 maggio 2015. Esattamente un mese dopo, il 5
giugno, papa Francesco autorizzava anche quello per gli altri quindici.
La beatificazione
congiunta dei diciassette martiri, dopo accaniti dibattiti, è stata infine
fissata a domenica 11 dicembre 2016 a Vientiane, nel Laos. A presiederla,
come inviato del Santo Padre, il cardinal Orlando Quevedo, arcivescovo di
Cotabato nelle Filippine e Missionario Oblato di Maria Immacolata. La loro
memoria liturgica cade il 16 dicembre, anniversario del martirio di padre Jean
Wauthier, Missionario Oblato di Maria Immacolata.
Autore: Emilia
Flocchini
SOURCE : http://www.santiebeati.it/dettaglio/97067
Voir aussi : http://newsaints.faithweb.com/martyrs/Laos.htm#Tien