Joseph-Marie Vien (1716–1809), Saint Thibaut offrant à Saint Louis et Marguerite de Provence un lys à onze branches, 1776, 383 x 180, Palace of Versailles, Petit Trianon, Chapelle
Saint Thibaud de Marly
Abbé des Vaux-de-Cernay (+
1247)
De 1235 à sa mort, il fut
abbé des Vaux de Cernay, dans les Yvelines, monastère qui comptait alors 200
moines. Toujours premier levé, dernier couché, il balayait les couloirs,
nettoyait les "retraits" sanitaires, portait la pierre aux maçons. Le
roi saint Louis attribuait à ses prières le bonheur d'avoir pu fonder une
famille nombreuse.
Au monastère cistercien
des Vaux de Cernay sur le territoire de Paris, en 1247, saint Thibaud de Marly,
abbé, qui s’employait pour ses frères aux charges les plus humbles.
Une des deux églises de
la paroisse de Marly-le-Roi porte le nom de saint Thibaut de Marly et fait tout
spécialement mention de saint Thibaut lorsque le 8 juillet se trouve être un
dimanche. Ce jour-là, l’association “Les Amis de Saint-Thibaut” prend en charge
l’animation la messe.
Martyrologe romain
SOURCE : http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1472/Saint-Thibaud-de-Marly.html
Saint Thibault de Marly
Thibauld, de l'illustre
famille des Montmorency, était le fils aîné de Bouchard I° de Marly et de
Mathilde de Châteaufort, petite-fille du roi Louis VI. Aîné de trois garçons et
et d’une fille, Thibauld reçut une éducation fut toute militaire, quoique chrétienne.
L'enfant manifesta, dès son plus jeune âge, une grande dévotion à la sainte
Vierge qu’il honorait comme « sa bonne Mère et sa chère Maîtresse. » Il
s'intéressait beaucoup aux monastères dont son père était un grand bienfaiteur
: les Vaux-de-Cernay[1] et Port-Royal. Il fit le métier des armes et fréquenta
la cour.
Un jour que Thibauld
allait lutter à un célèbre tournoi, il passa devant une église à l’heure où
sonnait la messe ; il descendit de cheval, entra dans l'église et entendit la
messe tout entière avec d'autant plus de dévotion, qu'on la célébrait en
l'honneur de la sainte Vierge ; après la messe, il piqua vers ses compagnons,
mais il fut bien surpris de les voir venir au-devant de lui, pour le
complimenter de la victoire qu'il avait remportée dans les jeux. Il en témoigna
d'abord quelque étonnement, mais reconnaissant aussitôt, à ce qu'ils disaient,
que son bon ange avait pris sa figure et qu'il avait jouté en sa place, il ne
s'en expliqua pas davantage. Se retirant alors dans l'église d'où il venait,
après avoir rendu grâces à la Mère de Dieu d'une si insigne faveur, il fit vœu
de quitter le monde et de renoncer à toutes les grandeurs et aux satisfactions
que le siècle lui promettait.
C'est à l'abbé des
Vaux-de-Cernay, Thomas (1210-1229), qu'il confia ses désirs de vie religieuse.
Prudemment l'abbé conseilla au jeune homme de réfléchir en lui faisant
remarquer que la vie d'un cistercien ne ressemblait guère à celle d'un riche
chevalier. Mais Thibauld voulait justement embrasser la règle de Cîteaux à
cause de ses austérités. Il entra aux Vaux-de-Cernay en 1226.
Les moines ne tardèrent
pas à s'apercevoir de la sainteté de leur nouveau frère et, dès 1230, il fut
nommé prieur par l'abbé Richard qui mourut en 1235. Thibauld fut élu pour lui
succéder[2]. Il ne voulut être exempt d'aucune charge. Toujours le premier levé
et le dernier couché, il se chargeait d'entretenir le dortoir ou l'infirmerie
aussi bien que l'église, de nettoyer les habits ou les souliers. Il aidait les
maçons en portant le mortier ou les pierres, car Thibauld dut entreprendre des
travaux pour loger tous les moines dont le nombre allait atteindre deux cents ;
il allongea de douze travées le bâtiment des moines[3], construisit le dortoir
au-dessus et termina le bâtiment des convers. Il se contentait de vêtements
rustiques et tout ce qui lui servait était si misérable que, lors d'un chapitre
général, on lui reprocha de manquer de dignité. Il répondit simplement que ses
pauvres habits et son manque de luxe étaient conformes à ce qu'avait demandé
saint Bernard.
Thibauld se signalait
tout particulièrement par sa dévotion à la Vierge Marie à qui il rapportait la
gloire de tout ce qu’il disait et faisait ; lorsqu’on écrivait les livres pour
le chœur, il imposât qu’on écrivît toujours en lettres rouges son nom : « Nom
suave de la bienheureuse Vierge, Nom béni, Nom vénérable, Nom ineffable, Nom
aimable dans toute l'éternité. » Il disait ne douter nullement que Marie fût
élevée au-dessus de tous les anges et de tous les élus, et qu'elle ne méritât,
par conséquent, d'être aimée par-dessus toutes choses après Dieu. Lorsqu’on lui
reprocha d’avoir trop de dévotion à la Vierge Marie, il répondit : « Sachez que
je n’aime la Sainte Vierge autant que je fais, que parce qu’elle est la Mère
de mon Seigneur J »sus-Christ ; que si elle ne l’était point, je ne l'aimerais
pas plus que les autres saintes vierges. Ainsi, c'est Jésus-Christ même que
j’aime, que j'honore et que je révère en elle. » Ce grand amour lui méritait
souvent des grâces particulières. Un jour, il eut l’apparition de la Sainte
Trinité qui lui apprit que Dieu prenait un singulier plaisir lorsque l'on
chantait avec ferveur le cantique des trois enfants de la fournaise[4].
Ses prières étaient si
efficaces, qu'elles obtenaient de Dieu tout ce qu'il lui demandait. Un jour, un
novice de son monastère, violemment tenté, voulait renoncer à la vie religieuse
: le maître des novices n'oublia rien pour lui faire connaître que c'était un
artifice du démon, mais ce fut inutilement. Thibauld l'alla trouver lui-même,
et lui dit tout ce qu'un père peut dire à son enfant pour l'empêcher de se
perdre, mais il ne gagna rien. Enfin, il le pria d'attendre au moins jusqu'au
lendemain, pour exécuter sa funeste résolution, ce qu'il n'obtint qu'avec
peine. Après les Complies, Thibauld se mit en prière
pour lui ; il pria
jusqu’au lendemain où l’on trouva le novice si changé, si confus de sa
légèreté, si résolu de persévérer dans sa vocation, qu'il protesta qu'il ne
sortirait pas pour tous les trésors du monde.
L'évêque de Paris,
Guillaume d'Auvergne[5], se lia d'amitié avec lui et lui donna la direction
spirituelle des moniales de Port-Royal. Celles de Notre-Dame-du-Trésor dans le
Vexin lui furent confiées par le chapitre général de 1237. Il dut aussi
gouverner l’abbaye d’hommes de Breuil-Benoît, fille des Vaux-de-Cernay[6].
Ayant entendu parler de
la sainteté de l'abbé des Vaux-de-Cernay, saint Louis le fit mander à la cour.
La reine Marguerite de Provence étant stérile, les souverains firent part au
saint abbé de leur chagrin, et lui demandèrent de prier pour eux. Le 11 juillet
1240, la reine Marguerite mit au monde une fille, Blanche, qui mourut à trois
ans mais eut de nombreux frères et sœurs. Les prières du saint abbé avaient été
exaucées. Le roi et la reine témoignèrent à Thibauld leur reconnaissance, et,
malgré son désintéressement, l'abbaye des Vaux-de-Cernay en profita.
S’il ne joua pas un rôle
de premier plan dans l'ordre de Cîteaux, Thibauld reçut cependant plusieurs
missions importantes : en 1236, il fut chargé de l'inspection du monstère de la
Joie près Nemours ; en 1240 il composa un office pour la fête de la sainte
Couronne d'épines qui, à la demande de saint Louis, sera célébrée dans toutes
les abbayes du royaume. En 1242 et 1243, il dut défendre les intérêts de
l'ordre. Thibauld ne sortait qu'à regret de son abbaye, et, lorsqu'il était
dehors, il disait : « O mon âme, ton Bien-Aimé, celui que tu cherches et que tu
désires n'est pas ici ; retournons, je te prie, à Vaux-de-Cernay, c'est là que
tu le trouveras, que tu converseras avec lui et que tu auras le bonheur de le
voir par la foi dans l’oraison, en attendant que tu le voies face à face et tel
qu'il est en lui-même. Retourne, Sunamite, à ton monastère, retournes-y
promptement, et là tu adoreras ton Dieu avec plus de dévotion et de sûreté ! »
Thibauld, malade depuis
quelques temps, mourut le 8 décembre 1247. Il fut enterré dans le chapitre avec
ses prédécesseurs, et sur sa tombe les moines posèrent un simple dalle ornée
d'une crosse et de cette courte inscription disposée en équerre sur le côté
droit : « Hic jacet Theobaldus abbas » (Ci-gît l'abbé Thibauld).
Les pèlerins accoururent
en foule ; la reine douairière, Marguerite de Provence, et son fils, le roi
Philippe III le Hardi, vinrent plusieurs fois visiter le tombeau. Comme ils ne
pouvaient entrer au chapitre voir la tombe du saint, on transféra ses restes en
1261 dans la chapelle de l'infirmerie. Le 8 juillet 1270, après sa
canonisation, ses reliques furent portées dans l'église et placées dans un
sarcophage de pierre porté sur quatre colonnes. A la Révolution, l'abbaye fut
supprimée et les reliques dispersées à l'exception d'une petite partie qui est
actuellement conservée dans l'église de Cernay-la-Ville.
[1] L’abbaye des
Vaux-de-Cernay, à la limite des diocèses de Paris et de Chartres (actuel
diocèse de Versailles), a été fondée le 17 septembre 1118 par le Simon,
seigneur de Neaufle-le-Château, connétable du Roi, et son épouse, Eva, qui y
sont tous deux inhumés. L’église abbatiale est sous l’invocation de la sainte Vierge
et de saint Jean-Baptiste. L’abbaye appartint d’abord à la congrégation de
Savigny (diocèse d’Avranches), abbaye fondée en 1112 par saint Vital de Mortain
et Raoul de Fougères, qui eut jusqu’à une trentaine de filiales, en Normandie,
en France, en Angleterre et en Irlande. L’abbaye des Vaux de Cernay, avec
Savigny et ses filiales, se rattacha à Cîteaux en 1147 et adopta la règle
cistercienne. En partie ruinée, en 1193, lors de la guerre entre les rois de
France et d’Angleterre, l’abbaye des Vaux de Cernay fut relevée et agrandie ;
elle fut encore ravagée pendant la guerre de Cent ans et pendant les guerres de
Religion. Mise en commende en 1542, elle fut fort bien restaurée et entretenue
par la plupart de ses abbés commendataires. Après trente-trois abbés réguliers,
élus par leurs moines, il y eut dix abbés commendataires, nommés par le roi,
dont le dernier fut Louis-Charles du Plessis d’Argentré, évêque de Limoges,
nommé en 1766. Parmi les abbé commendataires, on remarque : le cardinal Antoine
Sanguin, dit le cardinal de Meudon, évêque d’Orléans puis archevêque de
Toulouse et grand aumônier de France (1542-1559) ; Louis II Guillart, évêque de
Tournai, de Chartres et de Châlons-sur-Saône (1560) ; Charles Guillart, évêque
de Chartres, qui fut un très mauvais abbé, malhonnête et entaché d’hérésie
(1561-1573) ; le poète Desportes qui fut un remarquable commendataire
(1588-1606) ; Henri de Verneuil (bâtard d’Henri IV) qui fit beaucoup pour son
abbaye et le bien-être des moines (1607-1668) ; le roi Casimir de Pologne
(1669-1672). L’abbaye fut de nouveau ruinée par la Révolution ; ce qu’il en
restait fut détruit par son propriétaire, le général Christophe, qui, pour
offrir à ses invités des divertissements inattendus, fit sauter ses plus beaux
restes l’un après l’autre, ne laissant que deux portes fortifiées, un peu du
cloître et une partie du chœur.
[2] Saint Thibauld de
Marly est le neuvième abbé des Vaux de Cernay :
Arnaud ou Artaud
(1118-1145) ; Hugues (1145-1151) ; Jean I° (1151-1156) ; André de Paris (1156-1161)
qui mourut évêque d’Arras (1173) ; Mainier (1161-1181) ; Guy (1181-1210) qui
mourut évêque de Carcassonne (1123) ; Thomas I° (1210-1229) ; Richard
(1229-1235).
[3] La salle des moines
est une des plus belles qui existent encore en France ; Thibauld fit couvrir
l’ancienne salle de voûtes sur croisées d’ogive retombant sur une épine
centrale et sur des colonnes adossées dont les bases et les tailloirs furent
relancés dans les anciens murs. Des contreforts furent montés à l’extérieur au
droit des colonnes.
[4] Livre de Daniel, III
47-56. L'abbé de Clairvaux rendit témoignage de ce fait après la mort de
Thibaud, à la cérémonie de l'élévation de son corps.
[5] Né à Aurillac vers
1190, Guillaume d’Auvergne fut d’abord chanoine de Notre-Dame de Paris (1223),
et professeur de théologie (1225) ; le pape Honorius III lui confia plusieurs
missions. A la mort de l’évêque Barthélemy de Paris (1227), Guillaume
d’Auvergne proteste contre l’élection anti-canonique de son successeur, et en
appelle au Saint-Siège ; Grégoire IX casse l’élection, se réserve le choix de
l’évêque de Paris, et désigne Guillaume d’Auvergne (10 avril 1228) qu’il sacre
lui-même. Dans les premières années de son pontificat, Guillaume d’Auvergne
entra successivement en conflit avec les maîtres de l’Université, les chanoines
et les officiers du roi. Par la suite, en parfait acord avec saint Louis, il
gouverna pieusement son diocèse où il protégea les ordres mendiants.
[6] L’abbaye de
Breuil-Benoît (diocèse d’Evreux) fut fondée en 1137 par Arnaud (ou Artaud),
moine de Savigny et premier abbé des Vaux-de-Cernay.
Autres Thibaults
Saint Thibauld de Provins (fêté
le 30 juin)
Thibauld, de la famille
des comtes de Brie et de Champagne, avait pour arrière-grand-oncle le saint
archevêque Thibauld de Vienne[7] qui prédit un jour à sa nièce : « De la fille
que vous mettrez au monde, naîtra un enfant qui surpassera en vertu tous ses
parents. » Thibauld, fils d’Arnulf et de Willa, naquit à Provins, probablement
en 1017 ; son parrain fut le comte Thibauld III de Blois.
Le jeune Thibauld, élevé
dans la piété, admirait la vie d'Elie au mont Carmel, de saint Jean-Baptiste
sur les bords du Jourdain, de saint Paul el de saint Antoine dans la Thébaïde,
n'aspirant qu'à se retirer lui-même dans la solitude ; il rendait de fréquentes
visites à l’ermite Burchard qui vivait dans une petite île de la Seine.
Le comte Arnulf ayant
voulu confier à son fils le commandement des troupes qu'il envoyait à Eudes II
de Champagne pour l'aider dans sa lutte contre l'ernpereur Conrad le Salique,
Thibauld obtint la perrnission de ne pas prendre part à la guerre, et de se
retirer du monde. Il se rendit donc avec son ami Gautier jusqu'à l'abbaye
Saint-Remi de Reims, puis en Allemagne, après s'être revêtu de vêtements de
mendiants. Tous deux s'installèrent dans la forêt de Pettingen, à seize
kilomètres au nord de Luxembourg, région qui faisait alors partie du diocèse de
Trèves ; ils allaient dans les villages voisins pour aider les maçons et les
cultivateurs, ou fabriquaient du charbon de bois pour les forges ; ils
gagnaient ainsi quelque argent qui suffisait à leur entretien et à leur
nourriture.
Ils devinrent par leuls
vertus l'objet d'une telle vénération qu'ils résolurent de quitter le pays ;
ils partirent, pieds nus, pour Saint-Jacques de Compostelle puis, au retour, se
dirigèrent vers Rome. Ils avaient visité les principaux lieux de pèlerinage,
quand leur vint la pensée d'aller jusqu'à Jérusalem ; mais, sur la route de
Venise où ils pensaient s'embarquer, ils s'arrêtèrent épuisés et se fixèrent à
Salanigo, entre Vicence et l'abbaye de Vangadizza, au diocèse d'Adria. Il y
avait là une chapelle en ruines, dédiée à saint Herrnagoras et à saint
Fortunat, près de laquelle ils bâtirent deux cellules ; deux ans plus tard,
Gautier mourut. Thibaud redoubla ses austérités, ne mangeant que du pain
d'avoine avec des légumes, dormant sur la planche puis, dans les dernières
années, assis simplement sur un banc : les anges lui apparurent sous les formes
les plus gracieuses ; plusieurs miracles le firent reconnaître comme saint.
L'évêque de Vicence n'attendit rien de plus pour l'élever au sacerdoce.
Sa renommée étant
parvenue jusqu'au comte Arnulf, celui-ci résolut, avec sa femme, de se rendre
jusqu'en Italie ; arrivés à Salanigo, ils ne purent que se prosterner devant
leur fils sans dire une parole ; ils voulurent, eux aussi, se consacrer à Dieu,
mais Arnulf ayant été rappelé en Brie pour ses affaires, Willa resta seule
auprès de Thibauld qui entreprit de la former à la vie anachorétique. Peu
après, il fut attaqué d'une maladie qui lui couvrit d'ulcères le corps entier ;
il envoya chercher l'abbé de Vangadizza qui lui avait donné l'année précédente
l’habit des camaldules, et mourut un vendredi soir, après avoir répété
plusieurs fois : « Seigneur, ayez pitié de votre peuple »; c'était le 30 juin
1066.
Le corps de saint
Thibauld qui, après la mort, n'eut plus trace de ses ulcères, fut apporté le 3
juillet dans la cathédrale Notre-Dame de Vicence, et enseveli dans la chapelle
des saints martyrs Léonce et Carpophore dont il fut secrètement enlevé en 1074,
pour être porté à l'abbaye de Vangadizza où Arnoul, frère du saint, abbé de
Sainte-Colombe-lez-Sens et de Saint-Pierre de Lagny, vint lui-même les chercher
des reliques qui furent reçues solennellement à Sens, puis partagées entre ses
deux abbayes. A la suite d'un miracle qui se produisit sur une colline voisine,
au bois des Hêtres, on construisit une église dédiée à saint Jean-Baptiste qui
fut l'origine du prieuré Saint-Thibauld-des-Vignes ; les reliques qui y furent
transférées (un os du bras) furent sauvées en 1793,comme celles de
Sainte-Colombe qui furent transférées dans le trésor de la cathédrale de Sens.
Les autres reliques de saint Thibauld son conservées à Adria, dans l'église
archipresbytérale de’Adria, sous un autel qui lui est dédié, et à la cathédrale
de Vicence.
Il existe encore un autre
saint Thibauld : saint Thibauld d’Alba, confesseur fêté le 1° juin. Né à
Vico, près de Mondavi, dans une famille aisé, il fut si fasciné par la pauvreté
qu’il quitta sa maison et vint s’embaucher à Alba, chez un fabricant de
chaussures. A la mort de son patron qui voulait lui faire épouser sa fille, il
partit, sans un sou, faire le pèlerinage de Compostelle. Retourné à Alba, il se
fit portefaix, et vécut dans la plus totale pénitence, occupant ses loisirs à
consoler les malheureux et à balayer la cathédrale. On dit qu’il aurait
ressuscité plusieurs enfants morts. Il mourut en 1150, et fut enterré dans un
terrain vague, près de la cathédrale d’Alba.
[7] Saint Thibauld,
évêque de Vienne et confesseur, naquit à Tolvon, vers 927. Petit-neveu du
roi de Bourgogne et arrière-grand-oncle de saint Thibauld de Provins, élevé
chez le roi Conrad, il fut nommé évêque de Vienne (957). Il distribua ses biens
aux pauvres, et il affranchit la plupart de ses serfs. Il présida un concile
qui réunissait les évêques des provinces de Lyon, de Vienne et de Tarentaise
(994) où l’on confirma les possessions des abbayes de Cluny et de Romans,
défendit la chasse aux clercs, sévit contre les clefcs mariés, fit obligation
aux prêtres d’apporter le viatique aux mourants. Il mourut le 21 mai 1001, date
retenue pour sa fête.
SOURCE : http://missel.free.fr/Sanctoral/07/08.php
Saint Thibauld de Marly. Vitrail de l'église du Perray-en-Yvelines (France)
Also
known as
Theobald
Thibaut
8 July on
some calendars
27 July on
some calendars
Profile
Born to the French nobility,
he served as a knight before
renouncing worldly life and property to become a Cistercian monk. Abbot of
Vaux-de-Cernay monastery in
Yvelines, France,
a house with 200 monks,
in 1235.
Known as the humblest of the brothers.
1247 of
natural causes
in England
in France
a knight with
the coat of arms of Thann, France
man wearing a Cistercian habit over
a suit of armour,
often with a mitre at
his feet
Additional
Information
Book
of Saints, by the Monks of
Ramsgate
books
Our Sunday Visitor’s Encyclopedia of Saints
Saints
and Their Attributes, by Helen Roeder
other
sites in english
images
sitios
en español
Martirologio Romano, 2001 edición
sites
en français
fonti
in italiano
MLA
Citation
“Saint Thibaud de
Marly“. CatholicSaints.Info. 6 April 2024. Web. 10 February 2025.
<https://catholicsaints.info/saint-thibaud-de-marly/>
SOURCE : https://catholicsaints.info/saint-thibaud-de-marly/
Book of Saints –
Theobald – 8 July
Article
(Blessed)
(July
8) (13th
century) A French noble
of the Montmorency family who, renouncing his worldly prospects, became a Cistercian monk.
“He lived (says Butler) in the midst of his brethren as the servant of every
one, and surpassed all others in his love of poverty, silence and holy prayer.”
He died A.D. 1247.
MLA
Citation
Monks of Ramsgate.
“Theobald”. Book of Saints, 1921. CatholicSaints.Info.
8 July 2016. Web. 10 February 2025.
<https://catholicsaints.info/book-of-saints-theobald-8-july/>
SOURCE : https://catholicsaints.info/book-of-saints-theobald-8-july/
Theobald of Marly, OSB
Cist. Abbot (AC)
(also known as Thibaut)
Born at Marly Castle,
Montmorency, France; died December 8, 1247. Saint Theobald, son of Bouchard of
Montmorency, was trained to take up the profession of arms, although he had
always displayed an inclination to a life of prayer. Nevertheless, he was a
distinguished knight at the court of King Philip Augustus II, even while he
resorted frequently to the convent church of Port-Royal. He abandoned his
worldly goods in order to enter the Cistercian monastery of Vaux-de-Cernay in
1220. He was highly esteemed by King Saint Louis of France, as well as his
brothers in religion who elected him prior in 1230 and abbot in 1235. Even as
abbot he lived in the midst of his brethren as the servant of every one, and
surpassed all others in his love of poverty, silence, and holy prayer.
Theobald's shrine at Vaux-de- Cernay is visited by many people on Whitsundays.
His solemn feast is kept there July 8 and in some places on July 9, which is
probably the day on which his relics were first translated (Benedictines,
Husenbeth, Walsh). In art, Saint Theobald is a knight bearing the arms of Thann.
He may, at times, wear armor under his Cistercian habit with his miter at his
feet (Roeder). He is venerated in Thann (Alsace) and Hemel Hempstead (Roeder).
SOURCE : http://www.saintpatrickdc.org/ss/0727.shtml#thib
Saint Theobald of Marly
Jul 09, 2015 /
Written by: America
Needs Fatima
Feast July 27
Theobald was the son of
Bouchard of Montmorency, one of the most illustrious families of Europe.
They were constables of
France, marshals, admirals, cardinals, grand officers of the crown and grand
masters of various knightly orders.
And yet Theobald is
called the “great ornament” of the family of Montmorency.
He was born in the family
castle of Marly, highly educated and trained as a knight.
He served for a time in
the court of King Phillip Augustus II, but showed a strong inclination to a
state of retirement.
Even at court he spent a
long time in prayer and often visited the church at the convent of Port Royal
founded by a relative, and which his father largely endowed.
Theobald took the
Cistercian habit at Vaux-de-Cernay in 1220 and was chosen abbot in 1235.
He lived in his monastery
as the servant of all, surpassing others in his love of poverty, silence and
prayer.
He was known to King St.
Louis IX who held him in high esteem and veneration.
Theobald died on December
8, 1247.
SOURCE : https://americaneedsfatima.org/articles/saint-theobald-of-marly
Reliques
de Saint Thibaut de Marly dans leur châsse. Elles étaient conservées à l'abri à
l'église St-Brice de Cernay-la-Ville lorsque j'ai obtenu du curé qu'elles
soient exposées à la vénération du public.
Relics
of Saint Thibaut de Marly in their shrine. They were kept in the church of
St-Brice in Cernay-la-Ville when I asked the parish priest to put them on
display.
San Teobaldo di
Marly Abate dei Vaux-de-Cernay
Festa: 8 dicembre
† Vaux-de-Cernay,
Francia, 8 dicembre 1247
Teobaldo, figlio dei
Signori di Marly, parente di Luigi VII, dapprima abbracciò il mestiere delle
armi, distinguendosi nei tornei, pur avendo una spiccata devozione verso la
Madre di Dio; poi nel 1226 veste l’abito cistercense nell’abbazia di
Vaux-de-Cernay. Nel 1235 viene eletto abate, incarico che tenne fino alla morte
avvenuta l’8 dicembre 1247. Si narra di lui due episodi significativi: la
preveggenza dei figli di san Luigi re di Francia e il fatto che aiutava i
muratori nei lavori di in gradimento del monastero. Il culto fu riconosciuto da
papa Clemente XI nel 1710. La memoria liturgica è presso l’Ordine Cistercense
l’8 luglio.
Martirologio
Romano: Presso Vaux-de-Cernay nel pressi di Parigi, san Teobaldo di Marly,
abate dell’Ordine Cistercense, che serviva i suoi confratelli svolgendo le
mansioni più umili.
Figlio di Bou-chard di Montmorency, signore di Marly, e di Matilde di Chateaufort, nipote del re Luigi VII, Teobaldo abbracciò dapprima il mestiere delle armi, distinguendosi nei tornei, cosa che non gli impedì di nutrire una grande devozione alla Madonna.
Nel 1226 prese l'abito cistercense nell'abbazia dei Vaux-de Cernay, appartenente alla congregazione di Savigny, che nel 1147 era passata in blocco all'ordine di Cìteaux, nella filiazione di Clairvaux. Fu formato alla vita religiosa dall'abate Tommaso (1212-1229). Nel 1230 fu nominato priore da Riccardo, succeduto a Tommaso, e alla sua morte, nel 1235, fu eletto abate. Egli veniva così ad esercitare un diretto superiorato sull'abbazia di Breuil-Benoit ed anche su quella femminile di Port-Royal, della quale suo padre era stato benefattore. Nel 1237 ebbe pure il governo dell'abbazia delle monache del Trésor, nella diocesi di Rouen. Nella nuova carica Teobaldo dette esempio di umiltà e di pietà, mantenendo la povertà negli abiti e in tutto il suo tenore di vita. Si racconta che aiutò i muratori trasportando pietre e calcina durante i lavori che fece eseguire per ingrandire una sala del monastero e per costruire una parte dell'edificio destinato ai fratelli conversi.
La fama della sua santità cominciò a diffondersi e pervenne alle orecchie del re s. Luigi, il quale dopo cinque anni di matrimonio con Margherita di Provenza era ancora senza figli. Si recò dunque con la moglie a trovare Teobaldo ai Vaux-de-Cernay e gli chiese di pregare Dio perché concedesse loro la grazia di avere dei figli. Una pia leggenda narra che il santo abate prese, come risposta, un cesto dal quale uscirono undici gigli di candore smagliante, simbolo che si riferiva agli undici figli che dovevano nascere dalla unione dei sovrani. Il pittore J. M. Vien ha riprodotto questa scena in un quadro eseguito nel 1774, destinato alla cappella del Petit Trianon a Versailles, dove si può vedere ancor oggi. Fu cosi che la regina Margherita dette alla luce, nel 1240, una bambina che ricevette il nome di Bianca.
Dopo dodici anni di fecondo governo abba-ziale, T. mori nella sua abbazia dei Vaux-de-Cernay, l'8 dic. 1247 e fu sepolto nella sala del capitolo. Sulla sua tomba fu posta una lastra di pietra sulla quale fu inciso un pastorale, con questa iscrizione:
Hic Jacet Theobaldus abbas.
La fama della sua santità portò grandi pellegrinaggi ai Vaux-de-Cernay, tanto che nel 1261, sotto la direzione dell'abate di Clairvaux, fu fatta la traslazione delle spoglie nella cappella dell'infermeria, accessibile a tutti. Una seconda traslazione ebbe luogo nel 1270, in un sepolcro costruito nella navata della chiesa, dove si leggeva questo epitafio:
Mille bicento septimo cum quadrageno caelo clarescit Theobaldus ubi requiescit.
Questa tomba fu profanata nel 1793. Si dice che alcune reliquie conservate nella chiesa di Cer-nay-la-Ville provengano da essa.
La festa di Teobaldo veniva celebrata nell'abbazia dei Vaux-de-Cernay e il suo culto fu riconosciuto dal papa Clemente XI, il 25 sett. 1710. Nel XVII sec. gli fu dedicato un altare nella chiesa dell'abbazia di Cìteaux.
Teobaldo è onorato nelle diocesi di Parigi e di Versailles. Nell'Ordine Cistercense se ne fa memoria nel Breviario in data 8 luglio.
Autore: Marie-Anselme Dimier

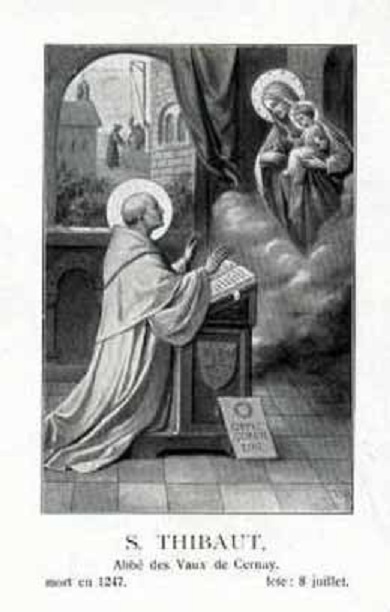
.jpg)
