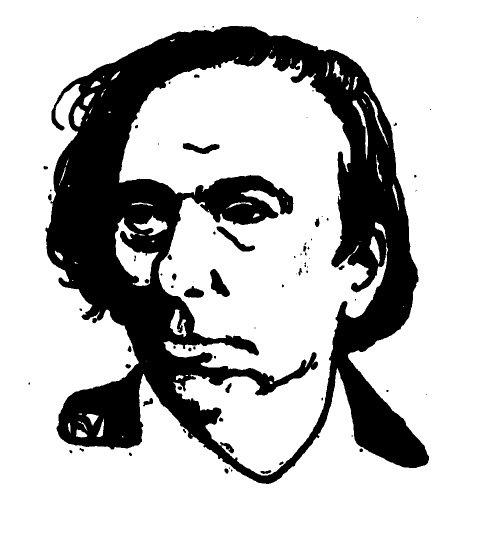La philosophie d’Ernest
HELLO
par
Stanislas FUMET
I
ET DE TOUT TON ESPRIT
Chemah Israel, ADONAÏ
Elohenou, ADONAÏ ehad. Écoute, Israël, Jéhovah notre Dieu, Jéhovah est un.
C’est ainsi que commence la prière de tous les Hébreux. Et c’est là l’ouverture
de l’enseignement mosaïque, la base même de la doctrine confiée à Israël, et
qui indique son élection pour toujours et le secret de sa cohésion. Parce que
notre Dieu es un, toi, son peuple, es marqué du signe de l’unité. Et le
commandement liminaire, qui contient toute la loi, est le suivant : « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme-esprit et de
toutes tes forces. »
Voilà ce que les Juifs
eurent à méditer en se levant et en marchant, ce qui leur fut gravé dans le
coeur ; voilà ce qu’ils ont eu lié à leur main, ce qu’il leur a fallu porter
entre leurs deux yeux. Et c’est aussi ce qu’ils ont inscrit sur le seuil et sur
les poteaux de leurs maisons.
Chemah Israel, ADONAÏ
Elohenou, ADONAÏ ehad. V’ahabta et ADONAÏ Eloheka becal lebabka, oubecal
naphcheka, ou becal mehodeka.
– Dites quel est le plus
grand commandement, Seigneur ?
Et Jésus répond,
traduisant le Chemah : « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre
coeur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C’est là le plus grand et le
premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable : Vous aimerez
votre prochain comme vous-même. » (MATTH., XXII, 39.)
ADONAÏ ehad, le Seigneur
est un. Et l’Unité commande aussitôt son culte, qui est d’aimer Dieu de tout
son coeur, de toute son âme et de tout son esprit, et, par une conséquence
naturelle, le prochain, – l’autre, eût dit Pythagore, – comme soi-même. Tout
cela sera renfermé dans la prière du Christ : « Ut sint unum, sicut et nos unum
sumus. »
Le chrétien, qui vient
jouer le rôle d’Israël – car l’Israël de Moïse s’est arrêté sur le chemin et il
a suspendu, pour gémir dans les ténèbres de son aveuglement, ses harpes aux
branches des bosquets qui ne sont plus à lui, – le chrétien, dans une intime
familiarité avec Dieu, prononce tout bas ce qu’il appelle un acte de charité :
« Mon Dieu, je vous aime de tout mon coeur, de toutes les puissances de mon
âme, de tout mon esprit et par-dessus toutes choses, parce que vous êtes
infiniment bon, infiniment parfait, infiniment aimable, et j’aime mon prochain
comme moi-même pour l’amour de vous. » Il sait, héritier des droits du Juif,
son frère aîné, puisqu’il est le nouveau Jacob, le nouveau Supplantateur, que
c’est là toute la loi du Christ.
Quoi qu’on en ait dit,
l’homme du moyen âge n’aimait pas irréprochablement Dieu de tout son coeur. Il
gardait en soi des duretés exécrables. Mais au moins il aimait Dieu de tout son
esprit. Son intelligence entière dérivait de la connaissance qu’il pouvait
avoir de l’Objet adoré. À cause de son attachement à l’unité, il recevait des
aptitudes à la synthèse qui paraissent nous être défendues aujourd’hui. Ne
s’embarrassant point des complexités troublantes que l’ignorance empirique,
issue du doute, a éveillées sans compter, l’homme du moyen âge ne perdait ni
son temps ni son orientation. Il ne se plaçait pas hors de la sphère où il avait
à assurer sa position providentielle. L’homme du moyen âge ne différait donc
pas, extérieurement, de l’homme antique ; il envisageait le monde à la façon
d’un admirable tableau à déchiffrer. Mais, alors que l’antiquité rêvait d’une
clef féerique pour en dégager le sens, le philosophe, l’artiste, l’agriculteur,
le soldat médiévaux n’y distinguent rien qui ne soit soumis au signe de la
Croix. Ils n’ont pas la tentation de penser qu’ils s’égarent : ils ont un Dieu
fait chair qui ne les abandonnera jamais ; ils savent que le problème est
résolu et, en attendant le paradis qu’il faut gagner, essaient de rendre
grâces, chaque jour, sur la terre. La situation de l’homme, une fois admise la
rédemption telle que l’enseigne l’Église, n’a plus rien d’inconsistant comme
chez le païen. La vie morale est sévère, mais le péché, qui appelle sa
sanction, est une lampe infernale qui élucide toutes les difficultés. On sait
qu’il attaque Dieu, et on le hait, alors que même on le pratiquerait
journellement. On confesse, au surplus, qu’il est susceptible de miséricorde et
que la pénitence lave, parce qu’on sait que Dieu est Dieu, mais qu’Il est aussi
Emmanuel, Dieu avec nous. La fatalité est vaincue par la prière, la nature
elle-même n’est plus invincible et le gangrené peut demander à un saint de le
guérir. Dieu se touche par la foi, qui est une main plus sûre que la main
charnelle, et mieux éprouvée. L’intelligence est droite, la voie est directe ;
la Croix du Golgotha se tient au milieu du monde comme une balance parfaitement
ajustée qui pèse l’homme en Dieu. Aussi la vie morale n’est-elle plus ce
cauchemar que les païens connaissaient et qui les faisait tragiquement se
détourner de leur propre âme avec un sentiment de peur.
Le chrétien moderne,
autant que l’on puisse généraliser, est bien différent du chrétien du moyen
âge. Sa formation est tout l’opposé de celle de son ancêtre. Il ne voit pas les
choses sous le même angle. Pour lui, Dieu est excessivement lointain. Le
chrétien moderne, comme il nous apparaît fréquemment et non pas comme il est
toujours, enfin le chrétien moderne du type courant, s’adonnera peut-être à la
vertu, en y mettant une certaine application, il considérera ses péchés en
détail et les poursuivra non sans quelque vigilance. Il sera capable de
secourir les pauvres, ce qui n’est pas toujours commode ; il s’oubliera en
soignant les malades ; il fera le bien, ira aux sacrements avec persévérance,
remplira son devoir quotidien, professera la doctrine de l’abnégation la plus
haute et même s’efforcera d’aimer Dieu, ou Jésus-Christ, de tout son coeur.
On voit aussi des
chrétiens aimant Dieu de toute leur âme. Il suffit de parcourir les communautés
religieuses pour s’aviser de l’existence d’un très grand nombre de personnes
merveilleusement consacrées à Lui, au sens le plus profond du mot. Il y a, dans
nos pays, des envols à toute heure.
Mais, d’une manière
générale, il semble que l’on n’aime plus tellement Dieu de tout son esprit. Le
même homme qui offre son coeur et son âme chaque matin à son Seigneur peut,
dans la journée, lui refuser son esprit. Le même homme qui s’abandonne en tant
que créature, qui est disposé, s’il le faut, à mourir pour défendre l’autel où
il trouve l’aliment nécessaire à la vie de son âme, participera sans inquiétude
à de multiples vagabondages de l’esprit, où les plans de Dieu non seulement ne
sont pas respectés mais encore sont soumis à toutes les subversions. Il ne sera
pas déchiré par l’abomination de l’erreur et, s’il est sur le terrain de la
vérité, il ne préférera pas rigoureusement celle-ci à quelque hypothèse
instable. Enfin il attendra tout de la science humaine et ne désirera à peu
près rien de la Lumière de Dieu. Il aura du mal à se figurer que la terre,
comme le ciel, est en relation avec la Pensée divine et que Dieu entend régner
en haut et en bas. Lui qui reconnaît aisément la volonté de ce même Dieu quand
la morale est en cause, lui qui est pieux, il ne la reconnaît plus guère dans
le domaine de l’esprit.
Ce chrétien-là mentirait
en disant qu’il s’intéresse plus à Dieu qu’à l’objet de son métier manuel ou
intellectuel, et que Dieu est supérieur à toute distraction. Si un reproche
analogue est adressé à son coeur, voire à son âme, il se rebiffera et s’écriera
peut-être : « Ce n’est pas vrai ! » Mais, pour ce qui est de l’esprit, le fait
est indéniable. On ne ressent plus ce besoin dévorant de la gloire du nom de
ADONAÏ que de vieilles générations ont proclamé. Cette seule idée de la gloire
même de Dieu n’est plus très intelligible. On voudrait lui en substituer de
moins éclatantes, car l’esprit, comme le sel de la terre, s’est affadi. L’oeil
spirituel de l’homme, à force de s’être tourné vers l’ombre, a perdu sa santé
première et, si d’aventure le soleil vient à le frapper, la cuisson qu’il en
éprouve le fait singulièrement souffrir.
Quand l’oeil s’est trop
habitué aux ténèbres, l’entendement penche à conclure, avec les philosophes de
compromission qui furent si hardiment refoulés par le grand Pie X, que ce n’est
peut-être pas pour la lumière que cet oeil avait été créé.
Or, au siècle dernier, un
homme s’est plaint, avec une véhémence étrange, que l’on n’aimât pas assez Dieu
de tout son esprit. Cet homme, qui, de l’avis de tous ceux qui l’ont rencontré,
ne ressemblait à aucun autre, s’appelait Ernest Hello. Ce n’était pas un saint,
dit-on ; ce n’était pas un sage non plus. C’était un être exceptionnel, en qui
deux puissances luttaient à mort, dans un simulacre de combat statique ; et ce
combat n’est point sans rappeler celui que se livrèrent mystérieusement, de la
nuit à l’aube, le patriarche Jacob et cette Personne humaine rencontrée sur la
route, qui était un Ange et qui ne haït pas de se laisser vaincre. Mais le
pauvre Hello ne se rendait que faiblement compte de ce qui se passait en lui,
et toutes les difficultés de son âme, l’intermittence des vertus de son oeuvre,
l’émotion aussi qui faisait parfois trembler ses phrases provenaient de ce duel
insolite.
Il se voyait un, et sans
doute ne s’expliqua-t-il jamais les raisons qui condamnaient la vérité comme il
la disait à ne point triompher d’une manière irrésistible.
Quelle intelligence et
quel coeur se sont plus étonnés que le Bien, le Beau et le Vrai n’eussent été
jugés préférables au mal, à la laideur et à l’erreur ?
Soyez étonnés, et gardez
longtemps votre étonnement. Ne le perdez pas en avançant dans la vie. Qu’il
soit votre compagnon de voyage. Car le jour où vous le perdriez, il tomberait
de votre front une couronne très précieuse qui ne se relève jamais, quand elle
est une fois tombée (1).
On ne s’étonne plus des
choses monstrueuses, dit toujours Hello, parce qu’on en a pris l’habitude.
C’est sa rengaine. Mais jamais Hello, quant à lui, ne s’habituera à la terre du
péché. Il ne cesse de s’étonner. L’étonnement est un mot qui revient combien de
fois sous sa plume !
On a pris l’habitude de
regarder comme une chose toute simple la place qu’occupe l’idolâtrie sur la
terre. On apprend dans son enfance que les nations étaient idolâtres. On reçoit
cette nouvelle à un âge où l’on n’est pas encore capable de ressentir l’étonnement
qui lui serait dû ; et l’on se souvient de cette nouvelle à un âge où l’on
n’est plus capable de ressentir la stupeur qu’elle mérite. Entre ces deux âges,
pour beaucoup d’hommes, il n’y a pas d’âge intermédiaire (2)...
Et, dans un autre livre,
où il constate, à propos de Voltaire, son obsédant ennemi, que l’idolâtrie «
aime à s’agenouiller sans regarder l’idole, car quelquefois l’idole n’est pas
belle », il déclare :
Quand l’homme est
incroyant et révolté, c’est étonnant comme ses genoux s’accommodent facilement
d’une idole quelconque (3).
C’est étonnant, comme
nous allons d’un pas sûr à l’encontre de ce qui nous serait d’un éternel
avantage, comme nous courons régulièrement à notre ruine et prenons du plaisir
à fuir la joie intérieure qui nous convoque, de toutes ses clameurs accumulées,
dans le silence où elle réside. C’est étonnant que l’intelligence qui a été
faite pour l’Être se désintéresse surtout de l’Être. C’est étonnant que la
médiocrité prospère toujours.
Assis à votre bureau, en
face d’un livre signé d’un nom connu, et que le bruit public désignait à votre
attention, ne vous est-il jamais arrivé de le fermer avec une tristesse
inquiète et de vous dire : « Comment ces pages ont-elles conduit l’auteur à la
réputation au lieu de le condamner à l’oubli (4) ? »
Cela aussi l’étonnait, et
il y a de quoi ! Je trouve l’observation si judicieuse. Ne supposerait-on pas,
à prendre connaissance de la plupart des livres en renom, dont les gens sérieux
discutent les mérites, que ces ouvrages avaient été conçus et exécutés dans
l’intention formelle de ne pas être remarqués ?
Hello s’étonnait de la
lenteur des événements.
– Je m’étonne, dit-il un
jour à Henri Lasserre en sortant de l’Exposition, que les Tuileries ne brûlent
pas encore.
Il avait raison de
s’étonner, puisque les Tuileries ne tardèrent pas à flamber.
Aristote voyait la cause
occasionnelle de la philosophie dans une sorte d’étonnement, d’« admiration »
précaire. Mais il s’agissait là de l’étonnement qui ne comprend pas et qui a
besoin d’être dissipé par la connaissance. D’où la philosophie. L’étonnement
d’Hello est plus élevé ; il est conscient : c’est une admiration supérieure,
une admiration qui déjà sait obscurément, parce qu’elle croit, et qui adore,
prie, témoigne. Ce que l’étonnement d’Hello engendre, c’est la philosophie,
sans doute, mais avec la poésie, ou prophétie, liée à elle, et se tenant l’une
et l’autre volontairement bien embrassées, pour dégager toute la louange. Hello
n’est philosophe que parce que la philosophie est la lecture de l’Être et que
son but est de découvrir en toutes choses le Verbe de cet Être. Il ne pense pas
que la philosophie ait besoin d’une épithète ; il ne la veut ni grecque ni
chrétienne ; il la veut telle qu’elle est, universelle, par conséquent catholique,
et vraie, par conséquent chrétienne. Pour Hello elle n’a qu’une exigence :
affirmer. Comme il chérit la simplicité et qu’il a un coeur d’enfant, il ne
s’encombre pas des systèmes ; il les réprouve globalement en les rattachant à
la Négation.
Les systèmes sont des
machines à torture, et il n’y a rien de compliqué comme une machine à torture ;
la vérité est un soulagement. Il y a du repos dans la notion de la vérité. Elle
donne à l’esprit une fête reposante et musicale. La vérité est le sabbat de
l’esprit (5).
Tout ce qui n’est pas un
et ne fait pas le signe de la Croix, tout ce qui ne se fonde pas sur Abraham,
ne se transmet pas par Moïse, ne s’appuie pas sur Céphas, rentre plus ou moins
dans l’armée qui oppose sa négation séculaire à Celui qui est l’affirmation de
l’Être et qui se dénomme, de son nom philosophique et johannique, le Verbe.
Le zèle d’Ernest Hello
peut lui faire prendre, à la rigueur, la connaissance naturelle, qui ne fonce
pas en droite ligne sur le divin, pour la négation de ce qui est exclusivement
objet de Révélation. Il y a quelque injustice de sa part à ne point citer
Aristote, qu’il utilise à travers saint Thomas et dont il adopte lumineusement,
pour remplacer toutes les constructions de l’athéisme et du panthéisme, les
distinctions fondamentales de la puissance et de l’acte, de la matière et de la
forme. Par contre, il ne cache pas sa tendresse pour Platon, en qui il voit
deux hommes : le Grec ou le rhéteur, qu’il méprise, et l’Oriental ou le
contemplateur, qu’il salue fraternellement.
La Grèce, en général, ne
lui plaisait pas. L’Inde, au contraire, qu’il critiqua cependant avec une âpre
sévérité, l’Inde qui lui semblait la terre du panthéisme absolu et comme
l’enfer de la spéculation, l’Inde qui précipitait, à ses yeux, l’univers au
non-être par amour du désespoir illimité, aurait eu quelques chances de le
séduire en vertu de la générosité de son gouffre. Mais il lui opposait sa
triomphale et réaliste philosophie de l’Être et rejetait la première, comme une
luciférienne tentation, dans l’empire des ombres qui ne sont pleines que de
leur propre inconsistance.
Il faut dire que l’on n’a
jamais suivi dans ses derniers retranchements toute la pensée d’Ernest Hello
quand il s’agit de la mystique païenne. Il est de ceux qui aiment tant les
solutions entières et qui synthétisent avec un enthousiasme tel, que les problèmes
qu’ils se sont posés n’apparaissent pas nécessairement à la surface de leur
oeuvre. Les gens comme Hello, qui, grâce à leur catholicisme, ont le droit de
se réclamer de la vérité indélébile, sont naturellement pressés de conclure.
Avant qu’ils ne soient au bout de l’énoncé, ils ne se retiennent pas de laisser
éclater le mot de la théologie, le dogme qui résout impitoyablement. Et cela
couvre tout. Mais il n’empêche que les questions de l’ignorance ou de l’erreur,
avec leur angoisse, ont pu tracasser le philosophe ; elles ne lui ont pas été
inutiles, puisqu’il a su en extraire de nouveaux arguments de crédibilité qui
ont affermi sa science. J’imagine que l’homme ardent qui accuse l’Inde, parce
qu’elle est probablement panthéiste, a senti remuer en lui, profondément, les
mystères de la pensée hindoue. Il est non moins certain que la philosophie de
Hegel et l’erreur capitale – je dirai la confusion essentielle – d’un nouveau
système où l’être et le néant sont pris pour des identités arrêtèrent aussi un
instant le regard de flamme d’Ernest Hello. Il ne leur a pas cédé, évidemment,
puisqu’il savait où trouver le défaut de la cuirasse panthéiste, et que la part
de vérité qui se dissimule sous l’hérésie était complètement libérée dans la
totale sagesse du catholicisme, où rien ne manque de ce qui, au dehors,
pourrait être bon ; mais la préoccupation qu’ont eue les mystagogues de
l’antiquité et qui est réapparue un moment, dépouillée de sa splendeur
orientale, il est vrai, dans le fuligineux cerveau du professeur allemand,
était celle dont Hello avait le plus aimé la solution éblouissante chez les
théologiens mystiques patronnés par l’Église. L’abîme qui appelle l’abîme et
fait que le vide, puissance de tout, en invoquant la Toute-Puissance, contracte
avec celle-ci une relation universelle, établissait pour lui non seulement le
geste de l’oraison, mais le mouvement encore de la métaphysique.
On conçoit alors quelle
honte pouvait lui inspirer la pseudo-philosophie française, embourgeoisée
depuis le dix-huitième siècle et à qui la métaphysique était restée si
absolument impénétrable.
Ce qui caractérise
presque tous ceux qui, en France, bavardent philosophie, c’est une ignorance
qui touche au prodige.
Les bases du monument
n’étant pas posées, chacun lance une pierre au hasard, avec un geste grimaçant,
pour voir si de toutes ces pierres il résultera un édifice (6).
C’est pourquoi
l’Allemagne avait pour lui un charme qu’il ne niait pas. « Je vais adresser la
parole à une grande nation », écrit-il un jour.
Depuis que je vis, depuis
que je pense, elle a occupé ma pensée... J’aime sa grandeur sereine et sa
sévérité (7).
On comprend qu’Hello,
toute haine pour le protestantisme allemand, ne détestait pas cette envergure
que l’Allemagne essayait, par la philosophie, de donner à son hérésie
inexpiable. Cette gravité germanique, ce soin des problèmes essentiels, cette
hauteur du front qu’affecte la pensée allemande, ce point de vue cosmique, ce
ton pathétique, ce caractère, enfin, ordonné par en haut que le romantisme y a
pris, tout cela militait singulièrement contre les petits bourgeois de la
tradition française qui n’ont jamais eu qu’une crainte : celle de se répandre
au large.
Hello, en combattant
Hegel, rêvait du retour de l’Allemagne intellectuelle à la Vérité. Ce souhait
lui « remplissait l’âme » :
L’Orient, berceau du
monde, fut le théâtre de la première scission, de la première catastrophe.
L’Allemagne a été dans l’Europe comme un autre Orient. C’est elle aussi qui a
fait le grand malheur, le péché originel de la société moderne : le
protestantisme. Elle a ouvert la source de l’erreur et de la révolte.
Si Hello a surtout
envisagé Hegel dans la philosophie allemande, c’est que l’hégélianisme
atteignait plus hardiment les frontières de la métaphysique que le kantisme ou
la doctrine de Fichte ; c’est que le panthéisme de Hegel était davantage une
déformation des réalités mystiques ; qu’il était plus hindou, plus spirituel,
plus central aussi dans ses préoccupations. L’Allemagne du dix-neuvième siècle
est comparable à l’Inde : non seulement elle a eu la philosophie de Hegel, qui
pourrait être une corruption de la métaphysique d’Extrême-Orient ; mais elle a
donné naissance à ce morose Schopenhauer et c’est sur le sol allemand que se
développe philosophiquement la théorie de la pitié, si proche du bouddhisme, et
à laquelle ressortissent beaucoup d’oeuvres modernes plus ou moins faibles,
mais qu’ont illustrée héroïquement, dans leur marche vers Jésus-Christ, les
drames de Wagner et les romans de Dostoïevski.
Hello examine «
sommairement » la pensée de Hegel, dont la qualité principale est de mériter la
plus belle opposition qui soit : l’opposition du christianisme ; une opposition
qui n’a pas besoin d’arguments, une opposition qui consiste en une affirmation
pure et simple de ce qui est.
Le christianisme
s’affirmera lui-même en s’énonçant ; Hegel se réfutera, se niera lui-même en
s’exprimant, et peut-être ses disciples comprendront-ils la parole que je leur
adresse : cette vérité une, immense, synthétique, que leur maître a cherchée
sans la trouver, parce qu’il la cherchait hors du Verbe fait chair, le
christianisme l’offre au genre humain.
Quelle est donc la
réplique du christianisme ? Il introduit la lumière, la lumière qui, en même
temps, distingue et rassemble, faisant voir les liens des choses qu’elle
éclaire et sépare. Il intronise le Verbe, également Dieu et homme, et qui fixe
ainsi le jugement éternel commun aux cieux et à la terre. Il le dresse devant
chaque problème et immédiatement les éléments du problème, quel qu’il soit,
récupèrent leur place, – celle-ci dépendant de leur degré de participation, –
puisque c’est en lui qu’ils ont leur type et leur être. Le divin rejoint le
divin et l’humain rejoint l’humain, – la forme se rapportant à l’esprit, la
matière au néant ; – tout s’ordonne et se voit, à la clarté de l’Être. Les
ténèbres sont dissipées. Ce qui est, est ; ce qui n’est pas, n’est pas : « Est,
est ; non, non », suivant la formule de Jésus-Christ par laquelle le monde est
éternellement jugé.
La philosophie d’Hello,
philosophie d’obéissance et de certitude, est aussi simple que nous le
montrons. Ce dépouillement, ce dénuement, cette droiture contribuent à la
rendre efficace.
Schelling et Hegel ont eu
faim et soif de synthèse. Ils ont voulu se placer en face d’un être, le
regarder et dire : Omnia in ipso constant.
Mais ils l’ont dit de la création, et ils ont affirmé l’identité des contraires.
[...]
Il y a un Être in quo
omnia constant, c’est Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce à dire qu’en lui
se trouve l’identité des contraires, de l’être et du néant, de la vérité et de
l’erreur, du bien et du mal ?
Non pas !
Mais il est la Voie, la
Vérité, la Vie. Il est aussi la Résurrection. Le monde, créé par lui, a été
racheté par lui. Vainqueur de la négation, si réelle qu’elle soit, il ramène la
vie et la mort, l’erreur et la vérité, le bien et le mal, non pas à l’identité,
mais à cet ordre nouveau, à cet ordre immense qui, embrassant jusqu’au
désordre, le réduit par la justice ou la miséricorde à un ordre supérieur.
Ainsi toute chose apparaîtra quand apparaîtra Celui en qui tout a sa raison
d’être : Quam Christus apparuerit, vita vestra et vos apparebitis. Le bien et
le mal apparaîtront, profondément divers et diversement traités, mais
semblablement traités en ce sens que chacun obtiendra la place qui convient. Le
ciel et l’enfer apparaîtront, profondément différents en ce sens qu’ils
manifesteront Dieu diversement, profondément semblables en ce sens qu’ils
manifesteront le même Dieu.
L’erreur de l’Allemagne,
dit-il ensuite, c’est aussi de chercher dans la création cette harmonie qui ne
lui est pas propre, mais qui repose, au-dessus d’elle, dans l’infini.
L’Allemagne voudrait mêler Dieu à la création, sous prétexte que la création
n’existe pas indépendante de Dieu. Mais sa folie est de confondre le mouvement
de l’Esprit sur les eaux, le sillage de l’Être sur le néant primitif, avec
l’action de Dieu en Lui-même et antérieur à tout nombre, à toute création.
L’univers, bien que son
type réside dans le Verbe, est une substance distincte de la substance divine.
Son archétype est en Dieu, mais l’univers créé n’est pas Dieu. Les créatures
visibles et les créatures invisibles ayant toutes leur archétype dans le même
Verbe, cette relation commune explique les relations mystérieuses qui unissent
les deux mondes. Les combinaisons inouïes de l’un et de l’autre, puis de l’un
avec l’autre, sont quelques évolutions de la Sagesse qui se complaît dans la
beauté de son oeuvre.
Ce que l’Allemagne ne
connaît pas, ce que Schelling, par exemple, connaît mal, c’est que « le péché
est l’infidélité de l’être créé vis-à-vis du type idéal de lui-même, que Dieu
contemple dans son Verbe ». L’ordre, ajoute Hello,
est dans nos mains : nous
le troublons quand nous voulons, et alors Dieu, qui nous respecte trop pour
assujettir nos volontés à l’ordre, mais qui se respecte trop pour assujettir
l’ordre à nos volontés, fait jaillir un ordre nouveau du désordre introduit par
nous.
Quel magnifique éclair
sur la liberté dont jouissent les enfants d’Adam ! Cette liberté de l’homme, «
un dans son essence » mais « sujet à se répandre facilement sur la matière, qui
est le multiple », et à se laisser dissoudre par elle, c’est le mouvement, aux
yeux d’Hello, que doit produire sa volonté pour lui permettre de « revenir à
l’unité d’où il est parti ».
La liberté est le passage
de l’unité spontanée à l’unité réfléchie.
Et, si la liberté est
cette action, quel sera son but ? Les Allemands, qui n’ont pu la situer, sont
incapables de la justifier. Le libre arbitre, en dehors des décisions
théologiques, a été à peu près nié par les philosophies humaines, qui, devant
son énigme, capitulent assez tristement. Or écoutons le langage d’Hello :
Notre liberté tient en
éveil l’activité divine. Aussitôt l’univers visible et l’univers invisible
deviennent féconds en combinaisons nouvelles d’où sort, avec un ordre nouveau,
la conciliation facile et merveilleuse de notre liberté et de la Volonté
divine.
Le plus souvent, les
questions qui ont l’air insolubles, – et c’est le même écrivain qui le remarque
dans un chapitre de l’Homme intitulé précisément le Sphinx, – les questions qui
sembleraient appeler une réponse désespérante, « sont des questions mal posées,
et les réponses désespérantes sont souvent aussi superficielles qu’elles
semblent profondes ».
À Hegel, identifiant
l’être et le non-être, le bien et le mal, Hello, catholique, répond :
L’harmonie n’est jamais
l’identité des deux termes, mais leur conciliation.
Comme on peut le mesurer,
Ernest Hello n’est pas, à proprement parler, un philosophe. Ou, du moins, sa
philosophie, en ne voulant point se spécialiser, s’écarte, par le fait même, de
ce que l’on a coutume de dénommer la philosophie. Il n’y a que les principes et
les synthèses qui l’intéressent ; l’appareil technique dans lequel la
philosophie se développe lui est assez fermé. Quand il juge Hegel ou Schelling,
et même Platon, il les apprécie en gros, sa foi ne condescendant pas à les
suivre dans le dédale de leurs concepts, dans le menu de leurs propositions.
Les philosophes ne le compteront jamais au nombre des leurs. On dit d’Hello
qu’il est un penseur, comme de Pascal ou de tel autre. Or, un penseur, c’est un
homme qui découvre plutôt qu’il n’analyse ; un homme qui touche à la
métaphysique et à la psychologie dans une même formule, à l’art et à la
science, et qui, par tempérament, ne peut se borner à rien. Le penseur est à
mi-chemin du philosophe et du poète. Sa loi habituelle est la liberté. Il
découvre, disons-nous. Mais il obéit, ce faisant, au conseil du plus
scrupuleux, du plus analytique, du plus exact des philosophes (et c’est pour
cette raison que je demande à la philosophie qu’elle lui accorde un crédit
spécial) : « Voulez-vous découvrir avec certitude la vérité ? Séparez avec soin
ce qu’il y a de premier et tenez-vous-en là ; c’est là, en effet, le dogme
paternel, qui ne vient assurément que du verbe de Dieu. » (ARISTOTE, Métaph.,
XI, ch. VIII.)
Hello s’en tenait,
effectivement, à ce qui est premier en tout. Dieu était sa seule passion, le
reste était pour lui accessoire ou négligeable, et ce qui s’éloignait par trop
du Principe lui devenait suspect. Ah ! il ne s’arrangeait pas du doute
méthodique de Descartes (8) et il ne comprenait pas très bien que l’on fût ou
demeurât dans l’erreur, lorsque la Lumière elle-même s’était présentée dans le
monde et qu’il n’y avait qu’à lever les yeux pour la contempler. Hello ne
daignait pas sortir de l’orbe de cette évidence. J’ajouterai qu’il examinait
tout à la faveur d’une telle sagesse et que la solidité de ses assertions
provenait uniquement de cette constante absorption que faisait amoureusement
son esprit de la splendeur incarnée de la Face.
Hello est un penseur qui
a la clef et c’est pourquoi il aime à définir. Si la définition est un genre
littéraire, c’est bien le sien, car il n’est pas d’auteurs qui définissent avec
plus d’abondance. Très souvent il procède par correctifs, il ramène à
l’équilibre, il restitue l’ordre éternel des valeurs. Il a des formules
simplistes, il en a d’inoubliables. Au vrai, il se répète et, bien des fois,
mot pour mot. Il est de ceux qui aiment à ressasser la vérité.
Pour lui, l’intelligence,
en raison de ce que nous avons dit, est contemplative. Elle dénombre, elle
pèse, elle mesure, mais surtout elle regarde. Elle sépare lentement, et avec un
rythme, la lumière des ténèbres, puis elle admire. Elle ne juge rien à froid.
Elle ne peut pas, elle ne veut pas se distraire de l’amour. L’intelligence,
comme Hello la prend, est foncière et sacrée. Elle ne descend jamais du trône
élevé où Dieu, dont elle hérite le sceptre, l’a placée royalement pour
distinguer l’esprit de toutes les apparences.
De nos jours on n’a pas
souvent l’occasion de voir comme chez ce penseur l’intelligence maintenir un
caractère à ce point conscient de son origine céleste. Non pas qu’elle soit
guindée, il n’y a pas plus intime qu’une définition, une équation d’Ernest
Hello. Mais l’intelligence est pour lui inséparable non seulement de la lumière
mais encore de la chaleur. Est-ce à dire qu’elle ait des racines dans le sentiment
? Ah ! certes, non, car Hello, feu d’amour, est tout l’opposé d’un sentimental.
Il est même rare de rencontrer des oeuvres aussi dépourvues de sentimentalité
que celles qu’il a écrites. Mais j’expliquerai son attitude : il place
l’intelligence assez haut pour que l’amour ne la contrarie pas. On se demande
même si, à ces hauteurs, l’intelligence ne pourrait pas être appelée une des
formes de l’amour, – l’amour de la vérité, par exemple. Voilà une « philosophie
» qui ne mentirait plus à son nom. Si elle entend analyser le réel, elle est
accompagnée immédiatement de ce support : le coeur, qui ne la dirige pas, mais
lui communique l’accent pour s’exprimer. L’intelligence, alors, est une fille
de Dieu qui a la vie. Ce n’est plus l’instrument de ratiocination isolé du
sujet qui l’emploie. C’est l’acte même de l’intellect épousant le réel et qui,
dans son ardeur à s’identifier à l’être, engendre la définition.
Mais Hello nous avertit
qu’il y a une intelligence dégradée, qui porte ce même nom d’intelligence et
qui n’est au plus qu’une habileté assez honteuse de l’esprit quand il court
légèrement sur les idées pour les frôler d’un attouchement impur. Cette
intelligence vicieuse est celle qui gagne les suffrages du monde. Elle est
l’ennemi de l’unité, de la profondeur et de la lumière, comme le libertinage le
serait de l’amour véritable. C’est elle qui a poussé des âmes trop sensibles à
se méfier de l’intelligence. Heureusement, l’intelligence est tout à fait
irresponsable des déjections auxquelles on a voulu que son nom restât mêlé.
Voltaire, dont le type
l’exaspère comme il exaspérait Joseph de Maistre, et qu’il poursuit avec une
furieuse insistance, Voltaire, à qui l’on attribue de la clarté, est, dit
Hello, « inintelligible pour l’intelligence... On le croit clair, parce qu’il
ne fait ni n’exige aucune réflexion (9). » Ce qui est vrai pour Voltaire est vrai
pour tous ces esprits adroits chez qui la bassesse de l’intelligence est
concurrente de la médiocrité du coeur.
C’est ici que nous
touchons à la profonde originalité de cet homme qui fut si extraordinairement
intelligent et si incapable de s’abaisser spirituellement jusqu’au niveau
commun. Lorsqu’il voulait descendre dans la rue, Ernest Hello tombait
facilement au-dessous de la platitude. Quelques-uns de ses Contes, dont Barbey
d’Aurevilly entreprit l’éloge partiel, sont à cet égard, en dépit de leurs
intentions prophétiques, extrêmement confondants. Il est aussi de cet auteur
des morceaux puérils, assez nombreux, que l’on jugerait lamentables si l’on ne
discernait la cause de ces chutes : dès qu’Hello veut déroger à l’unité où
s’embrassent étroitement son intelligence et sa foi, – sa foi qui est tout son
coeur, – dès qu’il descend dans le monde pour y prendre une place que naïvement
il se croyait réservée, le publiciste galvaude son génie, et l’aigle, pour
s’exprimer comme lui, devient dérisoire entre les barreaux de sa cage. C’est
Léon Bloy qui, à propos d’Ernest Hello, dont il fut l’ami, a parlé du «
grotesque transcendant de toute sa personne ».
Le coeur et
l’intelligence ne s’étreignent harmonieusement, en effet, que lorsqu’ils ont à
eux deux le paradis à dévorer. Mais le siècle brise leur union, le siècle veut
qu’ils s’étiolent dans les ténèbres l’un et l’autre, chacun étant comme isolé
de sa substance.
Pour Hello, la soudure
s’impose et c’est justement cela que nous appellerons : aimer Dieu de tout son
esprit. Il s’agit de faire tressaillir la mesure qui nous a été donnée, par
laquelle nous connaissons l’être et reconnaissons, dans toutes choses, les rapports
que l’unité vivante contracte avec elle-même. Si pour lui, comme pour
Pythagore, la mathématique doit se résoudre dans la pratique des proportions,
dans la musique notamment, combien plus évidente sera la nécessité pour la
connaissance de se résoudre en adoration.
Admirer, adorer, suivant
l’objet ; prier, supplier, quant au sujet, telle est la dignité de l’homme, sa
manière d’être, telle est sa forme accomplie, tel est son « style ».
Rien ne nous est demandé
qu’une réponse à la Parole qu’a entendue Moïse : « Ego sum qui sum. » Cette
réponse est notre comportement vis-à-vis du Nom sacro-saint et il n’est pas une
de nos facultés qui n’ait sa part à prendre dans le témoignage. Le Chemah
Israel convoque tout l’univers, le ciel et la terre, et, par conséquent,
l’homme entier. Est-ce donc toi, ô esprit, ô globe translucide qui avais été
fait incomparablement beau, dans l’intention de réfléchir pour les rendre à
Dieu, comme des pierres précieuses, les feux génériques des hauteurs, qui
viendrais à manquer ? Tu avais reçu le sommet du partage et tu es occupé à
mourir le long des haies que la négation a dressées dans tes jardins infinis.
Hello n’a pas supporté
cette situation. Il a revendiqué l’intégralité du royaume pour le Verbe
incarné. S’il n’est pas le seul philosophe qui ait réclamé dans les temps
modernes cette autorité oecuménique du Dieu vivant, il semble que cette pensée
ait pris avec lui un caractère plus solennel, plus décisif que chez les autres.
Et l’importance de son action, que l’on a mal évaluée, s’amplifiera d’autant
que le grain de sénevé qu’il a jeté en terre – cette graine si petite dont le
développement est, assurait-il, toute « la question » – produira des effets,
aura des conséquences incalculables. Cette doctrine d’Hello va se préciser, s’organiser,
se fortifier, parce qu’elle contient le secret de notre redressement
intellectuel.
II
RASSEMBLER
Ernest Hello a étendu le
problème religieux à l’organisation de l’univers. Cela suffisait pour qu’on
refoulât, sans les examiner davantage, ses très grandioses suggestions, car il
n’est rien qui fasse plus horreur que le règne du Christ aussi scandaleusement
généralisé. La place de Dieu est au temple. Elle n’est ni au laboratoire ni au
forum. Le Seigneur a droit au dimanche ; l’athéisme lui dispute bien ce dernier
droit, mais le bon chrétien a quelques velléités de le défendre encore,
mollement... Pourtant, chez soi, il tient que Dieu est le principe et la fin,
que nous lui devons la vie et que la désirable éternité sera, grâce au
Rédempteur, notre héritage. Ce qu’il lui refuse, c’est le temps, c’est la
matière, c’est la science. Il consent à donner le dimanche, en théorie, au
Seigneur, mais, avare, il gardera pour soi les autres jours de la semaine et
restera indépendant, sur toute la ligne, sauf au moment où le salut éternel, à
ses yeux, risquerait d’être mis en échec.
Pour Hello, pour les
hommes qui l’ont précédé ou qui l’ont suivi, et qui lui ressemblaient, pour des
catholiques de sa trempe et ambitieux comme lui, le christianisme est sans
proportions avec ce que les tièdes essaient d’en faire. Non pas que l’on
veuille ajouter aux vertus des fidèles ni prétendre, sur ce chapitre, à les
dépasser. Il ne s’agit point ici du perfectionnement moral de l’homme qui est
une fois pour toutes déterminé dans le Nouveau Testament. Il ne s’agit point de
rendre par la philosophie l’homme plus saint, car c’est la Grâce qui en est
chargée, et non pas la sagesse de Salomon. Ce qu’il faut, ce qu’est « aimer
Dieu de tout son esprit », c’est lui restituer l’empire de l’univers et
retrouver, par rapport à lui, le sens des choses qui est une adoration plus
sûre et plus directe que l’adoration même que les volontés conscientes lui
peuvent témoigner. C’est donc retrouver la sainteté catholique du Nom par
lequel les choses vivent et qui est un secret d’amour tout replié en elles.
Connaissance qui ne peut être efficace que si le coeur a répondu amen aux
injonctions intellectuelles ; connaissance qui n’est qu’un développement de la
foi, une charité de l’intelligence et dont Clément d’Alexandrie, au deuxième
siècle, assurait qu’elle est « cette lumière que produit dans l’âme
l’obéissance aux préceptes divins », – une admiration qui voit. Comme elle voit
ce qui est adorable et que, si elle ne voit cela au fond, elle ne voit rien,
cette admiration est pratiquement une adoration.
Que l’on observe bien
qu’une connaissance de ce genre ne saurait affaiblir les démarches de la
raison. Elle joint seulement à l’élément intellectuel un élément de qualité
indicible. Ce qu’on pourrait lui reprocher, c’est d’aller trop vite au but, une
impatience, – d’apporter un désir qui peut sembler impropre à la philosophie.
Mais elle répond que le but de la philosophie est de découvrir la pâture
vivante de l’homme. La connaissance dont nous parlons aime à transpercer ; elle
est rarement circonspecte et, abordant la périphérie, devine aisément, devine
irrésistiblement le centre. Mais elle ne s’oppose jamais aux vérités
rationnelles qui sont, d’ailleurs, la substance de sa joie. Partout où il y a
une vérité certaine, un saint Thomas et un saint Denys sont appelés à se
rencontrer. Et la preuve de cet accord n’est-il pas flagrant en ceci que
l’Aquinate a repris mot à mot, pour en couronner sa philosophie, les lumineuses
assertions du théologien mystique ? La perception de saint Denys était rapide
comme un grand vol. Mais celle de saint Thomas, qui avait le temps, s’ingéniait
à décomposer l’espace qu’elle franchissait. Néanmoins c’est finalement le même
espace que les deux perceptions ont parcouru.
Hello, qui vénérait saint
Denys plus que les autres docteurs, et qui reconnaissait dans son langage «
asiatique », dans sa méthode ascensionnelle, mieux qu’ailleurs peut-être,
l’empreinte de la leçon de saint Paul, – à laquelle il demeurait lui-même si
pieusement attaché, – Hello, enclin, je le répète, à une philosophie adorative,
ne songeait pas tant à ordonnancer en catégories, comme les thomistes – bien
qu’il eût, pour distinguer, un génie des plus vifs, – qu’à considérer dans
l’essence et à comparer. Comparer des valeurs, opposer des contraires, après
avoir dégagé de l’informe et du chaos ces valeurs, de la convention et du monde
ces contraires, telle était sa joie critique. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu,
c’est-à-dire tout, sauf le mal et le mensonge avec leurs emblèmes, voilà quelle
était l’oeuvre d’Hello. C’était une résurrection, une transfiguration de la
critique. Il conviait les morceaux du tout à regagner leur place dans
l’infaillible catholicité.
Mais son appel n’était
pas sans émotion, car il savait qu’il le proférait sur des ruines et sentait
que l’heure était déjà tardive : « Restez avec nous, car voici le soir... »
C’est pourquoi sa Philosophie eut un mot si tragique et que n’ont pas trouvé
les poésies : « Unité ! cri de la terre ! Unité ! cri du ciel ! cri de la
victime déchirée qui redemande ses membres (10) ! »
Comme Jésus, dans
l’Évangile, quand il confirme la loi de Moïse ayant trait au mariage, la
rendant plus sacrée encore s’il se peut, rappelle que les époux ne seront
désormais qu’une seule chair et fait défense à l’homme de séparer ce que Dieu a
uni, ainsi la doctrine d’Hello veut que les choses de la terre et celles du
ciel soient jointes, par les Mystères de l’Incarnation et de la Rédemption,
d’une manière indissoluble. Ce que ce penseur fidèle ne tolère pas, c’est que
Jésus-Christ puisse être exclu d’aucun trône et qu’il puisse y avoir, dans la
nature, une réalité quelconque ne correspondant pas à sa gloire.
Hello ne cesse point de
reprendre la phrase de l’Épître aux Colossiens : « Omnia in ipso constant. »
Elle est le centre de sa pensée. Lui-même, disciple exact de saint Paul, ne
voit pour la créature qu’une maison à habiter le Corps mystique du Christ
Jésus. Il ne voit qu’un seul ordre à établir : celui qui est organique avec le
Corps mystique du Christ Jésus. Il ne voit qu’un lieu de rassemblement autour
de l’Unité : l’Église.
Hors de l’Église, hors du
Corps du Christ, il n’y a que le monde, cet « ornement » vain.
Quand il pense à l’unité,
c’est là qu’Hello admire le plus, qu’il est saisi d’un tremblement
incomparable. Se souvient-on, dans l’Homme, de ce chapitre sur le rire et les
larmes, – le rire et les larmes qui ont ceci de commun, dit l’auteur, qu’ils
touchent à la relation ? « Il me semble que le rire serait la parole de la
Relation brisée, et que les larmes seraient la parole de la Relation sentie. »
Hello a beaucoup écrit sur les larmes. Quand « la Relation se fait sentir », le
rire s’arrête, qui « était produit par la superficie des choses ». Les larmes
le sont, elles, « par leurs profondeurs ». Les larmes, celui qui a pu rire
d’abord les rencontre ensuite « dans ces profondeurs ignorées » où « se meuvent
les relations qu’il a eues, qu’il a et qu’il aura avec l’universalité des
choses ». Le souvenir, ajoute Hello, « est un endroit plein de larmes, parce
que le souvenir est plein de relations ». C’est pourquoi « le Présent est
quelquefois l’endroit du rire » : il cache les relations. Mais le Passé, lui,
les divulgue.
Le Passé dégage les
événements de l’accident qui les isolait, et les montre ensemble dans la
relation qui les unit. Le Passé montre les liens qui unissent les choses entre
elles. Le Présent cachait cette petite tresse imperceptible ; le souvenir la
découvre et les larmes, sortant de la retraite mystérieuse où elles dorment en
attendant qu’on les appelle, viennent voir le jour en disant : Nous voici.
Elles disent : Nous
voici, quand l’homme se souvient ; car le souvenir appelle la Relation ; elles
disent : Nous voici, quand l’homme se plonge dans l’amertume des eaux profondes,
car il y trouve la masse confuse des objets qu’il a autrefois connus ; elles
disent : Nous voici, quand l’homme est visité par la Joie, la Joie sublime et
torrentielle qui éclaire comme la foudre l’obscurité profonde des nuits,
montrant à la lueur du même éclair la face de la terre, la face de la mer et la
face des cieux ; elles disent Nous Voici, quand l’homme admire ; car
l’Admiration est une explosion de l’Unité qui interdit l’isolement à tout ce
qu’elle rencontre sur sa route. L’Admiration embrasse ce qu’elle voit et montre
aux créatures surprises le lieu où elles sont ensemble, le lieu où elles sont à
genoux.
Les larmes de
l’Admiration, ne serait-ce pas la matière de l’oeuvre d’Ernest Hello ?
Les larmes le
rapprochaient de l’Unité et il n’avait pas d’autre désir que d’atteindre, avec
le plein de son âme et le torrent de son esprit, l’Unité qui impose à toutes
les créatures un agenouillement identique et singulier. Les larmes lui étaient
nécessaires pour ce but, car il ne voulait pas aborder la Vérité sans un voile
de déférence comme les pleurs. Il ne voulait pas d’une expérience qui fût
exempte d’admiration.
C’est pourquoi Hello a un
ton unique. Son style est le reflet d’une âme qui aurait mis le feu à ses
vêtements, en passant dans les environs du Buisson ardent, sur le mont Horeb.
Il a toujours l’air de vous annoncer qu’il a entendu le « sifflement des
ténèbres ». Et c’est vrai. Car il a narré l’aventure, un jour qu’il écrivit,
dans Paroles de Dieu, cette méditation si belle sur le texte saint : Moïse
conduisait son troupeau aux intérieurs du désert et arriva à la montagne de
Dieu, Horeb.
L’âme conduit son
troupeau dans le désert quand, prenant avec elle tous les animaux qu’elle
garde, – et plus elle est élevée, plus les animaux sont spirituels, – elle s’en
va loin des hommes.
...L’âme va non seulement
au Désert, mais à l’intérieur du Désert. Le Désert a ses degrés qui sont ses
profondeurs. Le Désert, par son extérieur, touche aux pays habités par les
hommes. Il a encore là avec eux des relations ; mais, quand l’âme quitte les
abords des lieux habités, elle va dans les profondeurs du Désert et le Désert
est très profond.
Mais Moïse ne va pas
seulement à l’intérieur du Désert, il va aux intérieurs, aux lieux intérieurs :
interiora, le pluriel, et, de plus, le pluriel neutre.
Les lieux où il va sont
profonds : l’âme creuse ; elle ne se contente pas de regarder l’intérieur du
Désert, elle l’explore. Dans l’intérieur, elle découvre des intérieurs : les
abîmes s’ouvrent sous les abîmes. On dirait des effondrements. Le Désert
s’ouvre plus vaste qu’elle ne le savait, plus profond, plus caché, plus
lointain. Des perspectives non soupçonnées se découvrent au fond de lui ; et,
derrière ces perspectives, voici d’autres perspectives. Le Désert se multiplie
par lui-même ; ce qui était son extérieur n’est plus que son enveloppe. Vous
vous êtes cru arrivé au coeur, vous ne faisiez que toucher la peau. Quand vous
arriverez au coeur, le frisson vous prendra, et quand vous croirez avoir
exploré le coeur, le coeur s’effondrera, et le coeur du coeur apparaîtra.
Vous vous êtes cru encore
une fois au terme du voyage, vous n’étiez pas encore parti. Et plus vous vous
abîmerez dans le coeur de l’abîme, plus vous vous apercevrez que vous êtes
encore à la surface.
Tout à l’heure vous avez
pris l’extérieur pour l’intérieur ; maintenant vous prenez l’intérieur pour
l’extérieur ; mais cette seconde illusion n’en est pas une. C’est le
commencement de la lumière. Plus vous collerez votre oreille sur le coeur du
Désert, plus vous le sentirez palpiter loin de vous. Plus vous le serrerez,
plus il vous échappera, et la rapidité de sa fuite n’aura pour mesure que la
violence de votre attrait.
Celui qu’il s’agit de
trouver est immense ; il faut être délivré de tout pour faire vers lui les
premiers pas, et son approche est indiquée par l’horreur des ténèbres qu’il a
prises pour retraite. Entendez-vous siffler les ténèbres comme le vent dans la
tempête ?
Pas encore. – Allez plus
loin, plus loin. – Je suis plus loin, plus loin et je n’entends pas encore le
sifflement des ténèbres. – Allez plus loin, plus loin et ne regardez pas en
arrière : derrière vous brûle Sodome. Souvenez-vous de la femme de Loth. – Je
ne me retourne pas et cependant je n’entends pas le sifflement des ténèbres. –
Oubliez la fumée qui sortait, vers le soir, de la demeure où vous avez dormi
enfant.
J’ai oublié la fumée qui
sortait, vers le soir, de la demeure où j’ai dormi enfant.
Oubliez l’Égypte et même
la fille de Pharaon.
J’ai oublié l’Égypte et
la fille de Pharaon.
Oubliez le Nil et les
rivages et les roseaux et les couchers du soleil.
Que faut-il donc oublier
?
Il faut oublier le nom de
ceux que vous avez servis dans la terre de l’Erreur, car la Vérité est jalouse.
J’ai oublié le nom de
ceux que j’ai servis dans la terre de l’Erreur et la jalousie de la Vérité n’a
pas encore dit à mon oreille insensible : Ephpheta, ouvre-toi.
Alors je ne sais plus ce
qu’il faut faire.
Va devant toi, sans rien
comprendre. Oublie mes paroles dès que tu les auras entendues, et va devant
toi, au hasard, sans boussole. Si tu vois une marque faite sur le sable, prends
la fuite et dis au sable du Désert : Je te veux intact ; dis-moi où nul pied ne
t’a touché. Regarde le sable tout seul ; que le sable soit ton Océan. Ne
demande pas à l’horizon quelle est, au juste, la ligne qui sépare le sable du
ciel : laisse le sable jaune et le ciel bleu s’arranger ensemble comme ils
l’entendent. Ne t’inquiète de rien, ne cherche plus, marche ; si tu entends
craquer le sable, et rugir les lions, ne te détourne pas : marche. Si les
grands oiseaux du Désert fendent de leur vol silencieux le ciel énorme, ne les
regarde pas, marche. Si leur ombre noire tache le sable jaune, ne t’arrête pas
pour la regarder, marche. Laisse l’ombre et laisse le ciel : oublie le noir,
oublie le bleu. Ne regarde que le sable jaune, enfonce-toi dans son coeur.
Je me suis enfoncé dans
son coeur, et cependant je n’entends pas le sifflement des ténèbres.
Oublie maintenant la
couleur du sable.
J’ai oublié la couleur du
sable.
Maintenant, écoute le
silence.
J’écoute le silence, le
silence fils du Désert.
Je lui dis : Qui es-tu ?
Il répond dans son langage :
Je suis le Verbe du
Désert.
Maintenant enfonce-toi
dans le silence des silences, comme tu t’es enfoncé dans le Désert des déserts.
Plonge le glaive sacré
dans la poitrine du silence. Ouvre-lui le coeur et, au fond du coeur, cherche
le coeur du coeur.
Plonge dans l’Océan du
silence jusqu’à ce que tu sois arrêté par le fond de l’abîme, par la Pierre qui
supporte l’Océan, la Pierre que nul n’a vue, éternellement garantie par la
profondeur contre l’attentat des regards, et, quand tu auras heurté la pierre,
colle ton oreille contre celle que rien n’a jamais touchée.
Tire ta chaussure, car la
terre, sur laquelle tu marches, est sacrée.
La chaussure isole l’homme de la terre. Elle leur dissimule leur parenté. Celui qui va pieds nus se sent frère de l’humus d’où Adam est sorti.
[...]
Voici Dieu, que dit son
Nom : Je suis Celui qui suis.
Il est évident que
l’homme qui avait connu ces sensations spirituelles n’était pas un écrivain
ordinaire ; il lui restait, dans le coeur et l’âme, quoi qu’il fît, une marque
de ces passages de la splendeur incommunicable. Celle-ci l’empêchait de jouer
le littérateur, d’être habile et de rattraper, comme les gens du métier, dans
le mouvement d’une pensée bien continue, des phrases sans relief mais sans
défaillance. Hello, homme de lettres, se souciait peu des répétitions et des
lacunes. Il se vantait d’ignorer l’art des transitions et affirmait que les
Orientaux, qui ont donné les Prophètes, eussent rougi de nos artifices
d’écrivains. Pour lui, le ton, qui indique si l’on vient de Dieu ou si l’on
vient des livres, semblait former toute l’enveloppe du style.
Si je m’attarde à ces
détails extérieurs, c’est qu’ils sont en rapport étroit avec la nature même de
la pensée. L’unité, ainsi que la veut Hello, n’est jamais une unité
d’apparence. De même qu’il avait en exécration les recettes littéraires, les
conventions classiques telles que la règle d’unité de temps et de lieu, parce
qu’il détestait la fantaisie et que la convention n’a jamais été, dit-il, que «
la fantaisie de plusieurs », – ce qui est une définition extrêmement juste, –
il haïssait, au nom de l’Unité invisible, toute espèce d’ordre artificiel.
À son gré, l’unité qui
régissait tout n’était autre que l’unité religieuse. Les unités supplémentaires
lui paraissaient risibles. L’unité confortable du monde, le lieu commun social,
la médiocrité à la place de l’équilibre, l’autel de l’homme sous tous ses
aspects n’ont jamais été qu’une tentative impudente de nivellement.
La médiocrité est la
passion du niveau. Elle promène le même couteau sur toutes les têtes, à la même
hauteur. Et, si une tête s’élève, cette tête-là est coupée. Il n’y a qu’une loi
dans le code de la médiocrité ; mais cette loi-là n’admet pas d’exception.
C’est la défense de grandir (11).
Quand l’homme veut
substituer son unité à l’unité divine, s’il ne commet pas délibérément un crime
de lèse-majesté, il s’isole orgueilleusement, du moins, sur son néant et
empêche la vie de pénétrer. Aux yeux d’Hello, l’erreur est laide et morte. Si
nous la jugeons belle, c’est que le sentiment de Dieu vivant s’est à tel point
atrophié en nous qu’un cadavre est à présent susceptible de nous délecter.
Hello aime à suivre les
ravages d’une substitution, fût-elle peu sensible. À l’unité correspond
l’équilibre. Mais, comme Dieu, le monde veut avoir son équilibre, sans quoi
tout s’écroulerait : alors il le fabrique. Voici deux équilibres que distingue
Hello : « l’équilibre de la paix, c’est-à-dire l’harmonie ; l’équilibre de la
guerre, c’est-à-dire la symétrie. »
La symétrie, qui est une
conception militaire et un ordre matériel, est bien ce que le monde substitue à
l’harmonie, qui est une perfection mystérieuse. Hello aurait pu pousser plus
loin sa pensée et dire : l’harmonie est à travers le nombre la parole de
l’unité, elle donne en quelque sorte une sensation d’unité. La symétrie est, au
contraire, fondée sur une dualité. Son objet n’est pas l’unité, puisqu’elle
s’arrange à reproduire méthodiquement, pour le corroborer, un argument
insuffisant, une demi-vérité. La symétrie n’est pas une plénitude et, à cause
de cela, elle est emprisonnée dans sa loi, elle n’est pas libre. L’harmonie est
un épanouissement dans la liberté comme ce qui est vivant (12).
Les artistes n’ignorent
pas que l’harmonie n’est le résultat d’aucune règle fixée, mais l’intelligence
spontanée de toutes les parties dissemblables conduites à l’obéissance.
L’Église est éminemment harmonique et elle porte les signes de cette qualité
jusque dans ses moindres gestes. Elle sait conduire les hommes vers une même
direction sans leur imposer aucune aliénation du caractère, aucun modelage sur
autrui. Elle a le secret de la liberté et ses actes, même inflexibles, voyez
quelle souplesse la Vérité qui lui est inhérente leur donne. La marche compacte
d’un régiment ne lui conviendra jamais. Elle n’a point à déclarer la guerre aux
hommes, elle n’a aucun besoin de symétrie.
« Ô vérité douce et
inflexible ! » disait Hello, comme il s’adressait à l’Église. C’est que la
Vérité, que représente l’Église, est de Dieu et, par conséquent, ne connaît pas
la dureté. La dureté vient des hommes.
L’opération humaine a
pour caractère la densité : même favorable, elle fait sentir en nous et sur
nous la pesante main de la nature qui nous travaille, toujours plus ou moins
grossièrement, et qui déplaît en nous à la sublimité de l’Esprit. L’opération
absolument divine se fait sentir, je crois, par l’absence totale de dureté (13).
C’est que l’Unité est si
vaste qu’elle ne peut blesser personne. Il n’y a que la matière qui blesse, il
n’y a que les hommes matériels dont le langage ou l’attitude soient offensants.
Il n’y a que le « néant compliqué » (le mot est d’Hello) qui fasse souffrir.
Mais Dieu tout pur ne saurait nous heurter.
Ainsi les amis de Job
sont de mauvais consolateurs, parce que leurs discours, pour aussi
irréprochables qu’ils soient, ne contiennent pas l’éclair de l’Unité. Ce qu’ils
apportent à Job, ne seraient-ce pas des conseils symétriques ?
Ils disent tant de choses
vraisemblables, rigoureuses, concordantes et graves, qu’il n’y a rien à leur
répondre. Rien ! Excepté un mot peut-être :
– J’avais faim et vous ne
m’avez pas donné à manger, j’avais soif et vous ne m’avez pas donné à boire (14).
Il faut chercher dans ce
mystère de l’unité, dans ce mystère du sublime, de l’harmonie inexplicable, qui
dépasse le raisonnement symétrique, dans ce mystère où l’intelligence et la vie
sont embrassées, les causes qui font ici-bas la bonté préférable à tout. Les
platoniciens mettaient le bon avant le vrai, sans le lui opposer certes, mais
comme si le bon, le bien, eût dû engendrer l’être lui-même. Et Hello :
Le sublime est par son
essence étranger au raisonnement. Il n’est pas de son ressort et ne tombe pas
sous ses coups. L’acte qui se raisonne n’est pas sublime et l’acte sublime
n’est pas raisonné. Il doit s’appeler l’acte raisonnable dans une langue
supérieure mais, dans la langue de ce pays-ci, il n’est pas raisonné. Il
s’adresse à la majesté. Le sublime est ce qui flatte la gloire.
Si le sublime est un
étranger pour le raisonnement, il n’en est pas un pour la bonté.
La vie est un mystère.
L’homme, quand il croit avoir affaire à l’homme, ne sait pas au juste à qui il
a affaire. Quand il s’agit de dégager l’immense inconnue, le raisonnement est
celui qui trompe. Celle qui ne trompe pas, c’est la bonté. La bonté est la
pierre de Jacob sur laquelle l’homme dira au jour du réveil : Ce lieu est saint
et je ne le savais pas.
La bonté est vis-à-vis du
mystère ce que l’aiguille aimantée est vis-à-vis du pôle. Elle ne sait pas,
elle fait comme si elle savait. Son instinct qui émane de l’immense se tourne
vers lui et y ramène.
L’immense se moque du
raisonnement. Il lui brise entre les mains son petit compas. Il ne se moque
jamais de la bonté. La bonté l’entend, même quand elle ne le comprend pas.
Entre la bonté et l’immense
il y a un traité secret (15).
Dans les questions
brûlantes, dans la question d’Orient, notamment, qui a tant tracassé Ernest
Hello, pour ce que son amour de l’Unité souffrait de voir la partie la plus
sacrée du globe exclue de la communion des fidèles, et, même, tout un côté de
la chrétienté orthodoxe séparé de Rome, c’est une étrange douceur et non des
actes humains qu’il conseillait.
L’Occident a des
ressources, des expédients, de l’habileté, de l’entregent, du savoir-faire.
Aussi, il dissimule ses chutes, et s’agite avec assez d’habileté pour se
persuader qu’il travaille. Il remue au fond de son trou, pendant que l’Orient
dort au fond de son abîme. Les rêves de l’Occident endormi sont des intrigues
de salon. L’Orient endormi prononce dans ses songes le nom de Bouddha (16).
Si l’Orient n’est pas
fait pour se battre, c’est qu’il « représente essentiellement la Paix ». Si
toute l’histoire le montre « impuissant pour détruire », c’est que l’Orient ne
peut qu’édifier. Mais l’Occident guerrier, qui dort peu, et qui s’agite et
travaille, a tort de se vanter de la force de son bras et de s’enivrer de son
mouvement. Il faut, pour réveiller l’Orient, « une voix plus douce et plus
haute. Il faut la foudre, la brise et l’aurore ».
En d’autres termes, il
faut être divin pour persuader l’Orient. Les croisades, comme les concevait ce
« croisé » intellectuel,– on sait qu’Hello fonda un journal, le Croisé, et que
le premier abonné de ce journal fut un certain M. Jean-Baptiste Vianney, curé
d’Ars, – ne pouvaient se prêcher qu’au nom de la très sainte Unité qui est en
Trois Personnes, et à condition de ne comporter pour armes que des bannières de
lumière.
Concernant les mesures à
prendre en face de l’Orient, Hello ne les désigne que vaguement, c’est vrai. Il
croit que « la question qui unit et divise les Orientaux et les Occidentaux est
bien supérieure à une question politique. Elle est du nombre de celles que la
Providence s’est réservées. Elle a les caractères d’un secret (17) »...
Mais il constate que les
grandes figures historiques, les figures providentielles, ont instinctivement
tourné les yeux vers l’Orient. L’Orient a fasciné Constantin, saint Louis,
Napoléon.
Dans les moments les plus
vulgaires de l’histoire humaine, l’Orient et l’Occident semblent s’oublier.
Dans les moments les plus
solennels de l’histoire humaine, l’Orient et l’Occident se regardent.
Dans les moments les plus
décisifs, l’Orient et l’Occident se touchent.
Ils se frappent ou
s’embrassent (18).
Hello revint maintes fois
sur ce thème et il ne modifia jamais son point de vue. Dans l’Homme (19), en
quelques lignes il a résumé sa pensée profonde :
L’Orient déchu a oublié
la puissance de l’homme ; de là, la fatalité, qui oublie l’acte humain.
L’Occident déchu a oublié
la puissance de Dieu et l’impuissance de l’homme isolé ; de là, l’orgueil et
l’inquiétude, qui oublient l’acte divin.
Ces deux vices
établissent l’indifférence, qui est la négation pratique.
La vérité produit
l’humilité, qui s’oppose au vice occidental, à l’orgueil inquiet ; et
l’activité, qui s’oppose au vice oriental, à la paresse fataliste.
La vérité produit à la fois
le travail, qui est la vertu propre de l’Occident, et le repos, qui est la
vertu propre de l’Orient.
Se tournant avec Rome
vers Celle qui est le havre de Grâce et que l’Église a dénommée, dans sa
liturgie, la Porte orientale, Ernest Hello tout à coup s’exclame :
Sainte Marie, mère de
Dieu, priez pour les deux hémisphères !
Dans ses méditations sur
l’Écriture, il a relevé cette parole de la Genèse : « Que Dieu dilate Japhet,
qu’il habite sous les tabernacles de Sem, et que Chanaan soit son esclave. » Il
a compris que c’était « la question d’Orient dénouée », selon l’ordre du
Très-Haut, – que l’Europe dilatée allait prendre possession des tabernacles de
l’Asie, et que l’Afrique serait à leur service.
Japhet, chez lui,
travaille et ne se repose pas. Il ne peut se reposer que sous les tabernacles
de Sem. L’Orient et l’Occident séparés languissent tous deux : l’Orient dans
l’oisiveté, l’Occident dans le labeur. Il faut que l’Orient entre dans son
action pour que l’Occident entre dans son repos. Le sabbat de l’Orient sera de
participer aux activités, aux mouvements, aux productions occidentales. Le
sabbat de l’Occident sera de participer au repos de l’Orient, sur le théâtre
même où le repos est né. L’Occident et l’Orient ont besoin de sortir
d’eux-mêmes. Leur repos sera de se transporter l’un dans l’autre.
... L’esclave travaille
et déteste ; le serviteur travaille et aime. L’esclave Cham aimera Japhet et
Sem, pour lesquels il travaillera parce qu’il le voudra. Il détestait Japhet
sans repos et Sem sans action. Il aimera Japhet reposé et Sem actif, il passera
de la haine de l’esclave à la liberté du serviteur (20).
Ne serait-il pas
admirable, ce nouveau commerce entre les parties du monde, que le Seigneur a
lui-même annoncé et que nous relate, à la fin du dix-neuvième siècle, un
penseur mû par la crainte de Dieu et le zèle inextinguible de sa maison ?
Toutefois il ne s’en tient pas là, Hello a vite fait de s’élever plus haut que
Sem, Japhet et Chanaan, les trois sources ethniques engendrées de Noé et qui,
pour aussi universelles qu’elles soient, ne lui paraissent encore que des
figures. Si de Cham il ne dit plus rien, Japhet représente à ses yeux la terre
et Sem le ciel. « Il est temps », s’écrie Hello, « que la terre, fatiguée de
son exil, se repose sous les tabernacles du ciel. » Toute sa vie, il aspira
ardemment à la fin, parce que, pour lui, la fin, c’était la gloire. « Le ciel
», gémit-il, « ne s’inclinera-t-il pas et n’entrouvrira-t-il pas ses tentes
pour bénir la pauvre terre ? »
On voit qu’Ernest Hello
attendait la précipitation de Japhet dans les bras de Sem, hospitalier, comme
un immense signe de délivrance. Alors Sem, sortant de ses tentes, aurait
commencé à s’ébranler vers la Croix, qui a été plantée aux portes de l’Asie.
Car Jésus, Orient même, –
o Oriens ! – a regardé l’Occident en mourant. Et l’Occident s’est emparé de la
Croix. D’où, pour Hello, la civilisation et la science, dont l’Europe est
dépositaire. Mais il viendra un jour où « l’Orient arborera la Croix à son tour
». Cependant, avant cette heure, Hello prévoit « l’âge de l’intuition », et nul
doute qu’il n’ait rêvé que sa pensée pût inaugurer cet heureux âge. Mais il
n’en souffle mot. « Enfin », déclare-t-il, « l’Orient et l’Occident seront
réunis dans la vallée de Josaphat, et la Croix apparaîtra triomphante, ouvrant
le règne éternel de Dieu (21). »
Hello a souvent et
splendidement salué la Croix. Il l’a fait avec son coeur, son âme et son
esprit. J’ajouterai, au demeurant, qu’il l’a considérée avec une rare
perspicacité. Les mystiques ont vu surtout dans la Croix l’instrument de
supplice où s’écartelait leur amour, et ils l’ont épousée avec l’âme et le
sang. D’aucuns y ont distingué peut-être le geste de la gloire humiliée de
Dieu. Mais ce qu’Hello nous a transmis de la Croix, du signe de la Croix, c’est
une espèce de science. Pour lui, la Croix joue le même rôle dans l’espace que,
dans le processus de la création, le Verbe par qui tout a été fait et en qui
tout se tient ensemble. De même que subsiste dans le Verbe divin l’exemplaire
de tous les êtres, de même dans la Croix il y a celui de toutes les
manifestations proportionnelles. Entre le Verbe et la Croix, qui est destinée à
le recevoir, il y a toute chair. Hello n’a pas écrit littéralement cela, mais
je suppose bien qu’il l’eût consigné. Entendons-le plutôt :
Un jour, par ordre du
proconsul romain, un arbre fut abattu dans une forêt. C’était un sycomore. Les
ouvriers galiléens reçurent l’ordre de le tailler. Ils ne le taillèrent pas
sans peine. Il leur fallait réaliser le plan géométrique aperçu par Dieu dans
le Verbe, qui allait être cloué sur ce morceau de bois. Sur ce bois, en effet,
fut cloué le Verbe fait chair. Le corps fut dressé verticalement : ligne de vie
; les bras furent étendus horizontalement : ligne de mort. Ainsi se résuma le sacrifice
qui contient la vie et la mort réconciliées.
Toutes choses
s’embrassèrent dans un baiser immense. Car le bois du sycomore fut croisé. Ses
lignes, parallèles tant que l’arbre avait vécu, tant que les racines avaient
été en terre, se coupèrent à angles droits, à angles égaux. L’arbre prit la
forme d’une croix et fut transporté sur la montagne.
La vie et la mort se
traversèrent, et, se coupant à angles droits, chantèrent une musique infinie,
qui entraîna dans le même accord l’essence éternelle et les choses créées,
Dieu, l’homme et la nature. Dieu le Père, revenu de sa fuite infinie, ne se
repentant plus d’avoir fait l’homme, atteignit et embrassa la création sur cet
épouvantable sommet. Il trouva encore une fois son oeuvre bonne (22).
Il ne suffisait donc pas
de comprendre, pour Hello, que « la Croix greffe un Dieu sur un homme », ce qui
est déjà une vérité bien remarquable, mais il fallait opposer à ce dédain
intellectuel que trop d’exégètes chrétiens témoignent pour le signe catholique,
le signe universel de la Rédemption, une manière de théorie resplendissante et
prophétique où la Croix fût mise en valeur. La théorie d’Hello ne lui est pas
personnelle, elle est publiée en toutes lettres par la création entière, à qui
la mort de Jésus et la forme de cette mort ont rendu tout son sens. Pour le
clairvoyant, l’univers, bien qu’il n’ait pas été changé, n’a-t-il pas recouvré
une certaine vie, comme une vie spirituelle, par la mort en Croix du Fils de
l’homme ? On objectera que les païens n’étaient pas sans avoir conscience d’une
vie à peu près équivalente que pouvait comporter la nature et que c’est même
là, semble-t-il, l’origine de leurs dieux. Mais Hello reprenait à son compte la
phrase de Joseph de Maistre : « Quelle vérité ne se trouve pas dans le paganisme
? » Ce qu’il aurait pu répondre, c’est que les mythes païens n’ont été qu’une
broderie plus ou moins grossière autour de ce point où se sont toujours
rencontrés la raison naturelle et le vestige de la Révélation primitive : à
savoir qu’il est nécessaire, pour la libération de la vie terrestre, que le
Fils de Dieu s’incarne un jour dans le temps et l’espace.
La constatation navrante
qui s’impose est que les chrétiens modernes sont en général moins sensibles à
la présence de la Déité sous le voile de l’univers que beaucoup d’idolâtres. Un
homme qui surprend un reflet de quelque rayon de la gloire divine dans les
choses est appelé un « mystique » et on lui fait grief de ne pas être, comme
tout le monde, fermé à la pénétration de l’intelligible qui sourd de la nature
et monte vers l’entendement pour se faire reconnaître et acclamer dans son nom.
C’est ainsi que la Croix éblouit les yeux et n’est pas même vue.
La Croix est la forme de
l’homme : l’homme véritable, c’est l’homme qui prie ; or la prière étend les
bras de l’homme et fait d’elle-même le signe de la Croix !
Elevatio manuum mearum
sacrificium vespertinum.
L’élévation de mes mains
est mon sacrifice du soir (23).
Quand l’homme étend les
bras,
Dieu voit, en le
regardant, la créature telle qu’elle est, pleine de besoins et de désirs,
misérable et transportée, étalant sous les yeux de son Père son impuissance et
son ardeur. Dieu voit en elle la ressemblance de Celui qui est le Type, l’image
du Fils qui, parlant de la Croix, comme s’il eût parlé d’un trône, comme il eût
parlé d’un char de feu, voulait être exalté pour entraîner tout à lui ! Si
exaltatus fuero, omnia ad me traham (24).
Hello retrouvait dans la
synthèse cruciale, où la Rédemption est consommée, où la ligne de vie et la
ligne de mort se coupent exactement, la récupération du Principe. « Je suis
l’Alpha et l’Omega, le Principe et la Fin », dit Celui qui est en Croix. Il est
le Type de tout ce qui est, car en lui tout a son exemplaire et tout aura son
dénouement. La création en tant qu’être part de lui et revient à lui. Il est,
Verbe, au commencement, le plan de la volonté du Père où toutes les puissances
reposent ; il est, Christ, dans son Corps glorifié, le lieu où tous les actes
vivants aboutissent et se rassemblent.
Dans l’Athéisme au dix-neuvième
siècle, qui est le livre doctrinal par excellence d’Ernest Hello, on suit
aisément le développement de l’affirmation capitale qui constitue la base
héroïque de sa philosophie. Après avoir critiqué les erreurs de ses
adversaires, il les confond en leur découvrant de quoi ils meurent : la
privation de l’Incarnation ; puis, la Semence de Dieu ayant germé, il les fait
assister au spectacle de la Rédemption et plante la Croix au centre de
l’univers transfiguré.
Le christianisme est
l’occupation de la chair par le Verbe. Or quel est l’objet de cette incarnation
?
C’est de mettre Dieu en rapport avec nous par toutes les parties de nous-mêmes, par toutes nos facultés, par tout ce qui nous fait hommes. Le Dieu fait chair entre dans l’homme par tous les pores.
[...]
Le Dieu un a fondé l’Église
une, universelle, immuable.
Toute parole qui a une
fois varié n’est pas la sienne, il n’y a qu’une parole qui n’ait jamais varié.
Consommer l’unité de tous et garder l’individualité de chacun, tel était le
problème. L’individu tire à lui, c’est la force centrifuge ; l’assemblée
universelle tire à elle, c’est la force centripète, bonne et utile à l’humanité
comme l’agrégation moléculaire à la matière inorganique.
...L’Église est le grand cadeau fait par Dieu aux hommes pour entretenir l’amitié entre le ciel et la terre.
[...]
L’ancien monde, ombre et
figure, avait pour but, sous le règne de la loi, de former le corps matériel du
Christ ; le nouveau monde, plein de vie, et de grâce, a pour fin dernière la
mission de former le corps idéal du Christ, qui attend de la liberté humaine
son achèvement et l’intégrité de ses membres.
Toutes les créatures
appartiennent à l’homme, tendent à l’homme, et l’homme tend à Dieu par
Jésus-Christ.
Ce dont il s’agit pour
les chrétiens, explique Hello, n’est rien de moins que « continuer l’oeuvre de
la Vierge Marie ». La chrétienté fait sans cesse le Corps de Jésus-Christ, si
ce n’est pas s’exprimer trop hardiment, dans la même mesure que les aliments
font la chair, par exemple, de celui qui les prend et se les assimile. On voit
que c’est le large commentaire de saint Paul et rien d’autre. Mais tout Hello
est un incendie blanc, allumé par saint Paul. Je veux bien qu’il se soit
rassasié des Écritures et des Pères, qu’il ait trouvé dans saint Thomas
l’essentiel de sa philosophie, qu’il ait demandé à Joseph de Maistre quelques
renseignements ; il n’empêche toutefois que c’est de saint Paul qu’il tient la
qualité architecturale de sa contemplation. Quand Hello parle de l’amour
universel, il a moins l’accent de saint Jean que de saint Paul. Le corps lui
est nécessaire ; le sentiment de la géométrie ne l’abandonne jamais ; pour
aussi haut qu’elle plonge dans la lumière, son affectivité fulgurante maintient
des bases spatiales, elle n’est pas sans indices intellectuels, elle ne rompt
pas avec tout dessin et, même si elle les brise ou les croise, elle ne perd pas
la notion des lignes. Chez Hello, je discerne une étrange habitude de la
matière. Et cela est d’autant plus frappant que cet homme est d’une pureté
exceptionnelle et caractérisé surtout par l’appétence des plus hautes formes.
Il ne distinguait pas, quant à lui, les incompatibilités qui nous embarrassent
et nous gênent. C’est précisément la pureté de sa flamme qui lui donnait cette
droiture, qui lui inspirait cette franchise dans la revendication de la terre.
Hello ne voyait pas d’autre manifestation du paganisme que l’idolâtrie bien
établie. Les chrétiens charnels redoutent la matière. Lui la désirait
candidement et la certitude que le corps ressusciterait un jour dans le
triomphe du Verbe était une de ses joies les moins déguisées.
Dans saint Paul ce n’est
pas un autre prodige que nous observons. Mais le monde attaqué avec lui,
affronté, battu par sa Vision soudaine, est renversé en arrière, comme Saul le
pharisien, désarçonné, fut jeté sur la route à bas de son cheval. Cet apôtre de
la résurrection, ce Juif entre les Romains, qui a saisi, sous le coup de soleil
de Damas, le principe de l’union du ciel et de la terre, cet aveugle du monde
extérieur qui a perçu spontanément le plan de l’édification vivante, qui a
touché, au centre de l’éblouissement, l’endroit et l’instant où la lettre et
l’esprit coïncident, est passé du symbole à la réalité du symbole, de la
matière de la loi au coeur de la charité, et sa hardiesse a dressé devant la
Face de Dieu la structure de l’Église corporelle.
Il est certain qu’Ernest
Hello ne se sentait à l’aise que dans l’étreinte de pareilles notions. La
philosophie elle-même, et le soin de préciser par le menu l’objet de la
connaissance, en faisant jouer le mécanisme cérébral avec beaucoup d’habileté,
n’étaient pas, je l’ai déjà dit, le fort de cet esprit. La scolastique l’avait
convaincu, parce qu’elle est la méthode qui laisse leur place à la sagesse et à
la foi, mais il se contentait d’en adopter les grands traits et sa joie était
de les voir correspondre admirablement à ses intuitions ou à ses prophéties,
selon le nom qu’on voudra bien leur attribuer. Mais, si je me suis permis de
rattacher l’expérience intellectuelle d’Ernest Hello au faisceau d’inspirations
divines – infaillibles celles-ci – qui constituent les épîtres pauliniennes,
c’est qu’il me semble opportun de classer un penseur catholique de cette
envergure dans un ordre qui ne soit pas mensonger, spécieux ou absurde. Hello,
il faut le déclarer tout net, est un penseur en marge de la tradition ; un
isolé, serais-je tenté d’écrire, s’il n’avait appartenu aussi étroitement à
l’Église. En un mot, ce fut un voyant, comme peuvent l’être les poètes, qui
voient la vie dans les idées. Un mystique, mais je ne l’affirmerais pas dans le
sens absolu où on l’entend d’un saint Jean de la Croix ou d’une sainte Thérèse,
acception qui canalise, pour la resserrer d’autant, la notion de mysticisme
dans les rapports intérieurs de l’âme et de Dieu, et ramène ainsi à l’état pur
ce mysticisme diffus que nous trouvons un peu partout répandu sur la
spéculation. Non point que je veuille insinuer qu’un Hello fût rebelle à
l’oraison, mais sa mysticité provenait de la disposition de son intelligence et
de son coeur : il était de ces mystiques doublés de spéculatifs, comme le sont
les sages hébreux, comme l’ont été quelques Pères grecs, et tant de premiers
chrétiens sans doute, des intelligences amoureuses de Dieu inaccessible en soi
et glorifié dans ses oeuvres, – des yeux qui percent, des narines qui devinent,
des oreilles qui entendent. C’est à la seule théologie de situer le rôle de ces
âmes-là et de vérifier leurs déclarations.
Le mysticisme d’Hello,
appliqué au monde, extérieur, tend à définir. C’est le principal de sa tâche.
Mais, parce qu’il est un mysticisme, il ne définit pas pour le plaisir de
définir. Il définit en vue de rassembler. Il a son objet, qui est très clair.
Cet objet consiste à rapporter chaque élément au Corps de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Au-dessus de toutes les questions, c’est l’unité organique qu’il
réclame, c’est le triomphe de l’Église une et sainte. Dans son émouvante
candeur, Hello imagine que toute la création peut faire un geste de soumission
qui instaurera le règne de Dieu sur la terre et que, si la science obéit, si
l’art s’agenouille, si la vie se rend, toutes les difficultés seront anéanties,
les chemins raboteux seront aplanis et les tortueux redressés. Il ne demandait,
lui, qu’à préparer les voies du Seigneur et il s’exténuait à crier dans son
désert. Et, si ce désert avait fleuri comme un lis, si la terre s’était
rassemblée autour du Christ à la lecture des ouvrages d’Ernest Hello, Ernest
Hello ne s’en fût pas outre mesure étonné. Car lui qui s’étonnait de n’importe
quoi, il n’y avait que le miracle et la splendeur et la gloire qui ne l’eussent
point étonné. Je répète qu’il ne s’accoutumait pas au péché de l’homme. C’est
pourquoi l’incident du Thabor lui fit écrire une phrase qui peint son esprit
tout entier :
Le Thabor, au lieu d’être
étonnant, est plutôt une trêve faite aux étonnements (25).
Quand la gloire se
montre, Hello l’étonné ne comprend plus qu’on s’étonne. Il est chez lui, il
repère ses positions. Mais le reste, la terre fermée, les corps opaques, le
multiple couvrant l’unité, l’absence de foi, le monde, voilà ce qu’il dénomme «
le prodige habituel », ce qui « arrête la gloire », l’énorme folie du péché, la
condamnation aux ténèbres, et le goût de l’erreur et de la laideur qui en
résulte.
Des esprits comme le sien
ne se retrouvent dans leur atmosphère qu’environnés des fils du plan divin qui
s’entrecroisent et s’ordonnent pour la gloire de la secrète Unité. Si cette
intelligence de la gloire leur échappe, les voilà tombés aussitôt dans l’abîme
de la désolation. C’était le cas d’Hello, et ses misères, le drame de son
existence provinrent de la difficulté perpétuelle où il était de concilier les
ineffaçables promesses de Dieu et les faits décourageants de l’histoire
humaine. Oh ! il ne se laissait pas abattre par les contradictions les plus
brutales qui pouvaient offenser son pied impatient de chrétien zélé. Il gardait
ses horribles détresses par devers soi et nous ne les avons connues que par la
lecture de ses cahiers intimes. Dans ses livres, lui qui était le moins armé
des hommes de génie (26), il résistait éperdument à l’évidence même, si l’évidence
ne renforçait pas la dignité de la religion. Il condamnait, abusant un peu
d’une foi merveilleuse, toutes les oeuvres, aussi remarquables fussent-elles
sous le rapport de l’art ou de la raison, qui ne répondaient pas aux dogmes ou
simplement qui les passaient sous silence. Il rejette les oeuvres de
Shakespeare, Goethe et même Beethoven, sous prétexte que ces auteurs ne sont
pas dans l’Église, et il les jauge avec des mesures qui sont en usage en
théologie, mais qui ne sont pas appropriées à l’art. Dans ces conditions, il
fait en un instant le vide autour de lui. À Goethe il opposera saint Denys, à
un romancier Nicolas de Cuse et à Shakespeare Ernest Hello en personne. Mais ce
formidable critique du général et de l’immense, qui excelle encore à définir le
petit en pensant à l’immense, est inapte à l’appréciation pondérée du
particulier. Sa soif de la gloire finale de Dieu dévore tout le chemin qui le
sépare de cette gloire. Hello n’est pas plus, au vrai, un critique casuiste
qu’il n’est un philosophe ratiocinant. Il est l’homme des bras étendus et des
angles droits. Il ne se plaît que dans la synthèse, il ne respire que dans un
très vaste symbolisme.
Quand il a,
effectivement, des horizons à découvrir, des éléments à faire se
contrebalancer, des oui et des non à distinguer, des blancs et des noirs à
tirer du gris, Hello est un artiste extraordinaire. Il ne faut pas lui en
demander davantage.
Ainsi il avait au plus
haut point le sens de la réversibilité sur la terre. Il prétendait fort
raisonnablement que toutes choses communiquent entre elles et, ce qui est plus
beau, qu’il n’est rien qui ne porte à l’infini un reflet singulier sur
l’ensemble des choses.
Tout ce qui est rayonne,
selon la capacité et la forme de l’Être. L’influence de tout sur tout ! Mystère
et vie ! Si le soleil agit sur l’oeil de la fourmi, l’oeil de la fourmi n’est
pas sans action sur le soleil. Il en a pour sa petite part déterminé la
forme (27).
Et combien plus grave
sera la même loi transposée dans l’ordre moral, si l’on songe que dans
l’intérieur de l’Église nous somme les membres d’un même Corps et les membres
les uns des autres.
Nul homme ne fait mal à
un autre homme sans se faire mal à lui-même. Si la solidarité nous disait
quelques-uns de ses secrets, nous tomberions la face contre terre. Nous nous
voyons quelquefois agir sur un homme. Mais nous agissons continuellement sur
tous les hommes sans y penser. Nous apercevons quelquefois une des conséquences
de nos actions. Mais cette conséquence, pour être la seule visible, est-elle la
seule réelle ? Pensons-nous à ce rayonnement universel de nous-même, de notre
âme, de notre corps, de notre action, de nos paroles ? L’univers est une
immense plaque photographique, et tout exerce sur tout un reflet mystérieux (28).
Cette dernière
observation, qui concerne la photographie et veut que la plaque sensible, s’imprégnant
de notre image dans les conditions requises, atteste que nous sommes présents,
en reflet, hors de nous, le frappait extrêmement. « Chacun de nous remplit
l’univers de son image, disait-il, et, si nous ne nous voyons pas partout,
c’est que la chimie ne s’est pas pourvue d’appareils photographiques : l’image
est toujours là, c’est la plaque seule qui manque. »
De ces considérations
physiques à l’exaltation de la charité, qui est la vie de la Grâce, il n’y a
que l’espace d’un battement de coeur. Les Pères et les Docteurs ont attribué à
la surabondance de l’amour, à la charité en un mot, la cause de la création. Et
Hello : « La création, dit-il, est une oeuvre de charité, une association dont
tous les membres se font réciproquement l’aumône du rayonnement (29). »
Quelle aumône ! C’est le
libre passage laissé dans le concret à l’action de Dieu ; c’est le rythme de la
Vie qui, sans relâche, va et vient.
Si nous approfondissons
maintenant, autant qu’il se peut faire, la donnée de la charité, – non pas, certes,
l’essence de l’amour qu’elle désigne, mais sa raison métaphysique, – je ne
crois pas que nous ayons l’occasion de rencontrer une définition supérieure à
celle que nous offre encore Ernest Hello, nous disant que « la charité est la
pratique de la Trinité ».
C’est un nuage obscur qui
crève. C’est la foudre dans le mystère notionnel. À présent nous savons que
l’acte contingent par lequel s’exprime la charité est en rapport avec la
Trinité, qu’il est un acte de la Grâce elle-même, puisque la charité est la
propriété essentielle de la Grâce et que la Grâce est une participation créée à
la vie de la Trinité. Et c’est pourquoi les plus hautes vertus, privées d’elle,
ne seront rien, pourquoi rien ne servira de connaître les sciences des anges et
les langues des hommes, de donner tous ses biens aux pauvres et de livrer son
corps aux flammes, et de soulever les montagnes, si ce n’est en accord
préalable avec la charité, car, si la charité fait défaut, c’est que l’oeuvre
n’est pas produite au Nom de la Très sainte Trinité, que ce n’est pas Dieu qui
agit par elle, mais seulement un homme.
Si la Trinité est, pour
ainsi dire, la Charité subsistante, nous ne comprenons pas, nous voyons que
tout ce que nous faisons à l’un de ces petits, c’est à Jésus que nous le faisons.
Et c’est Dieu, ainsi, qui se trouve agir dans l’instant avec nous et par nous,
vu qu’il n’est que Dieu qui puisse donner à Dieu. Un acte de charité est un
acte en collaboration avec la Trinité ; c’est, au fond, un acte dans lequel
nous nous effaçons et qui alors, par nous, offre Dieu à Dieu lui-même.
La charité, qui surpasse
incommensurablement toute gnose et toute vertu, ne les détruisant en rien,
certes, mais vivant déjà, dans une certaine mesure, leur gloire – aussi
est-elle dite « plus grande » que la foi et l’espérance elles-mêmes, qu’elle
embrasse, – ne saurait disperser, en amplifiant au maximum les facultés
extensives de l’amour. Si la charité va si loin, dans toutes les directions,
spirituelles et matérielles, c’est qu’elle accompagne le Saint-Esprit et que sa
tâche est de rassembler.
Mais ne nous y trompons
pas. Hello n’a jamais voulu identifier la notion de charité avec une espèce de
sentiment confus et, s’il réclama la charité dans l’ordre intellectuel comme
dans les autres, c’était pour superposer la splendeur à la vérité, mais
nullement pour suggérer que l’intelligence a besoin, en vue d’atteindre son
objet propre, de l’auxiliaire du coeur, entendu comme source de la volonté, et
que l’intelligence elle-même est infirme, Il a superposé la splendeur de la
charité, qui domine tout le créé, à la véracité de l’intellect, comme on pose
une couronne sur la tête du roi. Mais la couronne, bien qu’elle adhère à la
tête, n’en est pas une participation organique et la tête, qui trouve
assurément la gloire dans sa couronne royale, n’en est pas moins la tête avant
de la recevoir. La tête ne dépend pas de la couronne, mais c’est la couronne
qui lui confère la royauté.
Hello se garde bien de
vouloir bloquer les deux moyens d’expérience – l’intellect et le coeur –
lorsqu’il les appelle à témoigner simultanément, Rassembler autour de l’Un est
le contraire de mêler. Seulement, dans ce cas-là, et en regard de l’Un,
rapprocher plusieurs éléments, plusieurs sujets, les comparer métaphysiquement,
équivaut à les distinguer d’une manière absolue.
Stanislas FUMET.
Paru en 1927 dans Le
Roseau d’or.
1. PAROLES DE DIEU.
2. L’HOMME : le Veau
d’or.
3. LE SIÈCLE : les devoirs
de la critique.
4. L’HOMME : l’Homme
médiocre.
5. PHILOSOPHIE ET
ATHÉISME : Philosophie.
6. L’HOMME : Babel.
7. PHILOSOPHIE ET
ATHÉISME : l’Allemagne et le christianisme.
8. Descartes : un de ses
projets était de « le tuer ».
9. PHILOSOPHIE ET
ATHÉISME : l'Allemagne et le christianisme.
10. C’est sur cette
parole de prophétie que la Philosophie d’Hello s’arrête. L’ouvrage inachevé,
qui contient des pages magnifiques, et d’autres presque enfantines, a été
soudé, sans raison organique, à l’Athéisme au dix-neuvième siècle, qui est le
livre d’Hello peut-être le plus complet. Il l’écrivit en premier lieu sous ce
titre : Renan, l’Allemagne et l’athéisme au dix-neuvième siècle, le reprit par
la suite, en l’augmentant. Les éditeurs ont fondu cet ouvrage avec l’ébauche
Philosophie, dans le livre intitulé : Philosophie et athéisme.
11. LE SIÈCLE.
12. Déjà Pythagore
disait, dans un même esprit : « Sacrifie en nombre impair aux célestes, en
nombre pair aux terrestres. »
13. PAROLES DE DIEU.
14. PAROLES DE DIEU.
15. DU NÉANT À DIEU, I.
16. LES PLATEAUX DE LA
BALANCE. Coup d’oeil sur l’Histoire. On regrette que cet article capital soit
perdu dans un livre qui n’est pas extrêmement intéressant.
17. LE SIÈCLE, Un regard
à l’Orient.
18. Ibid.
19. Le Travail et le
repos.
20. PAROLES DE DIEU.
21. PHILOSOPHIE ET
ATHÉISME, la Rédemption.
22. PHILOSOPHIE ET
ATHÉISME. Et, dans l’Homme au chapitre de la Science, nous lisons : « ...par la
Croix, l’amour et l’ordre demeurent en équilibre et se dilatent sans s’égarer.
»
23. L’HOMME, le Signe de
la Croix.
24. Ibid.
25. PAROLES DE DIEU.
26. L’armée des hommes de
génie, lisons-nous dans le Siècle, « compte peu de soldats, et souvent ces
soldats sont sans armes ».
27. DU NÉANT À DIEU, II.
28. PHILOSOPHIE ET
ATHÉISME, la Rédemption.
29. DU NÉANT À DIEU, II.